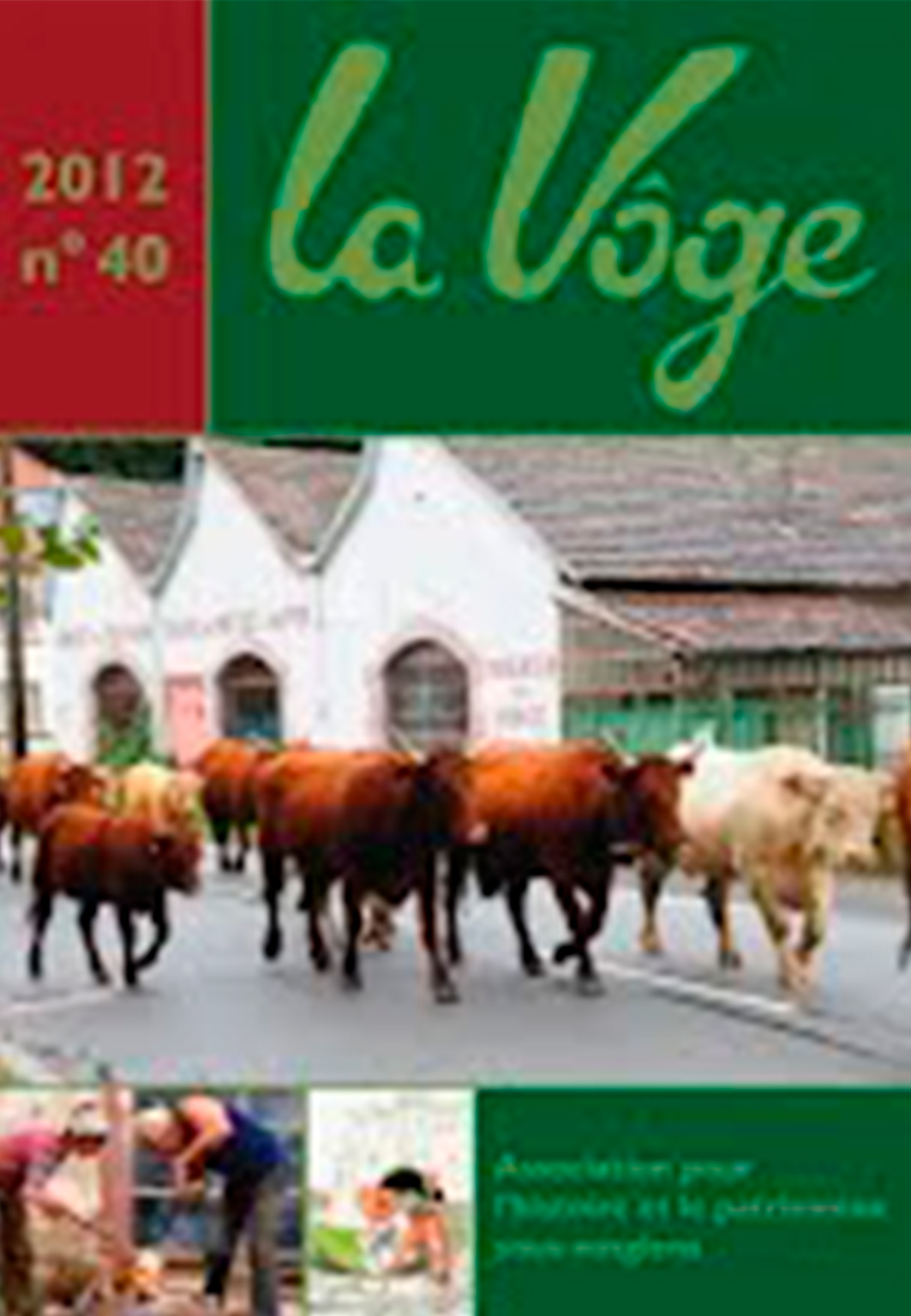
Édito
Quarante ! La Vôge n°40 est là.
Que de chemin parcouru depuis ce numéro un de juin 1988. C’était le temps où l’on découpait, aux ciseaux, les bandes de texte tapé « au kilomètre » pour en faire des colonnes en prenant bien soin de réserver une place aux photos… Tout cela, tant bien que mal. Plutôt bien que mal d’ailleurs car il était chouette, ce premier numéro, et les suivants aussi.
D’aucuns pensaient que la revue ne vivrait pas longtemps. Et pourtant !
Je veux remercier ici, celles et ceux, ils sont si nombreux, toujours présents ou hélas, disparus, qui ont oeuvré et qui ouvrent encore pour que l’aventure continue.
L’image de couverture de ce numéro 40, résume à elle seule – et ce n’est pas un hasard – toute l’histoire de La Vôge, toute la raison d’être de I’AHPSV : l’usine et la terre, le mouvement et le souvenir, le passé et le présent, tout le travail des hommes, tout ce qui contribue à notre culture, à notre mémoire, à notre » lendemain « .
Bonne lecture à tous.
François Sellier, Président de l’AHPSV.
Table des matières
| Édito | François Sellier | 1 |
| Patrimoine industriel, une charte guide notre action | Claude Canard | 2 |
| Les médaillés de Sainte-Hélène à Rougegoutte | Maurice Helle | 5 |
| Une tombe, une histoire | Maurice Helle | 8 |
| Les difficultés des mines en 1658-1660. La fin du bail Boisot | Michel Estienne | 11 |
| La tradition musicale dans le Territoire de Belfort | Claude Parietti | 17 |
| La navette | Claude Canard | 23 |
| Un réveillon de Noël au ballon d’Alsace | Édouard Lhomme | 25 |
| Les vieilles familles du Territoire : les Bringard | Gérard Jacquot | 28 |
| Le cimetière protestant de Giromagny et la famille Boigeol | Maurice Helle | 29 |
| Tissage de coton Briot et Cie | Francis Péroz | 39 |
| « Tonne du long » ou l’histoire d’un petit Alsacien venu vivre à Rougemont | François Sellier | 42 |
| Le coin des poètes | Maurice Helle | 48 |
| Le ski-club a eu cent ans (2ème partie) | Hubert Lehmann | 50 |
| Il y a cent ans ! – Revue de presse | Maurice Helle | 63 |
| Céquoidon | Claude Canard | 77 |
| Un socialiste à Lamadeleine | Francis Péroz | 78 |
| Amour, déception et Révolution à Lepuix en 1799 | Claude Canard | 81 |
| Le scandale de Felon | Illustré par François Bernardin | 92 |
| MAGAZINE | 93 |
Patrimoine industriel, une charte guide notre action
Voir cette page rédigée par Claude Canard : Charte
Les médaillés de Sainte-Hélène à Rougegoutte
En avril 1821, lors de son exil à Sainte-Hélène, Napoléon dicte son testament par lequel il lègue en particulier la moitié de son patrimoine privé à « ceux qui avaient combattu de 1792 à 1815 pour la gloire et l’indépendance de la France ».
La confiscation de ses biens par la royauté aura pour effet de rendre caduques ces généreuses dispositions. Les anciens grognards licenciés après 1815 et qui sont souvent confrontés à la misère, aux vexations, aux brimades voire aux persécutions du nouveau pouvoir royal, n’en demeurent pas moins fdèles à leur ancien Empereur, dont ils entretiennent le souvenir et nourrissent la légende. Son neveu, Louis-Napoléon, sut en tirer profit : président de la République en 1848, empereur des Français le 2 décembre 1852 sous le nom de Napoléon III après son coup d’État du 2 décembre 1851, il se sent moralement obligé de faire un « geste » à destination des survivants de la Grande Armée, dont le prosélytisme avait servi ses intérêts.
Le décret du 12 août 1857 institue 42 ans après l’abdication du « Petit Caporal » la médaille de Sainte-Hélène, destinée aux survivants des guerres de la République et de l’Empire (campagnes de 1792 à 1815).
Ses modalités d’attribution répondent à des critères stricts : les anciens militaires doivent être vivants en 1857, doivent souhaiter la recevoir, se faire connaître auprès des maires qui dressent les listes en justifiant de leurs parcours ou états de services.
Prestige d’une décoration
Suspendue par une bélière à un ruban vert marqué de cinq rayures verticales rouges, la décoration de forme ronde présente :
- d’un côté, le profil droit de l’Empereur avec l’inscription circulaire Napoléon I Empereur,
- au dos, l’inscription circulaire, Campagnes de 1792 à 1815 et sur 9 lignes horizontales À ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, Sainte-Hélène 5 mai 1821*.
Sur les deux faces, une couronne de lauriers entoure la médaille qui présente en partie supérieure, une couronne impériale ornée de 8 aigles dont les têtes sont tournées à gauche et surmontée d’une petite croix.
Cette médaille, qui peut être considérée comme l’une des premières, sinon la première, des distinctions commémoratives, réalisée en bronze patiné – d’où son surnom quelquefois de médaille en chocolat – s’accompagne d’un brevet. Elle ne donne pas droit à une pension ; elle apporte seulement le prestige aux récipiendaires.
Sous l’égide de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, les médailles remisées dans une petite boîte individuelle en carton ainsi que les brevets, font l’objet d’un envoi aux maires pour la remise aux titulaires.
Souvent, la distribution de ces décorations donne l’opportunité aux autorités politiques d’organiser des manifestations pompeuses, l’occasion rêvée de faire l’éloge du 2nd Empire en rappelant le souvenir de l’épopée napoléonienne ! Ainsi à Belfort, un tel rassemblement solennel réunit-il le 1er mai 1858, en mairie, à 4 heures ½ du soir, récipiendaires et autorités sous la présidence de M. le Maréchal de France Canrobert (Son Excellence est commandant supérieur des troupes stationnées dans l’Est).
Le Journal de Belfort et du Haut-Rhin, dans son édition du 1er mai 1858 rapporte l’événement en ces termes :
« Le grand salon de l’hôtel de ville était décoré de trophées d’armes au milieu desquels était placé le buste de Napoléon III, que dominait l’aigle impériale. La musique d’infanterie exécutait ses plus beaux airs et le corridor se trouvait garni de troupes de ligne, de sapeurs-pompiers et de cuirassiers en grande tenue.
Son Exc. a ouvert la séance par une allocution ayant trait aux gloires du 1er empire et aux souvenirs qu’elles doivent réveiller, surtout en Alsace, où le patriotisme a de si profondes racines. (…)
En résumé, rien n’a manqué à cette cérémonie où les vieux débris de nos grandes batailles se trouvaient en contact avec un guerrier dont la France contemporaine a bien le droit d’être fière. Les plus glorieux souvenirs des deux empires étaient naturellement évoqués en cette circonstance, et c’est ce qui explique l’émotion et les cris d’enthousiasme où étaient confondus le nom du chef de l’État et celui de son digne représentant.
Après cette cérémonie patriotique, son Exc. a donné un dîner où l’on remarquait entre autres personnes notables, M. le préfet du département, les généraux commandant le Haut et le Bas-Rhin, M. le sous-préfet de l’arrondissement, M. le maire de Belfort et M. Émile Keller-Haas, M. Turpot commandant en retraite, M. le procureur impérial, etc..
Le départ du maréchal Canrobert pour Besançon a été, comme son arrivée, signalé par tous les témoignages de sympathie qu’il était possible de lui donner. Les troupes de la garnison étaient sous les armes ; le canon s’est encore fait entendre et Son Exc. a emporté une bonne idée des sentiments qui animent notre population. »
Les médaillés de Rougegoutte
Rougegoutte compte cinq anciens grognards titulaires de cette décoration ; il s’agit de Petizon Jacques, Jeanrichard Jean-Baptiste et Verrier Thiébaut (honorés par la 1ère distribution de médailles), Feltzinger Laurent (2e distribution) et Lindeberg Pierre (liste supplémentaire).
Intéressons-nous maintenant à chacun d’eux :
…
(La suite dans : Les médaillés de Sainte-Hélène à Rougegoutte, par Maurice Helle , page 2)
Les difficultés des mines en 1658-1660. La fin du bail Boisot.
La guerre de trente ans, avec son cortège de dévastations et d’épidémies, a porté des coups très durs aux mines d’Alsace. À Sainte-Marie-aux-Mines, l’exploitation s’arrête purement et simplement en 1637. À Steinbach, la destruction des installations en 1633 avait conduit au même résultat. Seules les mines du Rosemont restent ainsi ouvertes, à la faveur de décisions courageuses prises par les administrateurs locaux, qui décident d’abandonner les mines les plus anciennes, Teutschgrund à Lepuix-Gy et Gesellschaft à Auxelles, pour concentrer les ressources, tant en main-d’œuvre qu’en énergie, sur un système basé sur l’exploitation de deux mines de cuivre et de plomb argentifères, le Phanitor et Saint-Pierre-au-Montjean, et d’une mine de plomb nécessaire à l’affinage des minerais des deux premières, Saint-Jean Fundgruben à Auxelles.
Le mode d’exploitation change également de façon radicale, puisqu’aux anciens entrepreneurs disposant de concessions se substitue un système d’affermage général des mines du Rosemont à un fermier unique. Toute difficulté va donc consister à trouver un fermier disposant des assises financières suffisantes pour assurer la trésorerie de l’exploitation, dans un contexte où il n’est pas possible de mobiliser les capitaux bâlois en raison des litiges entretenus avec les anciens concessionnaires, qui, même dépourvus d’intention de reprendre l’exploitation, ne souhaitent pas renoncer à leurs droits, en particulier sur la mine Saint-Pierre. Pour l’intendance d’Alsace, l’affaire est d’importance, car on croit que les mines du Rosemont peuvent être une source importante de revenus, mais aussi symbolique : ce sont en effet les seules mines d’argent alors en exploitation dans la domination du jeune Louis XIV.
Faute donc de pouvoir faire appel aux capitaux bâlois, c’est tout naturellement sur la place de Genève que l’on va chercher à s’appuyer. Genève où se développait une industrie de la broderie d’or et d’argent autour de la famille Rigaud, et qui était donc en mesure d’absorber la production. Les premiers fermiers étaient quant à eux de Montbéliard : Vatteler à partir de 1646, qui réalisa manifestement des investissements non négligeables, puis Binninger, qui tenta de reprendre également les mines de Plancher. Mais la trésorerie est déficiente, ce qui limite l’activité, et compromet le paiement du fermage.
L’intendant d’Alsace, Colbert de Croissy, frère cadet du grand Colbert, va tenter de régler la question de façon radicale, par la rupture du bail de Binninger. Une première procédure fut menée localement à l’automne 1655, mais l’intendant décida de ne pas donner suite, considérant que les publications n’avaient pas été suffisantes. L’enjeu était en effet de trouver un candidat qui exploiterait les mines de telle sorte que les ennuis précédents ne se renouvellent pas. On crut avoir trouvé l’homme de la situation en la personne de Claude Boisot, grand marchand bisontin, associé en la matière à son fis aîné. Faire appel à des marchands tenant les deux bouts de la chaîne, les approvisionnements d’une part et la vente des produits des mines d’autre part, pouvait paraître la solution idéale pour revenir à une situation pacifiée. Pour autant, cette affaire n’était pour les Boisot qu’une parmi d’autres, et leur enjeu était de retirer de l’exploitation minière les revenus les plus importants possible, tout comme leurs prédécesseurs, et les mêmes causes vont produire les mêmes effets.
Pour l’intendant, l’affaire semblait bien s’engager. Le bail avait été conclu dans des conditions assez avantageuses, puisque le canon (loyer du bail) s’élevait à 1250 pistoles, soit nettement plus que ce que versait Binninger, alors même que ce loyer était jugé déjà élevé. Les déceptions ne vont pas tarder. Elles étaient pourtant prévisibles, les Boisot ne disposant pas de la surface financière indispensable. Dès la passation du bail, ils avaient été incapables de fournir des cautions, et il avait été convenu que serait conservé en réserve, à Giromagny, le minerai correspondant à la production d’argent permettant de payer l’un des termes. Dès juin 1657, l’intendant rend compte qu’il n’y a plus personne à Giromagny capable de procéder correctement à l’affinage, ce qui témoigne de la situation structurellement fragile d’une exploitation qui demande des connaissances techniques très poussées, et qui n’a pas d’équivalent en France. Les incidents vont aller se multipliant.
C’est à la fin du printemps de 1659 que la situation va se dégrader fortement, en raison d’une sécheresse importante. Le 13 juillet 1659, Colbert de Croissy rend compte de la situation à Colbert, à son retour d’une visite d’inspection à Giromagny. Il y a trouvé la plupart des ouvriers au chômage, situation qui dure alors depuis plus d’un mois en ce qui concerne le Phanitor, qui est noyé faute d’eau pour entraîner les machines d’exhaure. La réalisation d’un nouvel étang, dont on parle déjà de longue date, et qui serait à même de contribuer à régler le problème, n’a toujours pas été engagée. Très légitimement, les Boisot estimaient qu’il s’agissait d’un investissement, à la charge des propriétaires et non des fermiers, alors que l’intendance entendait les faire contribuer à la dépense, et aucun accord n’avait pu être trouvé. Moins légitimement, ils avaient négligé de réaliser l’entretien de la galerie inférieure, permettant l’écoulement des eaux, qui de sorte envahissaient la mine.
De fortes pluies survenues lors de sa visite ont permis de relancer les pompes, mais il faut tabler sur six semaines d’efforts avant d’espérer pouvoir reprendre le travail. Mais là n’était pas le plus préoccupant ; face à la situation, les Boisot demandaient en effet une réduction considérable de leur loyer, et, surtout, avaient entamé la fonte du stock de garantie qu’ils avaient constitué conformément à leur bail. Décision logique, car elle était seule à même de permettre de poursuivre les paiements des ouvriers, mais qui faisait craindre à Croissy qu’ils n’entendent lever le pied une fois cette opération faite, lui laissant à charge les salaires des ouvriers.
Dès cette date, la religion de l’intendant est faite, il lui faut se séparer des Boisot, auxquels on ne peut plus, selon lui, faire confiance, et il va rechercher activement une solution. Dans un premier temps, il hésite entre deux solutions, une exploitation directe, confiée à un commis qui pourrait également être chargé de la gestion de la seigneurie de Belfort, ou le retour au système ancien des concessions. Conscient des problèmes que peuvent poser, sur le long terme, des baux d’une assez faible durée, une telle solution lui paraît la meilleure. Mais il faut trouver des concessionnaires, et les seuls restants sont ceux de Saint-Pierre, qui est loin d’être la mine au plus fort potentiel. Une voie est envisagée : demander aux anciens concessionnaires de Saint-Jean-Fundgruben et du Phanitor de se faire connaître, pour les rétablir dans leurs droits. La suggestion en est envoyée à Paris, mais elle ne remplit pas Colbert d’enthousiasme. Autant il souhaite que l’on ne lésine pas sur l’investissement, autant il souhaite que les différentes solutions envisageables quant à la gestion soient examinées avec soin, et l’affaire lui paraît nécessiter un arbitrage au plus haut niveau, prescrivant d’en « écrire amplement à Son Éminence avant que de prendre cette résolution qui est de grande conséquence ».
Le 8 août, Colbert croit nécessaire d’insister plus encore auprès de son frère l’intendant : « il est important », lui enjoint-il, « que vous informiez soigneusement Son Éminence de tout ce qui regarde ses mines, afin qu’elle ne vous impute point si elles viennent à dépérir. Vous savez combien Son Éminence a cette sorte de revenus à cœur pour vous appliquer avec tout le soin possible à en empêcher la ruine ».
Mais avant de réfléchir au long terme, il fallait assurer la gestion immédiate. L’intendant est en effet destinataire le 22 juillet de deux suppliques, l’une émanant de la communauté des mineurs, l’autre de l’agent du cardinal Mazarin, lui demandant d’intervenir. Les ouvriers n’ont en effet pas été payés de leurs salaires depuis cinq semaines, et un quartier du bail n’a pas été réglé. Les stocks de minerai sont au plus bas, car les Boisot ont fait fonctionner trois fourneaux simultanément, au lieu de deux habituellement, pour traiter tout ce qui reste disponible. Il est donc urgent d’intervenir avant une fuite jugée probable des amodiateurs, et dès le 23 juillet, Croissy ordonne la saisie de l’ensemble des billons d’argent présents à la fonderie, et de l’ensemble de ce qui peut appartenir aux fermiers et serait susceptible de représenter une quelconque valeur. Dès le 26 juillet, l’inventaire est fait de l’ensemble des réserves des mines. Il est trouvé à Giromagny pour 16563 livres de stocks et provisions diverses appartenant aux fermiers, alors que les dettes vis-à-vis des ouvriers étaient estimées à environ 4000 livres. Quant à la réparation de la galerie d’écoulement du Phanitor, le coût en était estimé à un gros millier de livres, le chantier ayant déjà été largement entamé. Ces résultats auraient dû conduire à en rester là, mais l’affaire était trop engagée ; elle va rapidement dépasser l’intendant.
Huit jours étaient donnés aux Boisot pour venir s’expliquer, et Croissy envoie son cousin Charles Colbert à Belfort pour surveiller le tout, mettre en œuvre les procédures et lui rendre compte. En l’absence de toute manifestation des Boisot, sommation leur est faite le 4 août ; elle ne peut leur être remise en mains propres, puisqu’ils ne …
(La suite dans : Les difficultés des mines en 1658-1660. La fin du bail Boisot, par Michel Estienne, page 11)
La tradition musicale dans le Territoire de Belfort
Panorama de la musique amateur de 1830 à 1914. Les chorales, les sociétés de trompes et de mandolines, les ensembles symphoniques.
La période 1830-1914 est propice à la création et au développement des sociétés de musique amateur (fanfares et harmonies).
Durant cette époque, 32 sociétés se créent dans 20 cités du Territoire de Belfort. Les revues La Vôge n° 10 et n°39 donnent un aperçu de ce développement.
En parallèle avec ces sociétés de musique, d’autres groupes font leur apparition : les chorales, les sociétés instrumentales spécifiques (trompes, mandolines), les ensembles symphoniques.
Les chorales apparaissent en France dès la première moitié du XIXème siècle. Elles sont constituées de chanteurs amateurs issus des classes moyennes et populaires, et sont le plus souvent subventionnées par les municipalités ou les entreprises.
Trois dates symboliques :
- 1819 : premiers cours de chant choral gratuits, à Paris,
- 1849 : premier festival choral en France, organisé à Troyes, avec 200 choristes,
- 1883 : l’enseignement du chant est obligatoire dans les écoles primaires (arrêté ministériel).
Dans le Territoire, plusieurs chorales ont une durée d’existence éphémère, elles sont citées ici pour mémoire ; les autres ont une grande activité et n’hésitent pas à se mesurer lors de concours et de festivals organisés dans toute la France.
Des ensembles musicaux spécifques se forment fin XIXème, début XXème siècle, ce sont les sociétés de trompes et les sociétés de mandolines. Dans le Territoire, on les trouve principalement à Belfort, et comme les chorales, ces ensembles participent aux concours de musique et aux festivals.
Quelques ensembles symphoniques se développent dans le Territoire, notamment à Belfort. On notera, d’une part l’orchestre du magasin Bumsel, et d’autre part la société Philharmonique Belfortaine qui a eu une très longue existence (créée en 1840, elle se produit jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale) et qui a invité Franz Liszt en 1845.
Les chorales dans le Territoire de Belfort
Nous décrivons ci-après les sociétés qui ont déposé leurs statuts et celles dont la presse a publié des comptes-rendus de leurs activités. Il est bien certain que d’autres chorales ont existé, notamment celles liées aux paroisses.
Beaucourt
En 1866, création de la société chorale, appelée la Cécilienne ou l’Union Chorale, à partir d’une ancienne chorale. Elle est reconstituée en 1905 avec statuts déposés en 1911. Chefs identifiés : Roicomte, Alfred Quinche, A. Graff. Existe en 1914. 28 membres en 1882 et 48 en 1908.
Participation aux concours de Vesoul (1877), Besançon (1884), Gray (1887 et 1899), Belfort (1888 et 1908), Plombière (1893), Lyon (1894), Paris (1895), Épinal (1896), Dijon (1898).
Publication au Journal offciel du 6 février 1914 de la chorale Sainte-Cécile Beaucourtoise, dont le siège est au presbytère de Beaucourt. Chefs : Émile Wolfer et Albert Vinter en 1914. Elle existe déjà depuis 1897 sous le nom de Chorale de l’église catholique de Beaucourt.
Belfort

Trois chorales ont l’appellation La Belfortaine et deux l’appellation Union. Compte tenu de leurs dates d’existence, elles sont indépendantes les unes des autres.
La première, dénommée société chorale La Belfortaine dépose ses statuts en 1858. Elle participe au festival des chorales de Paris en 1859. Réorganisée en 1865, elle a une activité jusqu’en 1869. Premier chef : C. Oberlin. 28 choristes en 1859.
La seconde chorale, appelée Union Chorale Belfortaine dépose ses statuts en 1872. Elle disparaît en 1875 / 1876. Premier chef : Egmann, puis Trojolli.
Participation au concours de Meaux en 1874.
La troisième chorale, intitulée Chorale de l’Union Belfortaine est créée en 1883 au sein du Cercle de l’Union Belfortaine. Ce cercle existe dès 1880 avec autorisation de l’Administrateur. Elle a une activité connue jusqu’en 1899, date à laquelle la société disparaît suite à une mésentente avec la mairie. Chefs : Auguste Duffner, Charles Mougin, Albert Eck et Joseph Wiss. 30 choristes en 1883, 19 en 1889 et 42 en 1897. Participation aux concours de Besançon (1884 et 1893), Vesoul (1885 et 1897), Dijon (1886), Gray (1887), Belfort (1888), Paris (1889).
La chorale du Cercle Catholique de Belfort (Cercle Catholique Ouvrier ?) existe à Belfort en 1885 et en 1897. Pas de statuts connus ni d’activité connue. Rappel : une fanfare dite du Cercle Catholique Ouvrier existe entre 1878 et 1908. La chorale Sainte-Cécile de Belfort est un chœur mixte. Elle se produit également soit en chœur d’hommes, soit en chœur féminin. La chorale existe dés 1887 et a une activité connue jusqu’en 1908. Chefs : Eugène Chabas, Auguste Schwaederlé et Muller. Pas de statuts connus.
La société chorale de Saint-Christophe, l’Indépendante dépose ses statuts en 1888 et a une activité connue jusqu’en 1894.
La société chorale La Concordia dépose ses statuts qui sont approuvés par l’Administrateur en 1888. Chefs : Charles Stresser, Charles Courtes, Albert Eck, Graff, Joseph Wiss, Abel Monchot, G. Gotherot. Existe en 1914. 52 choristes en 1897. Participation aux concours de Belfort (1888), Besançon (1893), Langres (1896), Vesoul (1897), Paris Puteaux (1900), Valence (1904), Nancy (1907).
La chorale israélite de Belfort est créée avec statuts approuvés par l’Administrateur en 1899. Pas d’activité connue. 23 choristes en 1898.
(La suite dans : La tradition musicale dans le Territoire de Belfort, par Claude Parietti, page 17)
Le cimetière protestant de Giromagny et la famille Boigeol
Le texte publié ici, est le contenu des propos tenus au cimetière protestant de Giromagny, le 16 septembre 2012, journée du Patrimoine. Il peut paraître inhabituel, voire surprenant, d’organiser une visite en un tel endroit voué par principe, au souvenir et à la méditation. Mais cette démarche s’inscrit bien dans les Journées du Patrimoine, tant ce modeste enclos compte de sépultures de personnes, ou plutôt de personnalités, qui ont marqué la vie industrielle ou politique du canton de Giromagny.
Même si leurs tombes montrent, pour certaines, quelques signes tangibles de vétusté ou de délabrement, elles abritent des familles qui ont donné du travail, transformé, bâti et fait de la ville de Giromagny ce qu’elle est aujourd’hui.
La communauté protestante de Giromagny
Giromagny présente la particularité comme Beaucourt, de compter sur son ban communal à la fois un temple et un cimetière protestants dont la création relève dans les deux cas, de deux familles d’industriels protestants (ou manufacturiers pour employer un terme d’époque), les Boigeol à Giromagny et les Japy à Beaucourt.
Si le temple de Giromagny placé sous le patronage de saint Luc a été inauguré courant novembre 1902, il est avéré que, grâce à Ferdinand Boigeol, un oratoire aménagé chemin Saint-Pierre accueille dès 1853 un pasteur et des fidèles, tout heureux de ne plus avoir à se déplacer à Héricourt pour prendre part au culte.
Ferdinand Boigeol achète à proximité de cet oratoire, une maison qu’il fait aménager en « école libre protestante », création attestée par un courrier adressé le 3 décembre 1878 par M. le président du Conseil presbytéral de la paroisse protestante du Territoire de Belfort à M. le maire de Giromagny pour prier la commune de « communaliser » cette école, fondée en
1865 dont le coût de fonctionnement est pris en charge par de généreux souscripteurs. Le même courrier fait état d’un nombre de 28 enfants protestants d’âge scolaire.
L’en-tête dudit courrier dont le pasteur Abt est le signataire ne fait pas encore mention de la paroisse protestante de Belfort-Giromagny, même si dès juillet 1872, l’administrateur (préfet) communique au maire de Giromagny, aux fins de consultation du conseil municipal, un dossier relatif à la demande du consistoire d’Héricourt tendant à obtenir l’érection en paroisse officielle de la communauté protestante de Belfort-Giromagny.
En l’absence d’informations à ce propos, rappelons que le temple Saint-Jean de Belfort a été inauguré et consacré en mai 1877 et qu’actuellement, la paroisse de Belfort-Giromagny a un pasteur et un conseil presbytéral communs.
Dans ce canton de Giromagny, très fortement marqué par l’infuence catholique, le développement des activités de Ferdinand Boigeol qui avait épousé une demoiselle Japy de Beaucourt, également protestante, aura pour conséquence d’attirer des familles de cette confession.
En 1841, Giromagny compte 2450 habitants (2421 catholiques et 26 protestants de la confession d’Augsbourg).
En 1846, 2709 habitants sont dénombrés dont 2656 catholiques et 41 protestants.
L’augmentation de cette partie de la population sera particulièrement sensible après la défaite de 1870 et la perte de l’Alsace-Moselle (en 1876 : 3156 habitants ; en 1891 : 3481 ; 1911 : 3606).
Maintenant que la communauté protestante de Giromagny dispose, dès 1853, d’un lieu de culte, il lui faut un lieu de repos pour ses défunts, ce à quoi va s’attacher également Ferdinand Boigeol.
Le cimetière
En novembre 1856, celui-ci demande au préfet la conversion d’un de ses terrains, en cimetière pour sa famille qui servira également à la communauté protestante de Giromagny, alors forte de 65 membres. Le préfet répond que les cimetières affectés à un service public, ne peuvent appartenir qu’à la commune. Ainsi, les époux Ferdinand Boigeol et Louise Japy (Ferdinand Boigeol est alors maire de Giromagny) font-ils don à la commune ainsi que le stipule l’acte notarial « d’un terrain en nature de pré, lieu-dit Sur St Pierre de 9.45 ares, tenant du nord au chemin de la carrière, du levant à la carrière et à des champs appartenant à J-B Grosboillot et J-B Hantzberg, au midi au sieur Crave et du couchant, auxdits donateurs ».
C’est maître Lardier, notaire, qui dresse l’acte correspondant le 11 juin 1857.
Par délibération du 1er août 1857, le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Émile Lardier 1er adjoint, accepte la donation. La préfecture autorise donc la commune à accepter la libéralité Boigeol Japy « avantageuse pour elle et en rapport avec la position de la fortune des donateurs ».
Bien entendu, en contrepartie de cette donation, il avait été établi qu’une partie du cimetière serait destinée et réservée à perpétuité à l’inhumation de la famille de Ferdinand Boigeol.
Bientôt l’agrandissement dudit cimetière s’impose et en 1913 la municipalité et la communauté protestante entrent en négociation ; à cette fn, la municipalité commande donc un projet, assurée de devenir propriétaire du terrain jouxtant le cimetière existant.
En effet, Madame veuve Philippe Berger (née Boigeol) dont le mari a été inhumé en ce lieu en 1912, s’est engagée à donner la parcelle nécessaire, propriété héritée de son père Louis Boigeol, manufacturier et maire de Giromagny décédé en 1895. L’agent voyer en retraite Vital, auteur du projet, chiffre à 2 800 francs le coût des travaux, auxquels participera la communauté protestante à hauteur de 1300 francs.
(La suite dans : Le cimetière protestant de Giromagny et la famille Boigeol, par Maurice Helle, page 29)
Tissage de coton Briot et Cie
Poussé par la demande d’indiennes, ces toiles de coton imprimées alors très en vogue, les filatures et tissages à bras se développent au début du XIXème siècle dans les vallées vosgiennes, notamment dans la vallée de la Savoureuse et dans la vallée de la Beucinière. Mais à partir des années 1830, la mécanisation apparaît. C’est ainsi que le moulin de Chauveroche, acheté en 1828 par J.-J. Romain et L. Schick, est converti l’année suivante en tissage mécanique. Les nombreux tisseurs à bras de Lepuix-Gy craignent de perdre une part non négligeable de leurs revenus. Un incendie, peut-être intentionnel, détruit le tissage en 1831.
Charles Zaepfel, médecin et industriel
Une quinzaine d’années plus tard, entre 1848 et 1853, le médecin de Giromagny Charles Zaepfel mène une active politique d’acquisitions foncières sur la commune de Lepuix-Gy. Son mariage avec Julie Finot, nièce de François Finot, maître de forges à Undervelier (Suisse), l’incite peut-être à acheter les ruines du moulin de Chauveroche et l’étang des Belles-Filles. Il reconstruit l’usine peu après. À sa mort en 1855, le site comprend une maison d’habitation, une écurie, une forge et surtout un corps principal de bâtiment qui abrite 90 métiers mécaniques, 3 machines à parer, 2 ourdissoirs, 2 bobineuses, un calorifère, une chaudière à colle. Charles Zaepfel venait alors de remplacer la roue hydraulique par une machine à vapeur de 15 chevaux. C’est une machine d’occasion. Fabriquée en 1825 par l’entreprise Perrier-Frères à Chaillot (75), elle a déjà été en fonctionnement aux établissements Steinbach-Koechlin à Mulhouse).
L’entreprise Briot
Après avoir vraisemblablement appartenu au manufacturier Bornèque, le tissage est acheté vers 1875 par Gustave Galland puis vers 1895 par Henri Briot. Ce dernier reconstruit les ateliers de fabrication. Désormais dotés d’un étage carré et couverts d’un toit à longs pans en tuile mécanique, ils abritent 260 métiers en 1884. La manufacture SARL Briot, créée en 1924, se spécialise dans la fabrication du linge de toilette (serviettes éponge, draps de bain, gants de toilette, serviette nid d’abeille, articles de layette). Le tissu est ensuite envoyé à Thaon-les-Vosges pour le blanchiment avant de revenir à l’usine. En 1961-1982, un nouvel atelier de fabrication en rez-de-chaussée, construit en parpaings de béton, est adossé à l’atelier central et est équipé en 1964 de 120 métiers automatiques. Le tissage ferme ses portes en 1979 mais reste propriété de la SARL jusqu’à sa dissolution en 1989. Les bâtiments sont alors cédés à l’association Marie-Rose Briot qui les loue pour partie au Secours Catholique et pour partie à l’ADAPEI.
Une machine à vapeur
Vers 1896-1897, Henri Briot fait installer une nouvelle machine vapeur développant 100 à 120 chevaux. Construite par l’entreprise A. Blondel et Cie à La Madeleine-lez-Lille (59), c’est une machine monocylindrique, à double effet, à distribution de type Frikart, à régulateur à boules. L’admission de la vapeur se fait par les deux cylindres supérieurs et l’échappement par les deux cylindres inférieurs. La force motrice est transmise à l’atelier des métiers à tisser par le jeu de deux poulies de renvoi et par des courroies de chanvre de section carrée passant à l’extérieur. Cette transmission a ensuite été supprimée et la machine est alors directement reliée à un alternateur Alsthom tournant à 1000 t/mn et produisant du courant continu. La machine était alimentée en vapeur par deux chaudières de marque Scheidecker Frères et Cie (Thann), encore en place actuellement.
Alimentées en charbon, équipées d’un économiseur Green (Hallines par Wizernes – 62) et de soufferies alimentées par des moteurs électriques individuels, ces chaudières portent les dates de 1927 et de 1936. Elles ont été installées par l’entrepreneur belfortain de fumisterie industrielle Jules Rietsch. À la même époque, une turbine Kaplan de marque SHM (Tours ?) dotée d’un régulateur de vitesse SHM est également couplée à l’alternateur. La machine a été arrêtée à une date indéterminée.
Une encolleuse
L’encolleuse est une machine qui sert à …
(La suite dans : Tissage de coton Briot et Cie, par Francis Péroz , page 39)
« Tonne tu long » ou l’histoire d’un petit Alsacien venu vivre à Rougemont
C’est l’histoire d’un petit Alsacien, né allemand, arrivé à Rougemont-le-Château un jour de 1887.
Son chemin est sans doute semblable à celui de milliers d’autres enfants arrivés en France après la défaite de 1870-1871.
Mais c’est la vie de « Tonne tu long » que nous avons choisi de raconter ici.
Le traité de Francfort signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand entérine l’annexion par celui-ci de l’Alsace-Moselle.L’article 2 du traité précise que les sujets français domiciliés dans ces territoires jouiront jusqu’au 1er octobre 1872 (cette échéance sera prolongée d’un an) de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fxer. Près de 160878 Alsaciens-Lorrains résidant dans les territoires annexés font alors une déclaration d’option, mais seulement 49926 en sont effectivement partis. Certains en effet, ont opté pour montrer leur attachement à la France sans pour cela accepter de tout quitter et surtout, près de 100 000 demandes ont été rejetées par l’autorité allemande.
Quitter Leimbach avant l’aube

L’histoire ne dit pas si Conrad Claerr (avec deux r), né le 7 juillet 1849, fait partie des chefs de famille qui ont opté et qui ne sont pas partis. Quand il épouse Rosalie Maurer en 1872, il est voiturier à Vieux-Thann. Quand naît son fils Marcel en 1877, il est ouvrier de fabrique aux usines Scheurer de Bitchwiller-lès-Thann. Il y devient ensuite « employé aux écritures » et assure parallèlement le secrétariat à la mairie de Leimbach, un certain temps. Il faut dire que son père (prénommé Conrad lui aussi) cultivateur de son état, était adjoint au maire et avait envoyé son fils étudier au collège de Lachapelle-sous-Rougemont. Cette instruction valut à Conrad Claerr fils d’exercer un temps un rôle d’estafette auprès du colonel Denfert-Rochereau durant le siège de Belfort.
Bref, Conrad Claerr, deuxième du nom, est un personnage en vue dans la commune de Leimbach près Thann. C’est un homme autoritaire : ses fils aînés, François, Jules, Marcel, doivent aller à pied, à tour de rôle et chaque matin avant l’heure de l’école, lui porter sa « gamelle » pour le repas de midi… à Bitchwiller !
Il est aussi connu pour ses sentiments anti-allemands. La mémoire familiale rapporte qu’il en faisait pis que pendre aux nouvelles autorités : farces, tentatives d’humiliation, insoumission, etc…
Toujours est-il qu’un soir de 1887, la police locale allemande se rend à la maison de Conrad Claerr : « Il faut que demain, avant le lever du jour, vous soyez partis ». C’est ainsi qu’avec son épouse Rosalie et leurs sept enfants, Conrad quitte Leimbach, abandonnant famille, maison, terres, vignes. Avaient-ils prévu ce départ précipité ? Nul aujourd’hui ne le sait. Ils traversent à pied forêts et montagne menant à la France chérie et s’arrêtent au premier village qu’ils rencontrent : Rougemont. Peut-être n’est-ce pas totalement un hasard car il y a déjà beaucoup d’optants venus s’établir dans la commune et les villages avoisinants.
Allemands quand même !
Comme tous les immigrés, car ils sont immigrés dans leur propre pays, Conrad et les siens doivent se faire une place au village, surtout les enfants qui sont nés allemands et qui ont été à l’école allemande !
Peu après, Marcel entre en apprentissage. Pour cela, l’instituteur de Rougemont lui délivre un certifcat d’instruction primaire élémentaire, conformément à la loi sur le travail des enfants mineurs employés dans l’industrie. Sur ce certificat, il est bien précisé que l’enfant sait lire, mais en allemand !
Successivement il est employé à Rougemont aux établissements Winckler, Victor Erhard, puis à nouveau Winckler comme apprenti tisseur. Il travaille un mois chez Dollfus-Mieg et Cie à Belfort puis quelques jours à la serrurerie Schmerber à Rougemont comme ouvrier aux meules (c’est dans cette entreprise que travaille son père).
Bref, Marcel a son caractère et à l’évidence, il est peu fait pour le travail en usine… Il va donc apprendre le métier de charpentier. Mais il doit aussi effectuer son service militaire car il a été intégré dans la nation française et fait partie de la classe 1899 (et non 1897). Il effectue ce service au 9e bataillon d’artillerie à pied de Belfort en qualité de 2e canonnier-servant entre le 14 novembre 1900 et la fn septembre 1901.
À son retour à la vie civile, il épouse le 25 juillet 1902, une flle de Rougemont, Louise dite Maria Koenig. On note sur l’acte de mariage que Claerr s’écrit encore avec deux R alors que sur le fascicule de mobilisation, Claer ne comporte qu’un R. Ce sera cette orthographe qui perdura, ça fait moins allemand !…
Malgré ses nombreux chantiers de charpentier, Marcel effectue plusieurs périodes d’exercice dans l’artillerie.
Témoin de « l’affaire » du caporal Peugeot
Hélas, le monde sombre bientôt dans une guerre horrible. Marcel qui maîtrise parfaitement la langue allemande part à la guerre avant les autres. Le 29 juillet 1914, il est affecté au service de renseignements de la 1re armée.
À Rougemont, personne ne sait où il est, secret oblige. Les mauvaises langues disent même qu’il est passé à l’ennemi… Son épouse Maria a bien du mal à expliquer « la disparition » de son mari. Elle tente de convaincre les curieux qu’il est parti monter une charpente dans le sud du département et qu’il ne peut donc pas rentrer chaque soir…
Le premier « fait d’arme » de Marcel Claer a lieu le 2 août 1914. « Claer Marcel vient de suivre une patrouille de uhlans qui est venue depuis la forêt de …
(La suite dans : « Tonne tu long » ou l’histoire d’un petit Alsacien venu vivre à Rougemont , par François Sellier, page 42)
Le ski-club a eu cent ans (2e partie)
Les statuts déposés en préfecture de belfort le 6 janvier 1909 sous le n°79 paraissent au Journal officiel le 22 du même mois. Retenons l’article premier qui est essentiel :« L’association dite Ski-club de Giromagny a pour objet la pratique du ski, des sports de montagne et des randonnées pédestres ». L’histoire nous dira que seule la météorologie a contrarié la réalisation des activités et obligera à innover et à composer avec elle, parfois avec une certaine harmonie.
Nous poursuivons le déroulement des cent ans d’activités du ski club de Giromagny, débuté dans le dernier numéro de la revue. Pour des raisons techniques le tableau proposé n’est
pas paru dans l’article du n°39 de La Vôge. Après une refonte complète et une remise en page compatible avec l’édition, vous le trouverez cette fois-ci aux pages suivantes.
Plutôt que d’écrire une biographie de la longue vie du Ski-club nous avons opté pour une présentation sous forme d’un tableau synthétique. D’un coup d’œil rapide, vous associerez les dates, le nom des présidents et les faits marquants ainsi que l’évolution des sociétaires et des licenciés. Des blancs existent, qui n’ont pu être comblés, faute d’informations… Mais peut-être possédez-vous ces compléments ? Alors, n’hésitez pas une seconde à nous en faire part !
Des imperfections ou des imprécisions subsistent également et pour les mêmes raisons. Néanmoins, ce qui est écrit ici, est issu au moins d’une preuve écrite ou comptable souvent complétée par une observation photographique.
L’activité ski fut forcément omniprésente tout au long du siècle passé, mais ne fut pas l’unique raison de vivre de l’association. Les statuts déposés nous rappellent qu’elle a aussi pour objet la pratique des sports de montagne et les randonnées pédestres. Vous vous rendrez compte très vite que les présidents successifs ont développé des activités multiples, au gré des saisons, des événements, des passions de chacun (avec plus ou moins de réussite). Mais peut-être était-ce un gage de survie que d’entretenir des liens tout au long de l’année.
Refuge, l’histoire continue
« Là-haut sur la montagne l’était un vieux chalet… là-haut sur la montagne l’est un nouveau chalet …! » dit la chanson. Des centaines de fois auprès du feu elle fut chantée avec tout le répertoire des veillées repris en chœur par les montagnards et randonneurs qui font ici une halte et trouvent un petit coin de bonheur. Au lieu dit Planche des Belles Filles, à l’altitude 1025 m, le refuge n’est pas nouveau, mais il subsiste. Il est le seul rescapé parmi les cabanes, abris et autre refuge du patrimoine bâti qui était dispersé sur le massif du Ballon d’Alsace et alentour. Pour retrouver ses origines, il faut remonter au temps de l’immédiat après première guerre mondiale, vers 1920.
Vraisemblablement, la métairie dite ferme de La Haute Planche fut louée et exploitée jusqu’à la veille du confit de 1914-1918. Les maigres rendements, les conditions climatiques et les affres du temps ont fait le reste et ont eu raison de la vieille ferme qui dorénavant menace ruine.
Quand neuf compères messieurs Adam, Faivre, Pfieger, Frick, Bruot, Schoftt et Canal ainsi que mesdemoiselles Franchebois et Bruot découvrent la ferme dans ce piteux état, vers 1920, ils n’ont qu’une idée, y construire un refuge. Il faut dire qu’ils sillonnent le massif depuis la création du Ski-club, c’est une de leur raison d’être. Et ils ont connu la ferme en activité. Voilà le lieu dont ils rêvaient depuis longtemps. Les premiers contacts sont pris avec les propriétaires à Plancher-les-Mines, Messieurs Charles Mathey et Eugène Marsot. Après bien des démarches, les premiers accords verbaux sont obtenus. Il n’en faut pas plus pour que Monsieur Pfieger architecte de profession et éminent membre du Ski-club élabore un projet, dessine, consulte les artisans locaux et chiffre le projet à hauteur de 7600 francs. Somme conséquente pour l’époque et surtout pour un club qui n’a que dix ans d’âge ! Pour tenter une comparaison avec le coût de la vie vérifions ce que rapporte le travail.Un ouvrier spécialisé en scierie travaillant jusqu’à 10 heures par jour à la belle saison, 6 jours par semaine, est rémunéré à 1,50 francs de l’heure. Il gagne donc 360 francs par mois. Le pain vaut alors 0,70 franc le kilogramme, et la cotisation du club est à 5 francs.
Le projet fait débat au sein du club, mais la passion l’emporte ! Maître Schoftt notaire et vice-président du Ski-club, propose d’avancer l’argent sur ses fonds propres et, en tant que délégué, de solliciter le Touring Club de France. Il obtient une subvention de 5000 francs ! Le projet est ambitieux, mais reconnu d’utilité publique. Le comité approuve l’offre d’avance et s’engage en ces termes manuscrits sur papier libre :
…
(La suite dans : Le ski-club a eu cent ans (2e partie), par Hubert Lehmann, page 42)
Un socialiste à Lamadeleine
Enfance à Foussemagne
À la fin du XIXe siècle, Foussemagne est un petit village du Territoire de Belfort, bordé par la nouvelle frontière franco-allemande créée par le traité de Francfort de mai 1871. C’est un village singulier qui possède une synagogue mais pas d’église comme l’a rappelé l’écrivain André Frossard dans le livre qui l’a rendu célèbre Dieu existe. Je l’ai rencontré. Deux habitants sur cinq sont en effet de confession juive, une particularité qui remonte au XVIIIe siècle quand la comtesse de Reinach-Foussemagne autorise quelques familles israélites à s’installer dans le village.
Juifs et chrétiens vivent en bonne intelligence, sans conflit. Au début des années 1880, Louis Marie Frossard, un jeune homme originaire de Cunelières, ouvre un atelier de bourrellerie à Foussemagne. Il tombe amoureux de Stéphanie Schwob. Leur mariage en décembre 1888 défraie la chronique : l’union d’un libre penseur et d’une jeune juive est alors totalement inédite. Quatre mois plus tard, le 5 mars 1889, naît leur premier fils, prénommé Oscar Louis pour l’état-civil et qui changera ultérieurement son prénom en Ludovic-Oscar.
La découverte du socialisme
Le jeune garçon suit les cours à l’école primaire de Foussemagne. Et le soir, il s’installe dans l’atelier paternel, là où autour du bourrelier qui poursuit son travail, les ouvriers de la tuilerie Clavey voisine discutent de politique. Ludovic-Oscar Frossard, découvrant ainsi les idées républicaines, est ainsi « allé à la politique comme le canard à la rivière. Elle était dans l’air [qu’il] respirait. [Son] village avait la réputation, dont il tirait une grande fierté, d’être un des foyers où l’on entretenait la flamme de la propagande républicaine ».
Élève brillant, le jeune Frossard est admis en 1903 à l’école primaire supérieure de Giromagny où il obtient le certifcat d’études. Puis il entre à l’école normale de Belfort. Le cuisinier de l’établissement lui fait lire L’Humanité. Ludovic-Oscar Frossard est alors subjugué par la personnalité de Jean Jaurès et, à 13 ans, il décide de consacrer sa vie au socialisme. Cet engagement le détourne de ses études. Certes, il devient instituteur mais il aurait eu la capacité d’intégrer la prestigieuse école normale supérieure et devenir professeur.
En devenant socialiste, Ludovic-Oscar Frossard découvre un autre modèle, Gustave Hervé. Ses idées pacifistes et antimilitaristes le marquent durablement, à une époque où les exercices militaires des bataillons scolaires font encore partie du quotidien des écoles primaires.
Alors qu’il n’a même pas achevé ses études, le jeune Frossard mène son premier combat politique en tentant de porter la contradiction à un orateur du mouvement du Sillon à Grandvillars, dans le fief politique de la famille Vieillard. À la rentrée suivante, en 1908, il obtient son premier poste d’instituteur à Montreux-Château à quelques kilomètres seulement du domicile familial.
« Le souvenir des partageux de 1848 »
En 1910, la tête emplie de ces idées antimilitaristes, Ludovic-Oscar Frossard effectue son passage sous les drapeaux au fort du Mont Bart sur les hauteurs de Montbéliard. Il devient sous-lieutenant mais il persiste à affirmer haut et fort son opinion. Cela lui vaut de passer en conseil de guerre, d’être dégradé et d’être affecté comme simple soldat à Belley dans l’Ain.
Deux ans plus tard, Ludovic-Oscar Frossard en a fini avec ses obligations militaires. Mais il ne retrouve pas le poste qu’il occupait à Montreux-Château. Il n’obtient pas davantage le poste qu’il convoitait à Frais, à deux kilomètres du domicile paternel. Nommé à Lamadeleine, au cœur des collines sous-vosgiennes, un poste généralement réservé aux fortes têtes, il décrit, non sans humour, son nouveau cadre de vie : « ce village – non ce hameau – que l’autorité académique jugeait sédatif pour les ardeurs trop vives […] se composait d’une dizaine de maisons distantes l’une de l’autre de plusieurs centaines de mètres. Au centre, la maison d’école avec en face la chapelle de sainte Madeleine. Pas d’épicier, pas de boulanger, pas de boucher. La commune la plus proche était à six kilomètres dans la plaine, la gare la plus proche à vingt kilomètres. Mi-paysans, mi-bûcherons, les gens de La Madeleine étaient de pauvres gens qui vivaient chichement du produit de leurs maigres terres et de l’abattage des bois. Très fermés et du reste défiants. Mon lieu de déportation était riant l’été, avec ses prés verts, encadrés de sapins, mais l’hiver l’emprisonnait six mois sous d’épaisses couches de neige qui rendaient les chemins presque impraticables. J’avais une dizaine d’élèves de six à douze ans. L’hiver, je ne les voyais pas à cause de la neige. L’été non plus à cause des travaux des champs. Ils ne fréquentaient guère l’école qu’au printemps. […] Je cumulais mes fonctions avec celles de secrétaire de mairie – peu absorbantes il est vrai ».
La venue d’un socialiste dans le village renforce la méfiance quasi-naturelle des habitants et en particulier celle du maire Guillaume Leimbacher, un nonagénaire, premier magistrat de
sa commune depuis le Second Empire. Le socialiste Frossard représente à ses yeux un « échantillon d’humanité inédit […] et du fond de sa mémoire lui revenait le souvenir des partageux de 1848 ! »
En le rencontrant à son domicile, Ludovic-Oscar Frossard a « l’impression qu’il serrait son portefeuille et s’assurait du regard que son armoire était fermée à clef ».
Pour le jeune instituteur, cette nomination est une véritable injustice. Il ne la voit pas comme une sanction administrative conséquence de son militantisme mais comme une atteinte à son statut de normalien.
Il estime avoir droit à un poste équivalent à celui de Montreux-Château qui lui rapportait 400 francs en sus de son traitement alors que le poste de Lamadeleine ne jouit que d’une centaine de francs de revenus complémentaires pour les travaux administratifs du secrétariat de mairie. Ludovic-Oscar Frossard appuie sa protestation sur son rang de major de sa promotion de l’école normale et sur le fait que, seul de tous les instituteurs du Territoire de Belfort, il a accompli une quatrième année d’étude. De plus, titulaire du brevet supérieur, il succède à Lamadeleine « à M. Bringel qui n’a que son brevet élémentaire, à M. Pischoff qui échoua au brevet supérieur, à M. Sauvageot qui ne possède que son brevet élémentaire et à M. Miellet qui y fut envoyé pour excès de galanterie ».
(La suite dans : Un socialiste à Lamadeleine , par Francis Peroz, page 78)
Amour, déception et Révolution à Lepuix en 1799
La précédente revue La Vôge nous avait entraînés sur les pas du futur académicien Charles Nodier, envoyé en mission scientifique par le Directoire à Lepuix en 1799. Il restait à poursuivre l’enquête à propos d’un texte romanesque magnifiant les beautés du pied du Ballon. Mission accomplie, nous pouvons mettre sous les yeux de nos lecteurs l’écrit en question. Il a fallu le compléter de notes explicatives en fin de texte. Elles sont indispensables à une meilleure compréhension de la période assez troublée et pour situer avec exactitude les nombreux personnages et les faits révolutionnaires cités.
Curieux détours pour la publication de cette historiette. Charles Nodier avait commencé à publier ses nouvelles de façon éparpillée. La tentation de les regrouper de façon thématique en volumes est venue plus tard. Curieusement il y a eu évolution d’une réédition à l’autre. Pour le texte qui nous intéresse, par exemple, on le trouve dans un recueil titré : « Souvenirs épisodes et portraits pour servir à l’histoire de la Révolution et de l’Empire, » par Ch. Nodier, tome premier édité à Bruxelles par Louis Haman et Cie en l’an 1831. Il exposait lui-même en préface : « Pour expliquer le livre que voici, il convient de dire qu’il n’offre que les débris d’un livre. » Sans une virgule en plus ou en moins, on retrouve la même nouvelle cette fois dans un recueil titré « Souvenirs de jeunesse » cinquième édition (la première est éditée en 1832) suivie de l’addition de deux autres nouvelles. D’un livre à l’autre, seul le titre a changé.
Dans le premier ouvrage, le récit est septième et avant-dernier et s’intitule « Les émigrés en 1799. » Pour l’édition Charpentier, libraire éditeur de Paris datée de 1850, utilisée pour la transcription ci-dessous, le souvenir devient simplement « Thérèse. » Le recueil compte comme titres au début un florilège de prénoms féminins, Thérèse étant le second récit. Si dans le premier ouvrage Charles Nodier donne prudemment comme origine des témoignages le nom d’un certain Maxime Odin qui en serait le vrai auteur, cette fois il s’affranchit de cette précaution du pseudonyme.
L’édition à Bruxelles évoque une période de proscription suite à la fin tragique de la révolution des trois glorieuses. Faut-il pour autant prendre au pied de la lettre ce récit qui n’a pas varié d’un iota d’une édition à l’autre ? Charles Nodier précise dans l’édition de 1831, toujours en préface : « Il n’y a rien de plus vulgaire que les faits, et rien sur quoi l’on s’accorde le moins. Jeune, j’ai été un homme de parti et j’ai servi la cause avec laquelle j’étais lié dans l’abandon inexpérimenté de mes premiers sentiments, ami constant et passionné de la liberté.» Une affirmation qui contient une forme d’excuses pour les erreurs de jeunesse ( il a avait été jacobin comme son père) d’un homme empressé de faire carrière côté royaliste après la Restauration. À en juger par les positions critiques contre les jacobins de la constitution de l’An III qu’il cite nommément, il se range, peut-être à postériori et par complaisance au pouvoir, au côté des adversaires des sans-culottes. Notons cependant qu’il paraît établi qu’il avait pris des distances au moment de la terreur.
Une certification des faits est-elle enfouie sous le vernis romanesque ? Il dit de Thérèse qu’elle était « une magicienne » en tout cas sans doute une fameuse ensorceleuse qui lui fit rappeler le paysage du pied du Ballon sous un jour merveilleux, dans une description des plus flatteuses.
Les milieux littéraires du XIXe siècle ont parfois accablé Charles Nodier à cause de son imagination débordante, de ses « contes bleus » faussement autobiographiques. Citons un extrait le moins méchant d’une lettre de Barbey d’Aurevilly : « Une jolie imagination qui a passé. Il avait de l’arc-en-ciel dans l’esprit… mais l’arc-en-ciel ne danse que sur les nuages et s’y évanouit. »
Amis lecteurs laisser vous bercer, c’est tout de même joliment écrit.
Thérèse
« Il faut vous dire que, depuis la chute des assignats, le Directoire avait senti plus d’une fois la nécessité de mettre une grande masse de métaux en circulation. Comme il touchait à sa fin, et que les vieilles gens croient tout ce qu’on leur dit, le Directoire, qui s’était laissé dire que la France était extraordinairement riche en mines d’argent, dépêcha sur toutes les anciennes mines du pays des escouades d’explorateurs grassement payés, et qui, bon gré mal gré, n’ont jamais envoyé une obole à la Monnaie.
Je me trouvai colloqué dans l’expédition des Vosges, où l’on cherche de l’argent de temps immémorial, et dont les ballons, coupés de routes splendides, attestent d’immenses et inutiles travaux. Nous étions tous jeunes, tous gens de bonne humeur et d’espérance, tous amis de notre devoir et impatients de découvertes. Nos travaux furent zélés et consciencieux, et longtemps même ils ne furent pas sans espoir. Je me souviens qu’il n’y avait pas un de nous qui, au premier coup de marteau, n’eût découvert un filon ; mais ce filon ne menait malheureusement à rien, et les moindres frais d’exploitation excédaient toujours d’un grand tiers les plus brillants résultats. C’était une succession d’extases et de désappointements pour lesquels je n’avais point alors de termes de comparaison. Je me suis aperçu depuis que cela ressemblait à la vie comme deux gouttes d’eau. Nous arrivâmes au terme des fausses ambitions, au découragement absolu. Il fallait alors épargner à l’État une dépense ridicule ; mais cette défection désintéressée ne pouvait s’appuyer que sur des calculs exprimés avec clarté. Je n’avais pas dix-huit ans, et toute ma science se réduisait à quelques bribes de latin, et à la connaissance fort mal approfondie de quelques spécialités d’histoire naturelle, parmi lesquelles la minéralogie tenait une toute petite place. Mes camarades, qui auraient distingué à la cassure, à l’odeur exhalée par friction, au contact de l’ongle, au happement de la langue, toutes les substances inorganiques alors reconnues en géologie, s’étaient aperçus de bonne heure de mon inaptitude : mais ils ne me contestaient pas un assez joli mérite de rédaction que je rapportais fraîchement d’une école de rhétorique dirigée par le bon et judicieux Droz ; et il est vrai que je traduisais lisiblement leurs pages un peu confuses, quand je parvenais à y comprendre quelque chose. Il fut donc convenu que je résiderais à poste fixe dans un lieu central où me parviendraient tous les documents, et d’où je ferais partir toutes les dépêches.
Les employés se répartirent sur les mines ; le chef se réfugia, comme c’est l’usage, dans les délices urbaines d’Épinal, et mon poste fut fixé à Giromagny, près du Ballon de ce nom, dont les trésors, trop vite abandonnés peut-être, étaient le principal objet de nos investigations. Par un élan de dévouement tout particulier, qui me fut avantageusement pointé sur mes notes de service, je me reportai d’une grande lieue de rayon vers le centre, dans un village qu’on appelle le Puy, parce qu’il est exactement à la base de la montagne ou du Podium ; mais ce n’était ni cet avantage de position, ni cette heureuse rencontre d’étymologie qui m’avaient déterminé dans le choix de mon domicile ; je le pense du moins aujourd’hui, car alors je savais à peine ce que c’était.
Vous tous qui avez voyagé en tout pays, et qui n’avez pas vu la gorge romantique du Puy, il vous reste un voyage essentiel à faire, et ne craignez pas que j’anticipe sur les sensations délicieuses qu’il vous promet par une de ces descriptions postiches, qui au bout du compte, ne peignent rien. En effet je n’ai jamais senti plus profondément l’impossibilité de peindre. Quand vous serez arrivés de Giromagny au pied du Ballon, à travers cette route étroite, et cependant moins opaque d’horizon que d’ombre et de fraîcheur, comme dit le poète latin, qui…
(La suite dans : Amour, déception et Révolution à Lepuix en 1799, par Claude Canard, page 81)
Ce numéro de La Vôge vous intéresse et vous souhaitez le lire dans son intégralité ?
