
Table des matières
|
Une affaire d’exercice illégal de la médecine à la fin du XIXème siècle |
Francis PEROZ |
2 |
|
Le théâtre de Giromagny au début du siècle |
Jean DEMENUS |
7 |
|
La région sous-vosgienne à la veille de la Révolution |
François LIEBELIN |
11 |
|
La guerre de 1870 au pied des Vosges |
Etienne KELLER |
21 |
|
Un homme de conviction Jules Heidet 1894-1944 |
Dominique DATTLER |
23 |
|
Les homicides dans la région sous-vosgienne pendant la domination autrichienne |
Christophe GRUDLER |
26 |
|
Il y a 100 ans |
François SELLIER |
31 |
|
Le passage des Vosges au 17ème siècle |
Philippe DATTLER |
35 |
|
MAGAZINE |
|
|
|
Le retour des bénédictins |
Philippe DATTLER |
37 |
|
Comptez, comptez-vous bien… |
Philippe DATTLER |
38 |
|
À lire sur la région sous-vosgienne |
|
39 |
|
Scandale à l’église |
|
41 |
|
Concours des Monuments Historiques et des Sites |
Pierre WALTER |
42 |
|
Les gares… on ferme |
Dominique DATTLER |
43 |
Une affaire d’exercice illégal de la médecine à la fin du XIXème siècle

Le jeudi 1er décembre 1892, le Journal Officiel de la République Française publie un texte de loti relatif à l’exercice illégal de la médecine. Habituellement, ce vocable recouvre la pratique d’actes médicaux par des personnes dont les capacités en la matière n’ont pas été reconnues par la Faculté. Leur « médecine » est ainsi fondée sur un empirisme plus ou moins solide.
Cette loi entend bien lutter contre cela puisqu’elle stipule dans son article premier : « Nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français à la suite d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur de l’État ». Mais cette loi va avoir des conséquences autrement plus gênantes pour de nombreux habitants de ce qui reste du département du Haut-Rhin, après la défaite de 1870.
Les médecins diplômés à l’étranger ne peuvent plus exercer en France
La loi prévoit en effet que « les médecins … diplômés à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu’à condition d’y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine ». Est alors considérée comme exerçant illégalement la médecine « toute personne qui, non munie d’un diplôme de docteur en médecine, d’officier de santé prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales … sauf en cas d’urgence ».
Le texte de loi précise encore que « les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle » et que « quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 F à 500 F et, en cas de récidive, d’une amende de 500 F à 1000 F et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Le futur Territoire de Belfort, et notamment la bordure orientale, est particulièrement touché par la portée de cette loi. Malgré la coupure administrative imposée par le Traité de Versailles, les habitants ont en effet gardé l’habitude de consulter leurs médecins devenus prussiens et ceux-ci continuent leurs consultations sur le sol français. Leurs successeurs, formés à la Faculté de Médecine de Strasbourg, persistent dans ces habitudes, reçoivent à leurs cabinets des résidents des cantons de Rougemont-le-Château et de Fontaine et font dans ces mêmes cantons des visites à domicile. Le service qu’ils assurent n’est ni négligeable ni superflu au regard de la sous-médicalisation qui existe alors dans ces régions.
La loi publiée le 1er décembre 1892 tombe comme un couperet et met fin à ces pratiques. Les habitants concernés sont brutalement exclus de leur univers médical habituel et obligés de recourir, en cas de besoin, à un médecin souvent plus éloigné de leur domicile.
Face à cette volonté gouvernementale, ils se sentent dans l’obligation de réagir. Ainsi, le 22 janvier 1894, des salariés au « tissage de MM. David Trouiller et Adhémard à Saint-Germain » écrivent à l’Administrateur du Territoire de Belfort qui fait alors fonction de Préfet du Haut-Rhin. Le ton très respectueux de la lettre, la graphie soignée tranchent avec les soixante et une signatures souvent apposées d’une main malhabile à la lin de cette missive. Sans doute, un des responsables du tissage s’est-il fait le porte-plume de ses ouvriers, peut-être même est-il à l’origine de cette action. Selon eux, la situation est grave : « plusieurs de nos camarades sont malades et vu le départ du docteur Grisez de Lachapelle, il n’y a plus de médecins dans les environs pour nous soigner ». Ils demandent en conséquence au Préfet « d’autoriser M. Ortscheid, docteur à Massevaux (sic) qui était chargé de donner ses soins aux ouvriers du tissage de Saint-Germain à venir voir nos camarades malades en attendant qu’un nouveau Docteur soit installé dans notre région ». Ils souhaitent que soit « levée pendant quelque temps l’interdiction de M. Ortscheid de l’exercice de la médecine à Saint-Germain ». Souhaitable pour les responsables du tissage inquiets pour la santé de leur personnel sans doute autant que pour une éventuelle baisse de leur production faute de bras, souhaitable pour les habitants de Saint-Germain eux-mêmes, la levée de cette interdiction qui découle de la loi parue au Journal Officiel du 1er décembre 1892, est également souhaitable pour M. Monnier, le maire de Saint-Germain qui, dans une mention marginale à la pétition, assure le Préfet que « la demande est bien fondée ».
Dans sa réponse datée du 17 février 1894, l’Administrateur du Territoire de Belfort rappelle au maire de Saint-Germain les termes de la loi : « les médecins, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent exercer leur profession en France qu’à la condition d’y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine ». Implacable, le haut fonctionnaire conclut en ajoutant que « cette disposition ne comporte aucune exception ».
La loi doit donc s’appliquer dans toute sa rigueur, au moins en ce qui concerne les classes les plus basses de la société de ce XIXème siècle finissant. Car cette absence d’exception mise en avant par le préfet pour rejeter la demande, somme toute justifiée, des soixante et un tisseurs de Saint-Germain, n’existe pas lorsque un membre de la bourgeoisie d’affaire sollicite ce même fonctionnaire .
Aux gendarmes de Lachapelle venus enquêter le 22 juillet 1894 sur les agissements du docteur Ortscheid qui semble poursuivre l’exercice de sa profession en France muni de son diplôme obtenu en 1891 à Strasbourg, Jean-Baptiste Grisez, brasseur à Lachapelle, déclare en effet spontanément : « M. le Docteur Ortscheid vient très souvent voir mon oncle Grisez Célestin à qui il donne ses soins depuis le mois d’avril 1893. Après la mise en vigueur de la loi sur les médecins étrangers, il avait cessé de venir mais ayant été autorisé au mois de février dernier par M. l’Administrateur, il a repris ses visites auprès de mon oncle et il continue toujours à venir le soigner ». Jean-Baptiste Grisez (1861-1915) est le quatrième représentant d’une famille de brasseurs dans les affaires à Lachapelle depuis 1805. Son oncle Célestin, célibataire, décéda à Lachapelle en 1895.
La bonne réputation du docteur Ortscheid
Privés de consultations à domicile, les habitants de la zone sous-vosgienne n’hésitent pas à parcourir un long chemin pour aller consulter le docteur Ortscheid à son cabinet de Masevaux ainsi que l’explique aux gendarmes ce même 22 juillet 1894 Louis Sibre, 51 ans, cultivateur à Angeot : « Ma femme a été malade une bonne partie de l’année dernière. Elle était soignée par le docteur Ortscheid de Massevaux. Elle est toujours convalescente… De temps en temps, elle va encore à Massevaux consulter à son domicile ».
Ces consultations ne s’expliquent pas seulement par un sentiment de fidélité envers le médecin de famille. Divers témoignages montrent que le docteur Ortscheid est un praticien habile et compétent. Les autorités publiques en conviennent elles-mêmes : « Le docteur Ortscheid passe dans la contrée pour être très adroit. Il est de notoriété publique qu’il donne en son domicile à Massevaux de nombreuses consultations aux personnes des communes limitrophes d’Alsace » (7).
De tels agissements n’ont rien de répréhensible. Mais, pour son malheur, le docteur Ortscheid passe parfois la frontière et circule dans les villages autour de Lachapelle-sous-Rougemont. Ces déplacements, à l’exception de ceux en 1894 et 1895 pour donner des soins à Célestin Grisez, ne sont pas toujours à but médical. Le docteur Ortscheid aime à retrouver des paysages qui lui sont familiers ainsi que d’anciens malades qui lui ont gardé une profonde estime et qui lui témoignent à chaque rencontre des marques d’amitié comme l’explique Auguste Vilbois, 38 ans, marchand-quincailler à Lachapelle : « M. le docteur Ortscheid vient quelquefois chez mois (sic) lorsqu’il est de passage à Lachapelle. Nous sommes amis depuis longtemps. J’ai même travaillé chez lui il y a quelques semaines et pour ces motifs il vient me dire bonjour de temps en temps mais il n’est jamais venu chez moi comme docteur ».
Le 23 octobre 1897, autre témoignage, celui d’Auguste Vernier, 65 ans, rentier à Lachapelle : « Il est exact que M. Ortscheid est entré chez moi… Aujourd’hui, vers 3 heures et demi, je me trouvais sur ma porte quand j’ai aperçu ce docteur qui passait. Alors à titre d’amitié seulement et non pour lui demander une consultation n’ayant pas de malade, je me suis approché de lui pour lui serrer la main et l’ai prié d’entrer chez moi un instant, ce qu’il a fait ».
Quelquefois, des villageois tentent de profiter de ces visites de courtoisie pour aborder leurs problèmes de santé. Mais le docteur Ortscheid n’ignore pas la loi du 30 novembre 1892 et n’entend pas pratiquer des actes qui pourraient le faire taxer d’exercice illégal de la médecine. À chaque demande, il répond de manière détournée mais toujours plaisante. Ainsi en est-il pour Auguste Poirot, 75 ans, cultivateur à Lachapelle : « …je me trouvais assis devant chez moi lorsque le docteur Ortscheid est venu à passer… J’ai profité de cette entrevue pour lui dire que j’étais malade et ce qu’il en pensait. Il m’a répondu que j’avais 25 ans de trop et ne m’a ordonné aucun médicament ».
Autre témoignage, celui de Joseph Bidaine, curé de Felon, qui souffre d’une affection au larynx depuis plusieurs années : « … ce docteur (le docteur Ortscheid), étant de passage à Felon, est venu me dire bonjour. Il m’a demandé comment j’allais. Après lui avoir répondu, il m’a dit d’éviter de chanter autant que possible lorsque je ressentirais du mal au larynx ».
(La suite dans : Une affaire d’exercice illégal de la médecine…, par Francis PEROZ, page 2)
Le théâtre de Giromagny au début du siècle
Jusqu’à la première guerre mondiale, l’animation culturelle dans nos villages n’était pas le souci dominant. Et les longues journée de travail ne permettaient pas des réunions en soirée prolongées ou fréquentes. Certes existaient des sociétés de musique, de gymnastique, de préparation militaire ou de tir mais on ne peut dire que leur but était proprement culturel.
Ce fut souvent dans le cadre paroissial, sous la direction de prêtres cultivés et dynamiques, qu’apparurent des troupes théâtrales d’amateurs. Au début du siècle, la Société immobilière de Giromagny fit acquisition d’un terrain d’une trentaine d’ares et construisit en 1903 une salle de spectacles dite salle de l’Union Ouvrière et aujourd’hui salle du Foyer.
Le répertoire proposait des pièces récréatives, assez courtes, genre comique troupier, souvent jouées en complément d’une oeuvre plus importante, à résonance patriotique le plus fréquemment.
Parmi les titres dont les très anciens se souviennent : « Jeanne d’Arc, Michel Strogoff, Coeur de Française, la Liberté, Wissembourg, etc … ». La nation vivait encore dans le deuil de la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine et les drames traitant de la guerre 1870-1871 étaient fort appréciés. Mais la fierté nationale n’admettait pas l’impéritie du commandement ou la non-préparation militaire comme causes de la défaite : tout était mis sur le dos d’espions et encore plus de traîtres ! Et il est hors de doute qu’au sortir de telles représentations, les jeunes gens étaient prêts à mettre la baïonnette au canon et à marcher vers la frontière au premier ordre.
La passion
La pièce la plus prisée était d’un autre domaine . La Passion, pour laquelle avait été spécialement construite la salle, fut représentée en 1906 et 1907. Elle durait quatre heures et attira à Giromagny des spectateurs des villages voisins et même de plus loin, qui arrivaient de Belfort par le train en début d’après-midi. La pièce était précédée de scènes bibliques : Adam et Eve chassés du paradis terrestre ; Caïen tuant son frère Abel et le désespoir de Caïn ; le sacrifice d’Abraham ; Joseph vendu par ses frères ; les adieux du jeune Tobie à sa mère… Le journal hebdomadaire, La Croix de Belfort, reprenant un article de l’Eclair Comtois, en parle à plusieurs reprises. La pièce était l’oeuvre de Monsieur Joseph Guilloz, frère d’un vicaire, drame spécialement composé pour les acteurs de Giromagny ; les décors d’un abbé Pilot « dont le pinceau désintéressé et discret a donné un si ravissant cachet local aux toiles de la scène ». Malheureusement, les photos de l’époque, en noir et blanc, ne permettent pas d’en juger. « Il fallait environ soixante acteurs ; on les trouva parmi les membres de l’Union Ouvrière. Il fallait autant de costumes ; des personnes généreuses et habiles fournirent l’étoffe et la façon ». Quant aux décors, accessoires, objets, armes, ils étaient fabriqués par des artisans locaux, ou bien on utilisait ce que l’on possédait et qui avait déjà servi dans d’autres pièces. Le centurion romain brandit non un glaive, mais une latte de dragon ou de cuirassier, son casque appartient à la même arme. Si certains acteurs portent des sandales, d’autres ont gardé leurs bottines de ville. Mais la foule ne s’attardait pas à ces détails : elle vivait le drame et c’était un véritable acte de foi et une démarche religieuse plus qu’un spectacle.

À cette époque, les rôles féminins étaient tenus par des hommes ou des adolescents. Il leur fallait donc raser les moustaches que l’on portait alors, ou les dissimuler sous un maquillage approprié. Ainsi mon père, âgé de vingt ans, interpréta le rôle de la Vierge et un de ses amis celui de Marie-Madeleine. « Les premières représentations destinées aux seuls habitants de la paroisse attirèrent tout le voisinage et la vaste salle se trouva trop étroite pour recevoir les spectateurs accourus de tous côtés, bien qu’il ne fut fait aucune réclame. C’est que, réellement, ils méritent…
(La suite dans : Le théâtre de Giromagny au début du siècle, par Jean DEMENUS, page 7)
La région sous-vosgienne à la veille de la Révolution
La situation de la France à la veille de la Révolution est celle d’un Etat pauvre dans un pays riche.
De 1726 à 1789, la France jouit d’une partaite stabilité monétaire. L’économie est prospère : les échanges intérieurs s’épanouissent, grâce à l’amélioration des transports, nous avons d’ailleurs le plus beau réseau routier d’Europe. Belfort est une plaque tournante internationale. La chaussée du Ballon d’Alsace édifiée à grands frais de 1751 à 1760 est une véritable prouesse des ingénieurs de l’époque.
Peuplée de près de 27 millions d’habltants, soit proportionnellement plus qu’aucun autre pays européen avec un niveau de vie égal, forte de ses territoires d’outre-mer (St Plerre et Miquelon, St Domingue, la Martinique, la Guyane, l’Ile de France, I’Ile Bourbon, les cinq Comptoirs de l’Inde…) consciente de son prestige culturel avec une langue utilisée dans le monde entier, la France n’a qu’un point faible : ses finances, La Guerre d’Amérique (1776) a été un gouffre financier, treize années plus tard l’Etat ne s’en est pas encore remis. Au printemps de 1789, la mauvaise récolte de céréales de 1788 et le terrible hiver 1788-89 provoquent une flambée des prix.
Cette crise économique conjuguée avec une crise financière et politique allait accoucher d’une Révolution que pourtant personne ne souhaitait.
Une organisation administrative restée féodale
1) La seigneurie du Rosemont
Constituée entre 1024 et 1030 par le comte de Montbéliard Louis de Mousson, elle fait en 1789 partie du Comté de Belfort, dont elle est le quatrième district, les trois autres étant ceux de Belfort, d’Angeot et de l’Assise, divisée en deux parties d’inégale grandeur.
L’une, le Haut-Rosemont, comprenait à la veille de la Révolution les 20 villages suivants : Anjoutey, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Bourg, Chaux, Eloie, Etueffont-Bas, Etueffont-Haut, Evette, Giromagny, Grosmagny, Lachapelle-sous-Chaux, Lamadeleine, Lepuix-Gy, Petitmagny, Riervescemont, Rougegoutte, Sermamagny, Valdoie et Vescemont.
L’autre, le Bas-Rosemont, regroupait deux Mairies : celle d’Argiésans (Argiésans, Banvillars, Urcerey) et celle de Vézelois (Vézelois, Méroux).
2) La seigneurie de Rougemont
Les possessions de Thierry I de Montbéliard furent croit-on partagées entre 1103 et 1125 entre ses deux fils : Frédéric et Thierry II. Le premier devint comte de Ferrette avec la possession de toute la partie est du Territoire de Belfort actuel, le second conservant le reste de l’héritage paternel avec entre autre la seigneurie du Rosemont. En 1730 le comte Conrad Alexandre de Rothenbourg, seigneur de Masevaux annexe à son profit la seigneurie voisine de Rougemont dont le dernier possesseur le maréchal d’Huxelles vient de mourir sans héritiers. Désormais les deux domaines ont un sort commun jusqu’en 1789 mais n’en demeurent pas moins distincts.
Le siège du baillage et du greffe est fixé à Masevaux où, théoriquement réside le seigneur. En 1789 la seigneurie de Rougemont regroupe : Bessoncourt (en partie), Denney, Eguenigue, Felon, Lacollonge, Leval, Menoncourt, Petitefontaine, Phaffans (en partie), Romagny, Roppe, Rougemont, Saint-Germain et Vétrigne.

3) Les fiefs particuliers
Ils sont au nombre de quatre dans la zone sous-vosgienne : Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Rougegoutte, Grosmagny, Lachapelle-sous-Rougemont.
La province Alsace
En 1789 la zone sous-vosgienne et ses 27 villages dépendaient de la province d’Alsace rattachée à la couronne de France en vertu du traité de Munster de 1648. L’Alsace était l’une des 34 provinces qui composaient la France d’alors. Sa situation restait complexe.
Trois autorités se partageaient le pouvoir :
- le commandant militaire,
- le conseil souverain,
- l’intendant.
1) Le commandant militaire
Il détenait l’autorité sur les troupes cantonnées dans la Province et assurait la garde du pays. Il était chargé de l’entretien des forteresses telles Belfort, Huningue, Neuf-Brisach, Strasbourg, Wissembourg etc.
L’effectif des garnisons d’Alsace se montait à près de 24000 soldats de métier, auxquels il fallait ajouter la milice provinciale fournie par les communautés (1440 hommes) récrutée par tirage au sort parmi les garçons et veufs sans enfants de 1B à 40 ans pour effectuer un service de six ans.
Le passage des recruteurs de la milice dans les villages donnait lieu chaque année à des contestations souvent légitimes.
2) Le Conseil souverain
Fondé en 1657, il siégeait à Colmar et jouait un rôle comparable à celui des autres Parlements du Royaume, avec des attributions à la fois judiciaires, politiques et administratives.
il enregistrait les édits royaux et les patentes obtenues du roi par des particuliers… Il décidait et jugeait en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles de l’Alsace.
Les baillis des différentes Seigneuries qui jugeaient en premier ressort étaient tous « gradués » et avocats au Conseil souverain de Colmar. Ils étaient désignés par les seigneurs et révocables par eux, mais leur nomination devait être examinée et enregistrée par le Conseil souverain.
3) L’intendant
Il était nommé directement par le roi. Le dernier en poste de 1778 à 1790 Mr de Chaumont de la Galaizière était assisté de plusieurs subdélégués, huit en tout ; celui de Belfort s’appelait Jean Henri de Belonde. Les subdélégués étaient chargés de la police administrative et de la surveillance des travaux publics ainsi que des corvées royales.
Les impôts
Ils étaient nombreux et variables d’une province à l’autre. Nous distinguerons : les impôts royaux et les impôts seigneuriaux.
1) Les impôts royaux se divisaient en redevances fixes et redevances variables dont le montant était déterminé chaque année en fonction des besoins. Ils étaient inégalement répartis et pesaient lourdement sur les paysans qui à cette époque formaient l’immense majorité de la population. A noter cependant que l’Alsace ne payait pas de gabelle au roi, le sel s’y vendait librement.
En 1787, par exemple les charges royales auxquelles étaient assujettis les bourgs et villages sous-vosgiens se subdivisaient en :
a) impôt sur les personnes (la taille)
b) impôt sur I’industrie, le commerce, l’artisanat
c) impôt foncier (le cens)
d) impôt extraordinaire
e) la corvée royale
Giromagny, cette même année 1787 était imposé pour 925 livres, Rougemont pour 459 livres alors que Lamadeleine ne payait que 98 livres. La corvée royale permettait l’entretien du réseau routier, des ponts, l’aménagement des cours d’eau etc. Chaque année, les beaux jours revenus, les villages devaient fournir un certain nombre de bras pour l’exécution de grands travaux d’utilité publique. En 1751-53, la construction de la route du Ballon d’Alsace mobilisa plus de 200 villages. Il était alors possible d’échapper à la corvée moyennant une redevance par tête et par jour de 12 sols.
2) Les Impôts seigneuriaux
Ils comprenaient : la taille, la corvée, la dîme, l’umgeld (sur les débits de boissons), le débit de sel, les banalités (moulins, boucheries, etc.). A titre d’exemple, la plus petite seigneurie de la zone sous-vosgienne, celle d’Auxelles-Haut, arrogeait à son propriétaire, le duc de Wurmser en 1782 les droits suivants :
- la basse justice,
- le droit de nommer un maire,
- les amendes jusqu’à la concurrence de 4 livres,
- le droit de chasse et pêche
- la dîme de toutes les espèces de grains et fruits au dixième,
- le droit d’acenser tous les pâquis et communaux mis en culture,
- les corvées à raison de sols deniers,
- une rente foncière de 33 livres 6 sols par an, de laquelle les héritages des habitants sont chargés
pour les tailles et cens, - le batz (taxe sur les maisons de mineurs) à raison de 2 sols 1 deniers par chaque ménage,
- une rente de 5 quartes de seigle sur le moulin possédé par J-Baptiste Hansbergue…
Les maires
Ils sont dans les communautés les représentants du Seigneur haut justicier au même titre que les baillis le sont dans tous les villages des seigneuries de Rosemont et Rougemont. Les bas justiciers d’Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Rougegoutte, Lachapelle-sous-Rougemont donnent également à leurs représentants la qualification de maires, maix ceux-ci, dont l’autorité est bornée dans les villages aux seuls sujets de la basse justice, ne jouissent d’aucun des privilèges et franchises attribués à cette classe d’officiers par les usages généraux d’Alsace. Or, parmi ces privilèges, les plus estimables consistaient en certains honneurs qui leur étaient réservés dans les églises en l’absence du seigneur, par exemple : bancs ou stalles dans le choeur, présentation du goupillon par le prêtre au début des offices etc.
Les maires sont exemptés de la « taille », des corvées et autres prestations envers le domaine seigneurial mais ne reçoivent aucune rémunération en argent.
La charge de maire est « vénale » le postulant doit payer une coquette somme d’argent au seigneur et lui fournir un certificat de « bonne vie et moeurs ». Un cas typique, celui de Claude Jacques Simon de Lepuix-Gy. Nommé en 1750, il réussit grâce à sa servilité envers la famille de Mazarin à conserver sa charge jusqu’à la suppression de la fonction en décembre 1789.
Le maire seigneurial trouve ses émoluments dans l’affranchissement d’impôt. Il a pour mission essentielle de :
- surveiller l’administration des biens communaux,
- veiller au maintien dans le village de l’ordre et de la police sous la direction hiérarchique du bailli,
- autoriser les réunions des jurés, bourgeois et habitants,
- recueillir et porter au siège de la seigneurie les tailles, dîmes, redevances ou autres impôts,
- fournir annuellement aux receveurs seigneuriaux l’état exact, fidèle et complet de tous les corvéables …,
- vérifier la qualité des denrées comestibles et viandes …
Le pouvoir central est, quant à lui, mais uniquement dans les villages de quelque importance, représenté par un maire royal nommé directement par l’Intendant.
Souvent d’ailleurs les charges de maire royal et seigneurial sont exercées par la même personne, surtout après la réforme municipale de 1787. Le morcellement seigneurial donnait lieu parfois à des situations cocasses comme à Lepuix-Gy où au début du XVIIIème siècle on ne recensait pas moins de quatre maires différents : le maire royal et ceux des familles Mazarin, Reinach et Ferrette.
La population
La France féodale est divisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. Mais cette répartition simpliste rend mal compte de la complexité de la société en 1789.
Dans la zone sous-vosgienne la noblesse n’est représentée que par sept familles :
- le duc de Valentinois,
- les barons de Ferrette,
- les barons de Reinach-Roppe,
- les barons de Reinach-Hirtzbach,
- les barons de Wessemberg,
- le prince de Broglie,
- le duc de Wurmser.
Le bas clergé, en l’occurence les curés de campagne et leurs vicaires vivant au contact du peuple
regroupe à peine…
(La suite dans : La région sous-vosgienne à la veille de la Révolution, par François LIEBELIN, page 7)
La guerre de 1870 au pied des Vosges
À partir de novembre 1870, le plus dur des combats, dans notre région, s’est concentré autour de Belfort dont le siège a commencé le 7 novembre. Le passage de l’armée d’invasion à travers les villages vosgiens a gravement perturbé l’existence des habitants, au moins pendant le mois de novembre 1870.
Deux documents, le registre des délibérations du Conseil municipal de Rougemont-le-Château et le Journal du convent de religieuses de Saint Nicolas ont rapporté les événements, Les extraits qui suivent sont affectés d’un * pour le registre de la municipalité et de ** pour le Journal du couvent.
La guerre est déclarée le 14 juillet 1870. Le Conseil ouvre une souscription pour l’aide aux blessés. Mais six semaines plus tard, c’est le désastre de Sedan. Le registre municipal résume la situation en trois lignes :
*Installation du nouveau Conseil qui jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur. Annulé pour cause de changement de gouvernement (4 septembre).
**Saint Nicolas reçoit la visite de M. Keller qui est venu en Alsace organiser une armée pour défendre le Haut-Rhin (12 septembre).
*Les établissements industriels de la commune sont à la veille d’être fermés par suite de l’approche de l’ennemi, d’où l’impossibilité de recevoir ou d’expédier les matières premières nécessaires à leur marche et nécessité de venir au secours de malheureux sans travail, soit 500 ouvriers domiciliés sur la commune. Ils seront réduits à la plus grande misère d’ici quelques jours.
Le Conseil vote un crédit de 4.000 F pour l’achat de denrées alimentaires (15 septembre).
** Les Prussiens sont entrés à Colmar ; ils ont rançonné la ville et mis un préfet prussien.
Panique à Rougemont ; tout le monde se sauve dans les montagnes avec des voitures chargées de tout leur ménage. Un pauvre homme, berger de moutons du village de Fontaine, a amené tout son troupeau de 150 à 200 moutons à Saint Nicolas et nous a demandé l’hospitalité pour son troupeau dans la basse-cour. Le lendemain, il nous a donné un mouton en reconnaissance.
À Rougemont, tout le monde est dans l’agitation et l’inquiétude. Les Prussiens sont à Mulhouse.. »J’ai voulu les voir de mes yeux, nous assure un témoin, j’ai voulu voir ce que c’était qu’un Prussien. Je les ai vus, sur des chevaux écumants, avec des armes aux deux mains, prêts à tirer » (16 septembre).
Les Prussiens sont arrivés à Sentheim. Ce matin, plusieurs boulets et éclats d’obus sont tombés à Rougemont où il y a eu un homme tué, une maison brûlée et, au moment où tout le monde était à l’église pour la messe des Morts, on a entendu des obus siffler au-dessus de l’église. Mr le Curé a poursuivi sa messe. L’ennemi s’est dirigé sur Etueffont, où ils ont sommé le curé et le vicaire de les suivre, sans leur dire pourquoi. Entre Etueffont et Grosmagny, il y a eu un petit combat, où il y a eu vingt Mobiles tués et plusieurs blessés. On ne sait pas combien les Prussiens ont perdu : ils ont caché leurs morts. Les chefs prussiens ont prié ces messieurs d’enterrer leurs morts et d’aller eux-même prévenir le curé de Grosmagny. Les Prussiens, les prenant pour des fuyards, leur ont tiré dessus ; l’abbé a eu le corps traversé d’une balle. La blessure a été jugée mortelle par le chirurgien prussien : il ne passerait pas la journée. Nos soeurs sont allées le voir et l’ont trouvé plein de résignation.
Mr l’abbé de Rougemont a failli être tué par les Prussiens pour avoir un peu écarté le rideau de sa fenêtre pour regarder. Ils sont entrés dans la cure et l’abbé leur a
servi à boire. Ils ont été généralement polis. Ils ont dit qu’ils voulaient brûler la maison de Mr Keller, qu’ils disaient être le chef des francs-tireurs (2 novembre). (C’est le 2 novembre qu’a eu lieu l’escarmouche du Champ des Fourches, près de Rougemont, où neuf francs-tireurs furent tués. Nos deux documents ne la signalent pas).
*Le mardi 2 novembre, les chefs de l’armée prussienne, de passage à Rougemont, ont requis les autorités de la commune de leur livrer sans délai tous les fusils délivrés à la garde nationale et aux sapeurs-pompiers. Il a été impossible de réunir tous les fusils demandés : il en manquait dix. Nouvelle sommation des Prussiens, ou versement d’une somme de 1000F en espèces, dans le délai de cinq minutes…
Le 5 novembre, réquisition de livrer dans les trois heures : 6 boeufs, 750 litres de vin, 200 doubles de pommes de terre, tout l’orge et l’avoine du village, 100 kilos de pain, 200 kilos de farine, 10 kilos de café, 15 kilos de sel, plus quatre fourneaux de fonte avec leurs tuyaux (5 novembre)… Sept Uhlans arrivent à bride abattue à Saint Nicolas. Et nous trouvons ces hommes, renommés pour leur brutalité, doux comme des agneaux. Ils demandent du lard et du vin. Comme on n’en a pas, ils se contentent de fromage et ils reprennent le chemin de Rougemont en remerciant mille fois de notre accueil. Ils étaient 4.000 à Rougemont ; le temps était très mauvais et toutes les maisons étaient remplies… Le soir, à sept heures, on frappe à notre porte : ce sont de nouveaux Prussiens qui demandent à manger ; ils sont aussi modérés que les premiers. Ils racontent qu’ils sont des pères de lamille et qu’ils passent des nuits blanches à penser à leurs enfants. L’un d’eux demande à voir nos orphelines qui lui rappelleront ses enfants, qui, eux aussi, sont orphelins (15 novembre) !
*Réquisition pour loger et nourrir pendant deux jours un bataillon de l’armée prussienne. Qu’à cet effet, les habitants doivent fournir et livrer immédiatement : 450 kilos de viande et 400 doubles de pommes de terre, pour la subsistance de ce bataillon qui compte 900 hommes et 50 chevaux.
Or, déjà, la commune a dû recevoir 4000 hommes et 400 chevaux pendant deux jours et les ressources sont épuisées. Cependant, aux environs du village, il y a plusieurs fermiers qui n’ont supporté aucune des charges que le passage des troupes nous impose. Il serait juste de les requérir (17 novembre).
Le 2 novembre, les Prussiens ont emmené le maire Heidet comme prisonnier, lui ont fait subir un dur traitement et passer en conseil de guerre.

(La suite dans : La guerre de 1870 au pied des Vosges, par Etienne KELLER, page 21)
Un homme de conviction
Jules Heidet – 1894-1944
Les collégiens de Rougemont comme les écoliers de la Vieille Ville de Belfort connaissent le nom de Jules Heidet mais en savent-ils beaucoup plus ?
Personnalité marquante de la vie politique locale entre les deux guerres, il assume un rôle important dans la Résistance de 1940 à 1943 mais les règles de la clandestinité rendent la description plus difficile. Durant ces deux périodes, ll apparaît comme un homme de conviction, et c’est ce qui frappe tous ceux qui l’ont connu.
Une activité intense de 1914 à 1940
Né le 16 juin 1894 à Rougemont-le-Château, fils de paysans, arrière petit-fils d’instituteur, aîné de neuf enfants, il fait des études primaires à Rougemont et entre en 1910 à l’Ecole Normale, il est nommé à Montreux-Château. Mobilisé en 1914, il participe entre autre aux batailles de Verdun et de la Somme. Son attitude courageuse lui vaut plusieurs décorations. Il gardera toute sa vie les séquelles des blessures reçues et notamment un blocage de la mâchoire. C’est à Rougemont qu’il revient comme instituteur en 1917, épouse Amélie Tritter également institutrice, en 1919, et devient directeur de l’école de 1927 à 1933.
Est-ce de cette période que date son engagement à gauche ? Il est difficile de l’affirmer. Mais il est sûr en revanche que cet engagement ne se démentira jamais. Membre de la S.F.I.O. dès 1920-21 au moins, il prend une part active à la vie politique rougemontoise lors des campagnes électorales particulièrement « chaudes » des années 30. Les querelles suscitées par les lois de Séparation de l’Église et de l’État sont loin d’être calmées : instituteur laïc, assurant des cours pour adultes, participant aux activités de la Semeuse, il est le symbole d’un camp. C’est à ce titre qu’il attire les « foudres » du curé Chiron.
Devenu directeur de l’école de la Place des Bourgeois en 1933, fonction qu’il exercera jusqu’en 1943, il continue à Belfort le même type d’activités. Il est en 1935 secrétaire de la section départementale du Syndicat national des Instituteurs, trésorier de l’Union syndicale C.G.T. et appartient à la commission exécutive de la S.F.I.O.
Pendant les grandes grèves qui éclatent à la suite de la victoire du Front Populaire, il assume un rôle d’arbitre entre les pouvoirs publics et les ouvriers lors des discussions des contrats collectifs. Parallèlement il anime l’Association de Défense laïque qui oeuvre en faveur de l’éducation populaire en organisant des conférences sur des thèmes variés.
Il évolue donc dans des milieux particulièrement inquiets devant la montée du fascisme et du nazisme.
Ceci, joint à la haute idée qu’il se fait de la République, de la liberté et de la morale permet de comprendre la précocité de son engagement après la déclaration de guerre et la débâcle alors que d’anciens amis, pourtant marqués à gauche comme Ludovic Oscar Frossard, affirment des sympathies vichystes marquées.
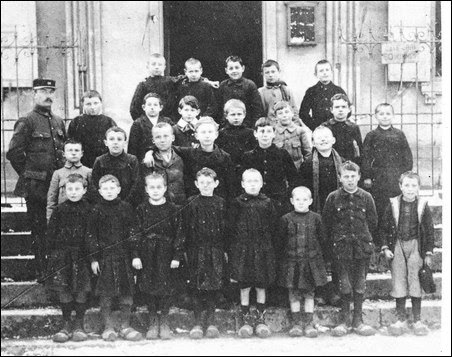
La clandestinité
Pressé par sa fille de quitter Belfort pour gagner l’Angleterre, il lui fait part dès 1940 de sa volonté de faire quelque chose sur place. Sa profession, ses responsabilités politiques et syndicales et notamment les contacts noués lors des congrès du S.N.I. lui donnent une position clé. Il les fait jouer dès l’automne 1940 mais il est difficile de préciser davantage ce que sont ses activités à une période où les réseaux de résistance ne sont pas encore très organisés. M. Erb, chargé de la direction des Ecoles à la mairie de Belfort dès avant la guerre et devenu ami de Jules Heidet, se souvient qu’en 1941 celui-ci lui demandait à l’occasion des renseignements sur telle ou telle personne, mais que ce n’est qu’à la longue qu’il lui fit part de l’utilisation qu’il en faisait pour ses activités résistantes.
L’Occupation se prolonge, le conflit s’étend et l’invasion de l’U.R.S.S. en juin 1941 entraÎne l’entrée en résistance d’un parti communiste déstabilisé jusque là par le pacte germano-soviétique : il fonde un mouvement, le Front national, qui accueille également des non-communistes, ce qui est le cas de Jules Heidet. Secrétaire du mouvement au plan local, il participe à la rédaction et à la diffusion des journaux clandestins (le matériel de polycopie est camouflé dans le grenier de l’école). La mise en place du S.T.O. en Février 1943 provoque le passage dans la clandestinité de nombreux jeunes gens. La zone sous-vosgienne abrite ainsi quelques maquis qui doivent avant tout régler le problème du ravitaillement. Les instituteurs, souvent secrétaires de mairie, M. Erb à la mairie de Belfort, sont souvent sollicités par…
(La suite dans : Un homme de conviction, par Dominique DATTLER, page 25)
Les homicides dans la région sous-vosgienne pendant la domination autrichienne
La région sous-vosgienne ne compte pas à ce jour d’études complètes sur les homicides. Pour les siècles les plus reculés, les sources font défaut pour en dresser les traits généraux. Pourtant, quelques dossiers épars nous permettent de prendre conscience de ce phénomène à la tin de la domination autrichienne (fin XVIème – début XVIIème siècle). L’administration des Habsbourg – qui ont dominé la trouée de Belfort du XVIème au XVIIème siècle – a conservé méticuleusement dans ses archives les recours en grâce, les enquêtes menées sur les homicides. Une dizaine de dossiers concernent la région sous-vosgienne. Ils nous permettent de revivre ces drames qui ont marqué nos ancêtres.
Nous avons retrouvé onze dossiers relatant des homicides dans les seigneuries du Rosemont et de Rougemont-le-Château. Dix proviennent du fonds de la Régence autrichienne d’Ensisheim, et un des archives du comté de Belfort. Tous ces documents sont conservés aux Archives départementales du Haut-Rhin à Colmar. Les affaires criminelles ont bien sûr été plus nombreuses. En 1564, Jean Ulric de Stadion, grand bailli de Belfort, envoie à la Chambre d’Ensisheim des informations sur six homicides commis cette année-là dans la vallée du Rosemont. Il écrit une deuxième fois le 12 août 1564, s’étonnant de n’avoir reçu aucun ordre pour punir les meurtriers « dont la plupart sont devenus fugitifs » .
Cette criminalité de 1564 est exceptionnelle. Nous pouvons peut-être la rattacher à un épisode grave qui s’est déroulé cette année-là. Il est rapporté par François Liebelin dans son ouvrage sur les mines du secteur de Giromagny. Au printemps, les paysans du Rosemont, excédés contre les mineurs de langue germanique qui affluent dans la région, mettent le feu aux baraques des mineurs du village neuf de Giromagny. Or, nous avons la preuve que les auteurs des six homicides sont des agriculteurs. Dans sa lettre à Ensisheim, Jean Ulric de Stadion demande en effet la saisie « de tous les grains que les meurtriers ont engrangés ». ll est donc probable que l’incendie ait été suivi – ou précédé – d’un combat entre les deux communautés, aboutissant à la mort de six mineurs. Les victimes peuvent également avoir péri dans l’incendie des baraques. Ces homicides, pour lesquels nous ne possédons qu’une mention, n’ont pas été intégrés dans nos statistiques. Celles-ci se limitent à onze cas mieux connus.
Tué à coup de pioche
Il semblerait que seuls cinq villages sous-vosgiens aient été le théâtre de ces drames : Rougemont-le-Château (trois homicides), Lepuix-Gy (deux), Rougegoutte (deux), Etueffont (deux) et Evette (un). Les meurtriers sont quant à eux tous originaires de la région. Nous dénombrons un cabaretier, un meunier, trois employés des mines et un valet. Dix sont des hommes, deux des femmes. Ces personnes sont issues d’une couche sociale que nous qualifierons de moyenne.
Trois de ces onze homicides sont vraisemblablement accidentels. François Perrey de Soda (Lepuix-Gy) assomme un mineur en janvier 1563 ; ce dernier meurt peu après. En 1583, Jacques, meunier de Rougegoutte, fils de Deyle Oriel, assomme d’un coup de pioche le mineur Stoffel Gottzar, âgé de 24 ans; il meurt quelques jours plus tard. Il s’agit certainement d’une dispute qui a dégénéré. Le déroulement des faits est peut-être analogue, le 20 février 1611 à Lepuix-Gy, pendant les fêtes de Carnaval. Deux jeunes gens, Balthazard Briqueler et André Mathis, tuent au cours d’une bagarre un dénommé Hugues Didier. Il s’agit d’une grosse bêtise de gamins que leurs parents, maîtres-fondeurs à Soda, s’efforceront de réparer.
Étranglé dans son sommeil
Trois meurtres semblent avoir été commis avec préméditation. Ce sont des règlements de comptes conjugaux. En 1618, Sébastien Christ de Rougemont tue sa femme. Le 1er avril 1572, Barbe Devaux assassine son mari, vitrier à Etueffont. En 1578, l’épouse de Petitjean Pigenat de Rougemont, aidée de son valet, profite du sommeil de son mari pour l’étrangler avec deux bâtons liés entre eux. Pour ce dernier cas, la prudence s’impose. Nous ne possédons pas les pièces du procès. L’épisode est rapporté en 1605 par Jean Conrad Gsell, seigneur de Rougemont, en conflit avec la famille Pigenat. Cette dernière l’accuse de lui avoir volé un étang. Gsell veut rappeler le passé des plaignants en évoquant ce meurtre de 1578. Pourtant, le châtelain n’était pas un modèle de sainteté : en 1598, il fut excommunié pour avoir frappé un prêtre.
Une fois les homicides commis, la justice s’empare de l’affaire. Si les mineurs sont concernés, plusieurs juridictions peuvent intervenir, mais la justice du bailliage a préséance sur la justice des mines, comme le précise l’ordonnance de l’archiduc Ferdinand II, rédigée le 20 août 1562 : « Quand il y aura des présomptions suffisantes sur un criminel dépendant de la juridiction des mines, le magistrat de la ville ou du pays pourra l’arrêter sans en être empêché par les officiers des mines. Si les preuves retenues contre lui sont insuffisantes, il sera renvoyé à…

(La suite dans : Les homicides dans la région sous-vosgienne…, par Christophe GRUDLER, page 26)
Il y a 100 ans !
Les élections législatives de 1889 ont marqué la fin du boulangisme. La République en sort raffermie et devient en quelque sorte le régime idéal de la Nation Française. Ce retour à un certain calme politique n’empêche cependant pas les questions sociales d’arriver au premier plan de l’actualité.
Épidémie
Début janvier 1890 « l’influenza », autrement dit la grippe, sévit avec une rare violence. Le 5 janvier on compte déjà plus de vingt cas à Auxelles-Haut. A Belfort, plus de la moitié de la population est atteinte. Dans les casernes de la Place c’est l’hécatombe : déjà plus de 400 hommes alités ! A la Société Alsacienne, 350 employés sont touchés. Les journaux ont grand peine à être imprimés. A la poste et au téléphone, on est obligé de faire appel à du personnel journalier pour assurer le service.
Afin d’éviter un affolement de la population, le Journal Officiel publie un rapport qui se veut rassurant.
Prenant exemple sur les épidémies qui frappèrent le pays en 1733, 1743 et 1762, et qui firent de nombreuses victimes, ce rapport affirme que seuls les vieillards, les pneumoniques et les indigents en sont morts, et conclut ainsi : « la maladie ne devrait avoir de conséquences graves pour les personnes habituellement en bonne santé, que si ces dernières persistent dans leurs occupations et s’exposent au froid ».
« A quelque chose malheur est bon » dit le proverbe. C’est ainsi qu’un grand magasin de confection du faubourg de France à Belfort, le Pont neuf, propose des « étrennes utiles » et libelle ainsi sa publicité :
« Couvrez-vous soigneusement la tête et le cou avec casquettes en fourrure et foulards de soie pour éviter l’influenza ! »
La croix
Le 1er février 1890 naît La Croix de Belfort, supplément local du journal parisien La Croix. Un journal républicain s’empresse de dire que cette nouvelle parution catholique compte « parmi les publications dont les rares exemplaires sont fatalement destinés à être transformés, avant lecture, en papier d’emballage. »
Pourtant La Croix de Belfort est, d’entrée, tirée à 2.000 exemplaires dont 1.983 numéros sont vendus dès le deuxième mois de publication !
Humour noir
Un désespéré, résidant à Angeot, n’en finit pas de mettre fin à ses jours …
En deux semaines, il a tenté quatre fois de mourir :
- il veut d’abord se trancher la gorge avec un rasoir, mais n’y parvient pas,
- dès le lendemain, il se jette à l’eau mais ne peut se noyer (manque d’eau ou secouru in extremis ? L’histoire ne le dit pas),
- il essaie ensuite de se pendre mais sans « succès »,
- il tente alors de s’ouvrir le ventre en s’appuyant sur la pointe eflilée d’un couteau, mais une fois encore, la mort ne veut pas de lui.
Dans son édition du 16 mars, La Croix de Belfort nous assure que le pauvre homme est « enfin » parvenu à ses fins :
« Sa nièce ne le voyant pas sortir de sa chambre, le trouve assis, appuyé sur la table, la gorge ouverte à l’aide d’un couteau qu’il tient encore à la main. Il aura cependant encore la force de se coucher dans son lit. »
Pourtant le correspondant du journal cultive encore (inconsciemment ?) le suspense : « Tous les soins prodigués ont été impuissants à le sauver » et plus loin : « depuis 36 heures, il est râlant et au moment où je vous écris, il n’a pas encore rendu le dernier soupir… »
Quoi qu’il en soit, la morale est sauve :
« Pendant sa vie, l’homme s’est toujours déclaré l’ennemi des prêtres mais il a fait appeler un curé et a reçu les derniers sacrements ! »
L’heure, c’est l’heure
Dans son édition du 2 mars, le journal La Frontière nous apprend que le maire de Lepuix-Gy vient de décider que sa commune allait désormais vivre à l’heure de Paris (voir encadré). Une décision très contestée par la presse conservatrice, telle La Croix de Belfort, qui commente avec une certaine ironie : « Comme il n’existe pas d’observatoire astronomique à Lepuix, on se demande si l’horloge de la commune sera réglée d’après le chronomètre de Monsieur le Maire : nous pensons que ce dernier ne pourra moins faire que d’aller toutes les semaines chercher l’heure officielle à la préfecture. Nous croyons pouvoir dire que les habitants de Lepuix se soucient de l’heure de Paris comme d’une guigne et qu’ils préfèreraient voir…
(La suite dans : Il y a 100 ans, par François SELLIER, page 31)
Le passage des Vosges au 17ème siècle
La vision que les hommes ont du paysage qui les entoure ou qu’ils traversent est relative. Elle varie selon les hommes, bien sûr, mais aussi selon les époques. Les récits des voyageurs visitant notre région sont malheureusement rares, Ceux que nous possédons n’en ont que plus d’intérêt.
« Les mémoires de deux voyages et séjours en Alsace, 1674-1676 et 1681 » découverts et publiés au 19ème siècle ont acquis d’emblée une certaine notoriété, justifiée tant par la rareté de ce genre de témoignage que par la qualité du document. Le texte est le journal de voyage d’un jeune parisien qui signe l’Hermine mais s’appelle en réalité Lazare de la Salle. Nommé receveur général (responsable de la collecte de certains impôts) La Salle vient rejoindre son poste en 1674.
Durant son séjour, puis à l’occasion d’un second voyage en 1681, il consigne ses observations et ses réflexions principalement sur le sud de l’Alsace. L’originalité et la qualité du document viennent de ce que l’auteur cherche à comprendre le pourquoi des choses. Il n’hésite pas à se lier avec des provinciaux et, pour faciliter ses contacts, à apprendre l’allemand.
La Salle évoque brièvement la région sous-vosgienne et ses mines d’argent mais raconte plus longuement sa traversée des Vosges. Jusqu’à la deuxième moitié du 18ème siècle, le franchissement du massif vosgien au sud n’est pas impossible par le Ballon d’Alsace mais présente de grandes difficultés. Le passage a lieu normalement plus au nord par le col de Bussang. Cette voie permet la communication entre la Lorraine et l’Alsace et plus loin conduit à Bâle ou en Allemagne du Sud ; elle est notamment fréquentée par les lourds convois de sel lorrain et c’est elle qu’emprunte notre voyageur. Suivons-le à l’aube du 29 juin 1681 alors qu’il quitte Rupt-sur-Moselle.
Les anciens appelaient cette montagne Vogesus
« Le lendemain, fête de Saint-Pierre, nous partîmes bien matin, pour aller à Saint-Maurice, à trois lieues de là. L’église est bâtie sur une hauteur, et elle est si petite qu’il faut en laisser la porte ouverte, afin que ceux qui n’y peuvent tenir puissent au moins voir le prêtre à l’autel. Ce canton-là est environné de hautes montagnes, sur lesquelles nous vîmes encore des espaces d’un quart de lieue tout couverts de neige ; cependant, lorsque le soleil approche de son midi, il y fait une chaleur à rôtir, parce que ses rayons dardants à plomb et réfléchissant sur ces rochers, il semble qu’on y respire du feu au lieu de l’air. Mon guide, qui connaissait le pays, me montra une source d’eau minérale au-dessus du chemin à gauche : la curiosité me fit descendre de cheval, pour en goûter, mais elle sent si fort la rouille de fer qu’il n’est pas possible d’en boire ; on a revêtu les bords de cette fontaine de maçonnerie, et l’eau qui s’écoule par les pierres du devant les a teintes en couleur de rouille. J’ai vu dans cette même montagne de Vosges, du côté qu’elle regarde l’Alsace, d’autres eaux minérales, qui étaient fort claires et qui, au lieu de ce goût de fer rouillé, en avaient un aigret et assez propre pour se désaltérer durant les chaleurs de l’été ; les allemands les appellent sauerbrunner, c’est-à-dire fontaine aigre. Ce qu’il y a de commode dans cette route de montagnes, c’est qu’elle est fort peuplée ; on ne fait pas une demie lieue sans trouver quelque petit cabaret, et au pis aller on peut se rafraîchir à bon compte dans les eaux de la Moselle, qui ne parait plus qu’un ruisseau à mesure qu’on approche de sa source. Mon guide me la montra au pied de ces hautes montagnes ; elle sort de dessous un gros corps d’arbre pour aller se jeter dans le Rhin à Coblence après avoir baigné les rives de Metz et de Trèves. Après avoir passé Bussang, dernier village de Lorraine, la montée devient rude et droite entre deux hauts coteaux couverts de sapins, où le chemin n’a de largeur que pour le passage de deux chevaux. C’était ici un dangereux défilé durant ces dernières guerres : les paysans armés y avaient fait des retranchements avec de gros arbres et des pièces de roches, où ils arrêtaient les plus vaillants soldats et les faisaient périr dans ces malheureux détroits ; mais, grâce aux soins du roi, nous trouvâmes ce chemin bien débarrassé, bien rétabli, et même très agréable pour lors, puisque les sapins nous y mettaient à l’ombre de l’ardeur excessive du soleil. Étant parvenus au plus haut du chemin dans cette montagne de Vosges, nous vîmes la borne qui sépare les états de Lorraine d’avec l’Alsace, province d’Allemagne. Ensuite de quoi, nous ne fîmes plus que descendre durant deux bonnes heures, ce qui est fatigant pour les chevaux. Ces montagnes de Vosges séparent la Franche-Comté de la Lorraine ; puis, tournant à gauche, elles continuent leur enchaînure vers le septentrion jusqu’aux terres du Palatinat. Les anciens appelaient cette montagne Vogesus ou Vosagus mons, et les allemands l’appellent aujourd’hui Berg auf der Fürst. Après être descendus ce défilé de montagnes toujours à l’ombre, elles commencèrent peu à peu à s’écarter et à nous laisser jouir de la vue du ciel, et insensiblement nous entrâmes dans une gorge étroite et longue, dans laquelle nous trouvâmes un village dont on rétablissait encore les ruines que la guerre y avait causées ; ce village s’appelle Urbès. Mon guide y demanda le chemin à quelques paysans, mais on lui répondit que l’on ne l’entendait pas ; nous nous y arrêtâmes pour boire un coup et pour essayer si je me souviendrais bien encore de cette langue que je n’avais point parlée depuis plus de cinq ans. De là nous passâmes à Saint Emerich, petite ville que toutes les cartes nomment Saint Amarin, et continuant toujours de
marcher dans cette même gorge de montagne, nous avisâmes au bout de deux heures les ruines du château de Thann. »
(Le reste dans : Le passage des Vosges au 17ème siècle, par Philippe DATTLER, page 35)
Magazine
Le retour des bénédictins
En 1980, à la suite d’un legs pieux de Melle Briot, propriétaire du tissage qui porte son nom à Lepuix-Gy, six bénédictins créent un prieuré dans le village au lieu-dit Chauveroche.
La présence de religieux dans la région sous-vosgienne est très ancienne mais n’a pas donné lieu à la création d’établissements importants ou prestigieux comme dans les régions voisines.
Des abbayes et couvents ont possédé très longtemps des droits et quelques terres dans les villages sous-vosgiens. Ainsi, pour ne citer qu’eux, les cisterciens de l’abbaye de Lucelle (Suisse) nommaient les prêtres desservant les églises d’Anjoutey et d’Etueffont-Haut, disposaient de quelques revenus dans ce dernier village et à Lachapelle-sous-Rougemont où ils prélevaient également une partie des dîmes.
La présence de religieux fut effective à Lamadeleine, au Moyen Age, dans un ermitage d’hommes peut-être devenu par la suite prieuré bénédictin (déjà !). A Rougemont quelques ermites également sont installés autour de la chapelle Sainte-Catherine à la fin du 17ème siècle et au début du siècle suivant. A Saint-Nicolas, surtout, un ermite du nom de Pierre aurait fondé à la fin du 11ème siècle un établissement dépendant de Molesme. Six siècles plus tard il ne reste que peu de chose de ce prieuré qui passe sous l’autorité du collège des jésuites de Colmar.
Ajoutons la présence, mieux connue, à Giromagny de 1663 à 1773 des frères du Tiers Ordre de Saint-François (les Picpus). Durant cent dix ans, cinquante frères au total vivent dans un petit couvent et desservent la cure.
Les bénédictins, peut-être présents à Lamadeleine, plus sûrement à Sainte-Catherine et à Saint-Nicolas, sont donc revenus au pied des Vosges après une longue absence. L’ordre des bénédictins est sans doute un des plus anciens et des plus prestigieux de la chrétienté. Benoit, le père fondateur, naît vers 480 dans la province de Nursie en ltalie. Après des études à Rome, il se retire du monde pour vivre en ascète avant d’être élu abbé d’un monastère. Vers 1529 il se fixe au Mont-Cassin où il meurt le 31 mars 547. La Règle qui porte son nom insiste sur la discipline intérieure, l’abnégation de la volonté et l’obéissance des moines, mais entre peu dans le détail de leur vie quotidienne si ce n’est pour préciser qu’ils doivent consacrer leur temps à la prière, à la lecture et au travail. En outre, Saint Benoit prévoit une relative autonomie des monastères qui suivent la Règle.
Les principes bénédictins, notamment en raison de leur souplesse, ont rendu possible l’essor de l’ordre à partir de la fin du 8ème siècle. A l’époque de sa plus grande expansion l’ordre compte 100.000 monastères en Europe.
Au 13ème siècle en France,2.000 abbayes et 20.000 prieurés suivent la Règle de Saint Benoit. L’ordre, détruit par la Révolution et l’Empire, est lentement reconstruit au 19ème siècle. En France, en 1859 Dom Muard fonde l’abbaye de la Pierre qui Vire, un grand monastère isolé dans les forêts du Morvan. Dans la plus pure tradition bénédictine cette abbaye essaime à son tour pour créer le prieuré de Chauveroche.
Comptez, comptez-vous bien…
Mars 1990, le mois du recensement général de la population.
Le recensement, opération délicate, longue, coûteuse aussi, permet d’obtenir une image de la population à un moment donné mais il permet aussi d’avoir de précieux renseignements sur l’évolution démographique et surtout, par la prospective, d’envisager les évolutions possibles à venir.
Le recensement des populations est une opération récente qui apparaît au 19ème siècle. Auparavant, il manquait aux gouvernants, d’une part, le désir de bien connaître la consistance de leurs Etats, d’autre part les outils, mathématiques notamment, qui auraient permis cette connaissance. Bien sûr l’idée de dénombrer les populations n’a pas surgi du néant. En France, Colbert et Vauban en particulier, comprennent l’intérêt qu’il y a de mener des enquêtes approfondies sur l’état du royaume. Mais notre pays manque de la curiosité qui animait les Britanniques. En effet, le premier recensement digne de ce nom est entrepris à l’initiative de Guillaume le Conquérant qui souhaitait connaître l’état exact de sa conquête anglaise. Le dénombrement achevé en 1086 est célèbre sous le nom de Domesday book. Au 18ème siècle, les Anglais sont les premiers à concevoir que les résultats statistiques en matière de démographie peuvent servir à des prévisions. Les progrès décisifs sont faits au siècle suivant notamment grâce au mathématicien, statisticien et démographe belge Adolphe Quetelet.
En France, le principe du recensement est arrêté sous la Révolution par la loi du 27 juillet 1791 mais sa réalisation différée. Napoléon créé un bureau de statistiques et lance le premier recensement en 1801 . La méthode et les moyens sont définis et mis en place lentement. En 1821 apparaissent les agents recenseurs. En 1841 la population comptée à part, est définie de façon précise (troupes, malades hospitalisés, prisonniers …). En 1856 sont recensées les données socio-économiques. Dans la deuxième moitié du 19ème siècle les opérations de recensement se déroulent d’une façon assez proche de celle que nous connaissons. Prenons l’exemple du recensement de 1891.
Le décret du 4 mars décide qu’il sera procédé au dénombrement de la population. Les frais sont supportés par les communes qui doivent inscrire les sommes nécessaires à leur budget. Le ministre de l’Intérieur fixe au 12 avril la date du recensement. Quelques jours auparavant des agents nommés par les maires ont déposé des bulletins individuels dans chaque maison. Le 25 avril les états statistiques municipaux sont transmis par les maires aux préfets, ceux-ci adressent les états récapitulatifs au ministère de l’Intérieur pour le 20 mai. Les résultats définitifs sont publiés par le ministère à la fin de l’année 1891.
La région sous-vosgienne compte à l’époque 20.810 habitants, soit 25 % de l’ensemble du département. Le poids démographique du secteur est plus important qu’il ne l’est aujourd’hui. Dans un département encore très rural, au chef-lieu modeste (Belfort compte 25.134 habitants en 1891), le pays sous-vosgien est actif. L’industrie textile emploie alors plusieurs milliers d’hommes et surtout de femmes. Le déclin économique de la région au 20ème siècle apparaît dans les recensements : 18.017 habitants en 1968, 19.768 en 1975 et 21.161 en 1982. La chute de la démographie est enrayée après 1975 mais le « poids » de la région par rapport à l’ensemble du département se stabilise à niveau bien inférieur (15 %) à ce qu’il était il y a près d’un siècle. Qu’elle est la situation aujourd’hui ? Les résultats du recensement de mars dernier le diront dans quelques mois lorsque les machines de l’Institut National de la Statistique (I.N.S.E.E.) auront fait leur ouvrage en traitant l’énorme masse de renseignements collectés auprès des habitants.
À lire sur la région sous-vosgienne
Anne-Marie Jaminet et Yves Grisez, La famille Grisez et la brasserie de Lachapelle-sous-Rougemont, Bulletin de la Société Belfortaine d’Emulation, n° 79, 1987-1988
Les auteurs, deux membres de la famille Grisez, présentent l’histoire de leurs ancêtres depuis le XVIIIe siècle. Une place importante de l’article est consacrée aux cinq générations de brasseurs qui créèrent et dirigèrent l’entreprise qui fit le renom de Lachapelle sous Rougemont. Parmi eux, la figure la plus originale est sans conteste celle du quatrième brasseur, Jean-Baptiste (1861-1915), sourcier, découvreur des mines de potasse d’Alsace qui tenta également, mais sans succès, de relancer l’activité minière à Auxelles.
René Mathey, Rougemont le Château, La guerre de 1939-1945, tome 2, L’occupation et la reconquête, 1989
Le livre de René Mathey, paru à l’automne 1989 est le second volume d’un ouvrage consacré à la guerre de 1939-1945. L’auteur divise la guerre en quatre périodes : de l’Armistice au débarquement allié en Afrique du Nord, de celui-ci au débarquement en Normandie, une partie est consacrée aux batailles sur le sol français jusqu’à la libération de notre région, une autre à la fin de la guerre. Dans chaque partie, l’auteur réserve un chapitre à Rougemont. La vie quotidienne dans le village est peu abordée. Par contre l’auteur rapporte des témoignages sur les événements, notamment sur ceux vécus dans cette période dramatique que fut la Libération.
L’ouvrage est en vente dans les Maisons de la Presse et à la Mairie de Rougemont.
Jean-Marc Peter et Antoine Steib, La vallée de Masevaux, 1989
L’ouvrage se range assurément dans la catégorie « beaux livres ». Sur cent vingt huit pages, cent six comportent des photos couleurs, toutes magnifiques. Les auteurs ont remarquablement illustré les quatre saisons de la vallée, la beauté et la douceur de ses paysages. De belles illustrations sont également consacrées aux activités traditionnelles, fermes-auberges, élevage, travail du bois … Regrettons que la « modernité », sans être absente de l’ouvrage, soit reléguée au second plan. Mais ne boudons pas notre plaisir, tel quel, le livre peut être en bonne place dans une bibliothèque.
L’ouvrage est en vente à Masevaux au prix de 230 F.
Bernard Groboillot, L’église de Saint Germain le Châtelet – Bulletin de la Société Belfortaine d’Emulation, n°79, 1987-1988
L’église primitive du village est trop exiguë à la fin du XVIIIème siècle, son état laisse également à désirer. Au début des années 1800 la décision est prise de construire un nouvel édifice mais il faut près de soixante dix ans pour élaborer un projet définitif, trouver les fonds et surtout aplanir les difficultés entre les communes propriétaires de St Germain et Bethonvilliers. L’église, enfin achevée, est inaugurée le 13 juin 1889.
Scandale à l’église
Ce jourd’hui vingt deuxième mars de l’année mil sept cent quatre vingt sept, nous Robert Noblat, curé de la paroisse d’Etueffond, en présence d’André Petitjean, receveur de la fabrique de St Valbert, et de Richard Millet, maître d’école de ladite paroisse d’Etueffond, tous deux bourgeois d’Etueffond le Haut et soussignés avec nous avons dressé le présent procès-verbal sur les impiétés, irréligion et scandale que le nommé Nicolas Peltier, bourgeois de Felon, a fait le dimanche dix huit mars de la présente année pendant la messe de paroisse ; car pendant l’instruction que nous fûmes obligé d’interrompre ledit Nicolas Peltier s’est avisé de vouloir tenir assemblé sur le cimetière à côté du choeur pour distraire les paroissiens de l’audition de l’instruction lui-même en en faisant une à haute voix dans laquelle il débitait des impiétés horribles et telles que les personnes avancées en âge furent obligées de chasser et d’écarter la jeunesse qui s’était rassemblée à l’entour de lui. Et non content d’attaquer ainsi la religion en dissuadant les paroissiens de nous écouter et que nous même nous ne croions pas ce que nous leur prêchions. Il a encor attaqué par des paroles grossières et injurieuses les ministères de la religion. Fait et arrêté à Ettuefond le Haut en présence des témoins avec nous soussignés pour être déposé au greffe de la juridiction pour y avoir recour le cas échéant.
(Archives départementales du Territoire de Belfort, B 24. – Texte communiqué par Olivier Billot)
Concours des Monuments Historiques et des Sites
Pour la troisième fois, le chantier archéologique du Vieux-Château de Rougemont a obtenu un prix dans le cadre du concours régional des chantiers de bénévoles organisé chaque année par la Caisse Nationale des Monuments et des Sites.
Après avoir obtenu un premier prix en 1981 , puis un deuxième prix en 1984, un deuxième prix régional vient à nouveau récompenser la qualité et l’ampleur du travail réalisé depuis treize ans par l’équipe du Foyer Rural de Rougernont-le-Château. Le dossier ayant été retenu pour représenter la Région Franche-Comté au Concours National, Pierre Walter responsable du chantier, est allé à Paris pour présenter au jury national les travaux réalisés. Un diplôme et un chèque de 10.000 F nous ont été remis par Mr Laks, Directeur Régional des Affaires Culturelles, à l’hôtel de la Région à Besançon le 20 mars 1990.
Le montant de ce prix sera intégralement utilisé pour la poursuite de la mise en valeur du site :
- dégagement et remise en forme des fossés
- reconstitution du pont d’accès au château
Les gares… on ferme
La gare de Vézelois abrite la mairie, celle de Rougemont le service des eaux, celle d’Etueffont une station service … Avec la fermeture de la gare de Giromagny et celle de Bas-Evette à partir du 1er juin, nous assistons à l’épilogue d’une aventure centenaire.
Première ligne d’intérêt local, seule ligne du réseau à voie large, la liaison Belfort Bas-Evette Giromagny sera aussi la dernière à fermer. L’intérêt économique du chemin de fer était admis de tous dans la région depuis 1837 et Belfort, Besançon et Montbéliard s’étaient âprement disputées pendant pratiquement vingt ans pour que la liaison avec Paris passe par leur ville. Les lignes Paris-Dijon-Besançon-Belfort et Paris-Vesoul-Belfort achevées en 1858, la construction d’un réseau local devait suivre. Mais la guerre de 1870 bouleverse les données et la présence d’une frontière proche interdit désormais de ne considérer que l’aspect économique du chemin de fer. L’état-major s’oppose à toute construction susceptible de hâter les déplacements d’un ennemi et d’affaiblir la place de Belfort en cas de conflit. Des études de tracés sont bien demandées par les industriels de la vallée de Giromagny dès 1871 et financées en particulier par les Boigeol, mais ce n’est que 10 ans plus tard que Giromagny est reliée à Belfort par un embranchement partant à Bas-Evette de la ligne de Paris
L’inauguration a lieu le 1er juillet 1883, et à cette occasion MM. Boigeol et Warnod offrent un banquet de 1200 couverts aux ouvriers et employés de leurs usines. La construction des autres lignes sera encore plus laborieuse. L’état-major impose des voies étroites pour éviter tout raccordement éventuel au réseau allemand en cas de guerre, et interdit les liaisons transversales « dangereuses pour la défense de la place en sorte que la liaison Rougemont – La Chapelle-sous-Rougemont ne voit jamais le jour. Seule réalisation, la voie Belfort-Les Errues d’où partent trois embranchements, vers Etueffont-Haut, vers Rougemont et vers La Chapelle-sous-Rougemont. L’inauguration a lieu en 1913. En 1914, l’avancée des troupes françaises dans la vallée de Masevaux justifie la prolongation de la ligne de La Chapelle jusqu’à Sentheim. Pour éviter que la fumée ne transforme les convois en cible, la ligne est électrifiée.
La paix revenue, et malgré les protestations de quelques-uns fondées sur des arguments patriotiques autant qu’utilitaires, la liaison avec Sentheim est abandonnée (1er janvier 1921). Il est vrai que la concurrence des transports routiers commence à se faire sentir, le 24 juillet 1921 est inauguré le Service des Transports automobiles de la région de Belfort et de la Haute Alsace, reliant Belfort à Masevaux et le 4 septembre de la même année c’est le Concours agricole de Giromagny qui suscite deux services d’autocar au départ de Belfort. Dès lors les lignes d’intérêt local se mettent à vivoter, la fréquence des convois diminue. Le 30 juin 1934 le double embranchement Les Errues-La Chapelle et Les Errues-Rougemont ferme définitivement. Le trafic marchandises, lié aux usines est assez important pour justifier le maintien de la liaison avec Etueffont jusqu’au 4 juillet 1948.
Les gares, petit à petit, changent d’emploi mais leur silhouette caractéristique les fait reconnaître du premier coup d’œil.

Ce numéro de La Vôge est épuise.
