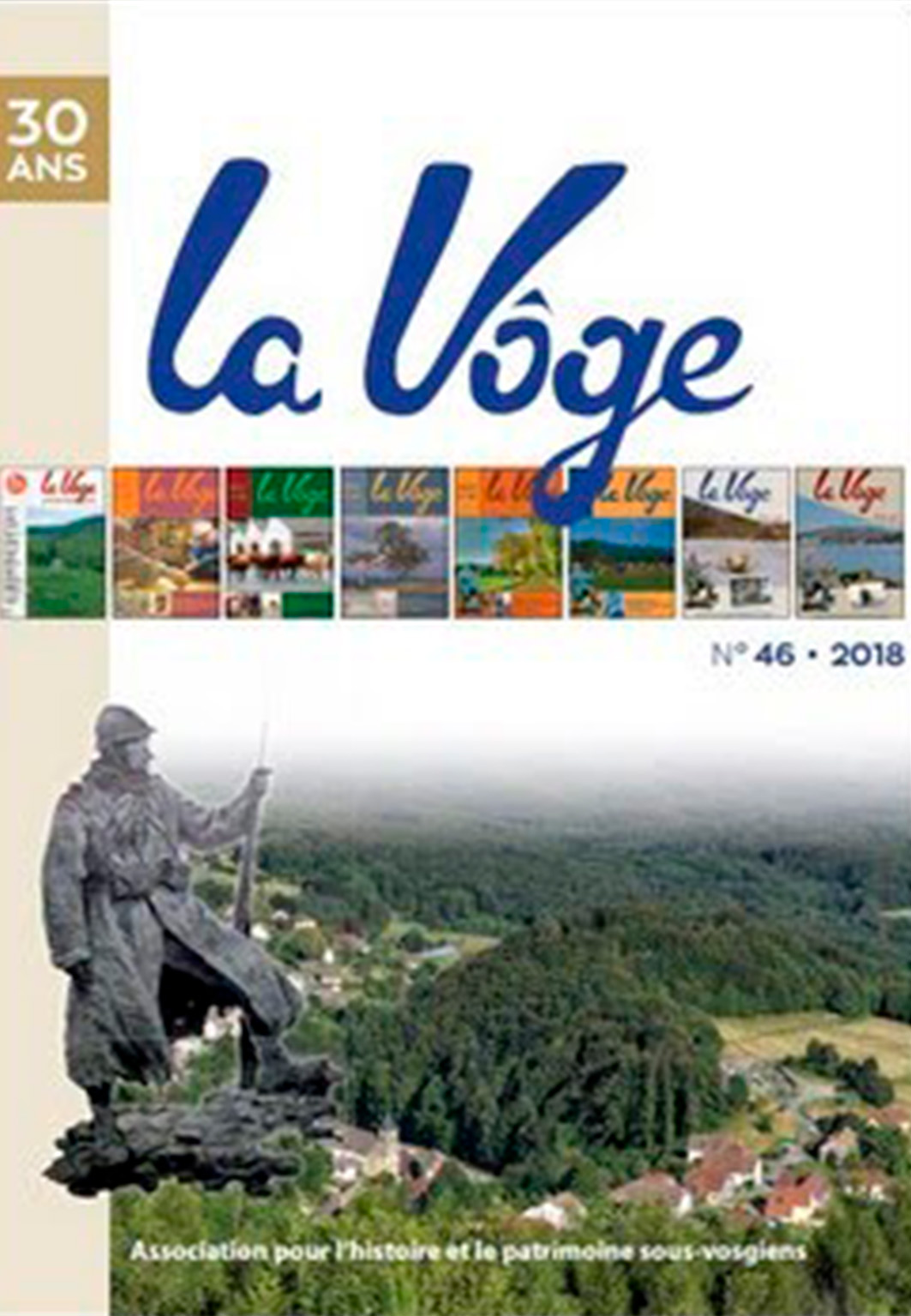
Édito
En 1988, quelques individus déjà impliqués dans le milieu associatif, patrimonial et historique du Pays sous-vosgien, se prennent à rêver…
A rêver d’un magazine « grand public », condition primordiale, qui concilierait passé historique, anecdotes, témoignages, actualités, le tout avec rigueur. Avec la rigueur des savants, même si savants ils ne le sont pas vraiment… encore qu’ils le soient devenus un peu, à leur insu !
Bref, cette revue, ce magazine, ce bulletin au nom si souvent contesté, questionné, voire récusé, LA VÔGE, fête aujourd’hui ses 30 ans. Ce n’était donc pas un rêve !
Bisannuelle dans un premier temps, La Vôge devient parution annuelle à partir de 2005. Mieux, depuis 2016, elle est en couleur. En 30 ans, l’équipe de rédaction a changé. Beaucoup sont partis – à jamais pour certains – d’autres sont arrivés, au moins un est présent depuis le début, et vous tenez entre vos mains La Vôge n° 46.
Preuve qu’avec une bonne dose de passion, beaucoup de curiosité, un zeste de rigueur et un brin d’humilité, on peut faire vivre ce type de publication… à condition bien sûr d’avoir des lecteurs !
Et vous êtes là, toujours aussi nombreux, alors : 46 fois merci !
François Sellier.
Table des matières
| Édito | 1 | |
| Il y a 100 ans ! – Revue de Presse | Martine DEMOUGE | 2 |
| 7 novembre 1918, le début de la fin… | François SELLIER | 20 |
| La lutte contre un « péril national » : l’armée face à la grippe de 1918 dans le Territoire de Belfort | Eric MANSUY | 22 |
| Le dessous des cartes | François SELLIER | 34 |
| Accident à Chaux – enquête | Marc DUMAS | 35 |
| Mai-juin 1918 : Les « Sammies » sont à Rougemont ! | François SELLIER | 50 |
| Les vieilles familles du Territoire : Les Jardot d’Évette | Jacques MARSOT | 55 |
| Métier d’antan : le voiturier. Texte en patois du Rosemont : Traduction en français : | André MARIE José LAMBERT |
57 |
| Les traces des charbonniers en montagne 2e partie | Roland GUILLAUME | 60 |
| L’école de Riervescemont, en remontant le temps… | Marthe PELTIER | 71 |
| Auxelles-Haut autrefois… une petite cité industrielle ! | Bernard PERREZ | 74 |
| Le kiosque à musique de Valdoie | Claude PARIETTI | 87 |
| Clap de fin pour la quincaillerie Schenck de Giromagny | Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ | 93 |
| 1939-1945, une enfance au pied du ballon d’Alsace | Stéphane MURET | 96 |
| La ferme à galerie, une spécificité architecturale de « la Vôge » | Jean-Christian PEREIRA | 106 |
| Histoires de machines… « à percer » | Patrick LACOUR | 109 |
| La petite histoire en patois : Lo lavou et M’sio lo tiurie – Le lavoir et M. le curé Texte traduit par André, Colette, Pierre et Louis du groupe « Djoza potois » de la Haute Savoureuse Illustrations de François BERNARDIN |
112 | |
| MAGAZINE In memoriam La vie de l’association Les cicatrices du terrain : les limites Transmission du drapeau des anciens combattants de Giromagny Petite leçon de patois sous-vosgien n°2 Eclipse de lune du 27 juillet 2018 La Vôge a lu L’aménagement du Nouveau Saint-Daniel à Lepuix Inauguration de la mine Saint-Daniel à Lepuix Journées européennes du Patrimoine |
François SELLIER Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ Roland GUILLAUME Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ Louis MARLINE François SELLIER François SELLIER Roland GUILLAUME Roland GUILLAUME |
115 116 119 121 123 124 124 125 126 129 |
Il y a 100 ans !
Alors que la France entre dans sa quatrième année de guerre, la presse locale fait état des restrictions de plus en plus sévères qui affectent la population. Concernant les combats, le début de l’année 1918 voit se rompre l’équilibre stratégique et tactique qui, sur le front occidental, avait transformé le conflit en une interminable guerre de position.
L’année 1918 en bref
Des restrictions de plus en plus pesantes
Dans le journal l’Alsace du 23 janvier 1918 on peut lire que « le Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales se trouvant momentanément dans l’impossibilité de faire face aux demandes de farine qui lui parviennent chaque jour plus nombreuses estime qu’une restriction importante s’impose dans la consommation du pain. L’Administration, confiante dans le patriotique esprit de chacun insiste pour que non seulement tout gaspillage soit absolument évité, mais que la consommation soit réduite au strict minimum et remplacée le plus possible dans l’alimentation par des légumes secs et des pommes de terre. »
Un autre article de ce même journal paru le 9 septembre rappelle que « la ration hebdomadaire de la viande a été réduite à 200 grammes par personne à partir du 12 août. »
Concernant les combats, le début de l’année 1918 voit se rompre l’équilibre stratégique et tactique qui, sur le front occidental, avait transformé le conflit en une interminable guerre de position. Les Allemands qui étaient cantonnés à la défensive depuis l’automne 1914, reprennent l’offensive car ils veulent en finir avant l’engagement effectif des troupes américaines.
En juin, ils sont de retour sur la Marne dont ils avaient été chassés en 1914. Paris est sous le feu des canons à longue portée, dont la fameuse «Grosse Bertha». Les combats font rage ; les Alliés « plient mais ne rompent pas ». A la mi-juillet, une vigoureuse contre-offensive alliée surprend l’assaillant et l’oblige à battre en retraite. Cette seconde victoire de la Marne, si elle n’est pas décisive, constitue malgré tout un tournant dans l’histoire militaire de la guerre.
Enhardi par ses succès, Foch poursuit sa lancée. Le 8 août le front est enfoncé en différents points. En septembre, l’assaut final est donné sur l’ensemble du front. Fin octobre, les Allemands sont rejetés sur la Meuse, leur point de départ de 1914. Ailleurs aussi en Europe l’histoire s’accélère. Fin octobre, la victoire italienne de Vittorio Veneto chasse l’armée autrichienne de la péninsule. L’Autriche-Hongrie se désagrège, minée par les revendications de ses minorités nationales.
L’empereur Charles 1er abdique. C’est la fin de l’empire millénaire des Habsbourg. L’Allemagne, elle, plonge dans le chaos. Début novembre, la flotte basée à Kiel se mutine et la révolte s’étend à tout le pays. Le Kaiser Guillaume II abdique le 9 novembre et la République est proclamée. Face à la menace révolutionnaire intérieure le gouvernement est conduit à réclamer l’armistice sans tarder. On estime que 9,5 millions de soldats sont morts lors de ce premier conflit mondial (1,4 million en France, 1,9 million en Russie et 2 millions en Allemagne).
À partir du mois d’octobre de cette même année, l’épidémie de grippe espagnole fait des ravages parmi la population (1,2 million de victimes en Europe, 450 000 en Russie). «Pourtant, on ne s’émeut guère tant est grande la sidération provoquée par les morts de la Grande Guerre. ».
C’est également au cours de l’année 1918 (le 6 février) que le Parlement britannique accorde aux femmes de plus de 30 ans le droit de vote.
Il convient de rappeler qu’en France, les femmes devront attendre le 21 avril 1944 pour obtenir le droit de vote mais ce n’est qu’un an plus tard, le 29 avril 1945, à l’occasion des élections municipales, qu’elles utiliseront ce droit pour la première fois.
Journal : L’Alsace
N.D.R. : S’agissant d’articles de presse, l’orthographe des noms propres, la ponctuation et la syntaxe originales ont été respectées.
4 janvier 1918
Anjoutey – Une bien triste nouvelle vient d’arriver au village
M. Justin Nicot, gendarme de la brigade de Beaucourt (Territoire de Belfort), vient de mourir de maladie à l’armée d’Orient où il se trouvait depuis à peine quinze jours. Désigné vers la fin de septembre dernier pour être affecté à la prévôté de l’armée d’Orient, nous le vîmes au cours de la visite d’adieu qu’il vint faire à sa famille à Anjoutey, et vu la santé florissante dont il jouissait, nous ne pensions guère ne plus devoir le revoir. Le brave gendarme Nicot est une victime du devoir et bien qu’il ne soit pas tombé au Champ d’honneur, il est mort pour la France. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse éplorée et à toute sa famille si cruellement et si soudainement frappée. Ils puiseront dans leur foi le courage et la force de supporter l’épreuve cruelle qui les frappe car leur cher mort ils le retrouveront un jour dans un monde meilleur. Qu’il repose en paix !
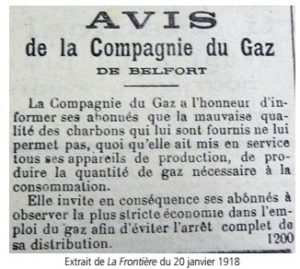
5 janvier 1918
L’échenillage
Clémenceau tient ses promesses. La chasse aux embusqués commence. Déjà, une circulaire vient de rappeler du front les jeunes gens des classes 1914-1915, confortablement installés depuis trois ans dans les usines de guerre. On ne verra donc plus ce spectacle scandaleux d’éphèbes de 21 à 23 ans qualifiés « spécialistes indispensables » et, sous ce beau prétexte, échappant aux dangers de la bataille, alors que chez leurs camarades du même âge, les tués et les blessés se comptent par milliers, alors surtout que tant de « vieux » de quarante ans, souvent chargés de famille et beaucoup plus intéressants que les blancs becs en question, n’arrivent pas, malgré leurs aptitudes à rentrer dans les usines.
C’est bien, mais ce n’est pas encore assez. On ne se fait pas une idée exacte du nombre de gens qui pour des raisons diverses, ont été soustraits jusqu’ici aux ennuis et aux périls de la mobilisation.
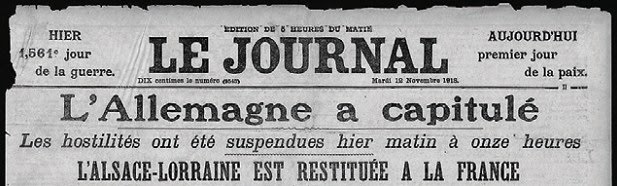
27 janvier 1918
Belfort – Nos compatriotes
Voici la citation d’un de nos compatriotes aviateur :
Le Général commandant de la …e armée a cité à l’ordre de l’armée le 13 janvier 1918 : L’adjudant de cavalerie Lienhart GeorgesFrédéric, pilote à l’escadrille S 36.
« Pilote remarquable par son audace et son habileté, exécutant à la perfection toutes les missions qui lui sont confiées, s’est dépensé sans compter pendant la préparation et l’exécution de l’attaque du 30 décembre1917, effectuant à basse altitude et malgré le tir précis de l’ennemi, de nombreuses reconnaissances photographiques et liaisons d’infanterie remarquables, descendant soudain à moins de 200 mètres pour attaquer les troupes ennemies à la mitrailleuse et en particulier les 20, 26, 27, 29 et 30 décembre 1917. »
Cet adjudant pilote a déjà deux fois été cité à l’ordre et décoré de la Valeur militaire italienne en argent et de la Médaille commémorative de guerre.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.
13 février 1918
Auxelles-Haut – Contre la vie chère
Dimanche dernier, il a été formé une coopérative de consommation ayant pour but de fournir à ses associés, au plus bas prix possible, des denrées d’épicerie, mercerie, chaussures et fournitures
diverses. Le Conseil d’Administration, réuni à la Mairie, a nommé parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un gérant. Ce sont : Messieurs Couqueberg, Durin, Plubeau et Grosboillot.
2 mars 1918
Rougegoutte – Le feu
Mercredi soir, vers 7 heures, le clairon, puis les…
(La suite dans : Il y a 100 ans ! – Revue de Presse , par Martine DEMOUGE, page 2)
7 novembre 1918, le début de la fin…
C’est à 11 heures, le 11e jour du 11e mois de l’année 1918 que prend effet l’armistice signé entre les représentants alliés et allemands. Les chiffres sont impitoyables : quatre ans, trois mois et neuf jours de combats, huit millions de morts, six millions de mutilés…
Le 11 novembre 1918, ce sont généralement les cloches des églises qui annoncent à la France entière l’armistice signé quelques heures plus tôt dans un simple wagon de chemin de fer, en forêt de Compiègne. Les uns parlent de victoire, d’autres veulent croire que c’était « la der des ders », beaucoup pleurent et pas uniquement de joie…
Le traité de paix, lui, ne sera signé que le 28 juin 1919.
La Capelle – 7 novembre 1918
Mais avant tout cela, il y eut le 7 novembre 1918. Une date presque oubliée aujourd’hui, mais qui marque pourtant les premiers actes de la fin des combats. Ces premiers actes ont pour témoins et acteurs les hommes de la 3e compagnie du 1er bataillon du 171e régiment d’Infanterie de … Belfort !
Parmi ces hommes, le lieutenant Edouard Hengy de Belfort, le caporal-clairon Pierre Sellier de Beaucourt, le soldat Pierre Chrétien de Rougemont-leChâteau. Ce dernier raconte :
« On marchait en colonnes de chaque côté de la route, on avait reçu l’ordre de ne pas tirer. Devant nous, il y avait le capitaine et un autre officier qui marchaient en discutant. [Capitaine Lhuillier, capitaine Nabal ? N.D.L.A.] Ils avaient l’air tout joyeux, je me disais, il doit y avoir quelque chose ! Moi, j’étais juste derrière eux, en tête de la section. Quand l’autre officier est parti, j’ai dit au capitaine « il y a quelque chose de bon, là-bas ? ». Il m’a dit : « t’as pas entendu ? Oui, c’est les parlementaires allemands qui doivent venir ici, il faudra tous vous mettre dans le fossé pour les laisser passer ». J’ai répondu « oh s’il n’y a que ça, on veut bien le faire… »
En effet, aux environs de 7 h du matin, un messager cycliste est venu annoncer la nouvelle au capitaine Lhuillier qu’une délégation de plénipotentiaires allemands franchira les lignes dans la journée. Ordre est donc donné de ne pas tirer, afin d’éviter toute méprise qui pourrait être catastrophique…
Vers 14 h, un officier allemand, le lieutenant Von Jacobi, accompagné de deux uhlans, se présente au front de la 3è compagnie du 171è R.I. et annonce au lieutenant Hengy que les négociateurs allemands arriveront en automobile par la route Haudroy-La Capelle, mais qu’ils seront en retard à cause du mauvais état de la route.
À 20 h 10, les parlementaires allemands apparaissent enfin. La 1ère section de la 3è compagnie du 171, commandée par le sergent Joubert, est déployée de…
(La suite dans : 7 novembre 1918, le début de la fin… , par François SELLIER, page 20)
La lutte contre un « péril national » : l’armée face à la grippe de 1918 dans le Territoire de Belfort
Comme si les horreurs et les deuils accumulés jusque là n’avaient pas suffi, l’année 1918 n’aura vécu que quelques mois avant que dans cette guerre apparemment sans fin n’émerge « un mal qui répand la terreur », comme l’écrivait Jean de la Fontaine à propos d’une autre abomination. La terreur, cette fois, et malgré quelques rumeurs originellement insistantes, n’est certes pas due à la peste, mais à la grippe. La terreur, surtout, tient certainement aussi beaucoup au fait, pour reprendre les termes du fabuliste, qu’« ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », puisque la maladie va rôder si malicieusement, si puissamment, et si obstinément, qu’elle semblera bientôt n’avoir pitié de nulle classe d’âge, nul rang social, nulle origine ethnique, nulle région. Dans ce cataclysme planétaire d’une ampleur telle que le nombre des morts qu’il a semés sur son parcours reste un sujet de conjectures un siècle plus tard, le Territoire de Belfort n’a pas échappé au sort commun. Il est à ce titre d’autant plus intéressant d’y étudier les manifestations du mal que le département concentre des caractéristiques permettant d’obtenir une vision nette de sa propagation chez les militaires et – quoique dans une moindre mesure – chez les civils, sur la ligne de front et à l’arrière de celui-ci, dans les hôpitaux militaires et civils, dans les cantonnements et dans les communes. Malgré les difficultés liées à l’étude véritablement approfondie de ce qui deviendra une pandémie, il est possible de mettre en lumière la façon dont la grippe s’est insinuée dans le département, sa perception par les autorités civiles et militaires, par les habitants et par les combattants, sa progression dans le temps, l’espace et la létalité, les mesures prises pour la contrer. Au final, hélas, ce sont les divers aspects d’un relatif constat d’échec, même à une faible échelle géographique, auxquels il nous faudra aboutir. Mais commençons par le commencement…
Belfort et le Territoire avant la grippe
Au moment où s’engage le conflit, en août 1914, le service de santé – c’est on ne peut plus logique – s’apprête à gérer un certain nombre de « pertes ». Il serait erroné de penser que ce sont les blessés de guerre qui monopolisent à eux seuls l’attention des médecins : jusque dans un passé récent, le nombre des morts des suites de maladie, le plus souvent une maladie infectieuse épidémique, a excédé celui des morts dus aux combats. Tel a été le cas, entre autres, avec le choléra en Crimée (entre 1853 et 1856), la variole et la typhoïde durant la guerre de 1870-1871.
Si la guerre russo-japonaise, en 1904-1905, marque une inflexion de cette tendance lourde, puisque les Japonais enregistrent plus de morts au combat que pour cause de maladie, les épidémies demeurent un sujet de préoccupation majeur pour le service de santé des armées. Avant guerre déjà, Belfort est frappée par la maladie dans sa garnison, quand le goitre se répand au sein des 35e et 42e régiments d’infanterie, dans les casernes et les forts de la Place, occasionnant plus de 900 cas durant l’été 1877.
Au cours de l’hiver 1913-1914, la morbidité dans les casernes, dans le nord-est de la France surtout, a atteint de tels sommets – 96‰ – que le sujet est amené devant la Chambre des députés par le Corrézien Edouard Lachaud, en février 1914. Six mois plus tard, la guerre débute, et le Territoire se trouve bientôt au cœur de la tourmente : une épidémie de fièvre typhoïde se développe avec une célérité alarmante dans les environs de la Place, causée par des conditions d’hygiène déplorables dans les localités du secteur. Deux hommes s’emploient à y faire face : le médecin principal de 1ère classe Georges Landouzy, médecin-chef de l’hôpital militaire de Belfort, et le médecin principal de 2e classe Jean Bousquet. Le second, ayant mis sur pied des équipes médicales, réussit, aux dires du général Thévenet, gouverneur de la Place, avec l’aide de « trois vaccinateurs exercés, […] à immuniser de 800 à 1.000 hommes par heure ». Le 17 novembre 1914, le docteur Georges Landouzy informe le général Thévenet que 50.000 vaccinations anti-typhoïdiques ont été effectuées, qui seront rapidement suivies d’autres campagnes d’injections, jusqu’au Mont-Bart et au Lomont, et permettront d’enrayer l’épidémie dans le secteur. Il y a là, pour le moins, une belle victoire locale sur la maladie, alors que les troupes du front des Vosges et d’Alsace sont frappées en nombre croissant durant les mois de novembre et décembre, les cas passant de 812 début novembre à 2.585 début décembre, puis 2.638 fin décembre, avant qu’une lente diminution ne soit entamée durant
le premier trimestre de 1915. Au moment où cesse la phase majeure épidémie, en 1915, la fièvre typhoïde a touché 110.000 hommes, et a tué près de 15.000 d’entre eux. En 1916, le fléau revient avec virulence : au sein de la VIIe Armée française, dans les Vosges et en Alsace, 1.812 cas se sont déjà déclarés en quelques semaines, selon un bilan du mois de juin. Pendant ce temps prospèrent en outre des maladies qui, pour être moins mortifères, n’en mettent pas moins en danger le maintien en conditions de combat d’effectifs non négligeables : dysenteries, leptospiroses, scarlatine, oreillons… En février 1918, c’est la rougeole qui frappe une centaine des enfants de Beaucourt, mais ne touche pas les militaires se trouvant dans la commune grâce à de strictes mesures d’isolement. Enfin, entre le 19 et le 21 avril 1918, c’est une épidémie d’oreillons qui est signalée sur le front de Belfort, au sein de la population de Traubach-le-Bas et dans les rangs de la 26e compagnie auxiliaire italienne, à Strueth. Elle ne précède l’apparition de la grippe sur ce même front que d’une semaine, passant ainsi le relais à un mal d’une tout autre facture.

Comment cerner la grippe…
Pour tenter au mieux de décrire la propagation de la grippe dans le Territoire de Belfort en 1918, il convient tout d’abord de cerner, en quelque sorte, quelles en ont été les unités de lieu, de temps, et d’action.
• Le lieu :
Ce que nous avons précédemment qualifié de « front de Belfort » est en fait, dans la terminologie militaire en vigueur, le « Secteur de Haute Alsace », soit une ligne de front courant du débouché de la vallée de la Doller aux abords de Pfetterhouse ; passant entre Aspach-le-Haut et Aspach-le-Bas, elle longe à l’Ouest les deux Burnhaupt, Ammertzwiller, Brinighoffen, Carspach, Bisel, Moos. Ce « Secteur de Haute-Alsace » est divisé en trois secteurs, tenus chacun par une division, les secteurs Nord, Centre et Sud : le secteur Nord s’étend de Leimbach au canal du Rhône au Rhin, le secteur Centre, du canal au bois d’Hirtzbach, le secteur Sud, du bois d’Hirtzbach à la frontière suisse.
À l’arrière de cette ligne de front se trouve l’ensemble du Territoire, dans les limites duquel sont réparties en profondeur des formations et structures sanitaires sur le rôle desquelles nous reviendrons, mais qui s’étireront en fait jusqu’à Héricourt, puis Lure. En avril 1918, les malades évacués du secteur Sud sont dirigés sur Morvillars, ceux du secteur Centre prennent la direction du Groupement d’Ambulances de Romagny, ceux du secteur Nord vont à Lachapelle. Dans l’ensemble, les contagieux transportables du « Secteur de Haute-Alsace » sont évacués vers Héricourt. Il en ira autrement de la théorie à la pratique, comme nous le verrons, et la situation est déjà quelque peu différente en mai 1918, alors que les malades de la partie septentrionale du secteur Nord sont évacués sur le Groupement d’Ambulances de Lauw, que ceux de la partie septentrionale du secteur Sud sont évacués sur le Groupement d’Ambulances de Valdieu, et ceux de la partie méridionale sur le Groupement d’Ambulances de Faverois. Enfi n, à l’été 1918, dans le secteur Sud, alors que le Groupement d’Ambulances de Faverois accueille et trie toujours les malades, le Groupement d’Ambulances de Morvillars reçoit les…
(La suite dans : La lutte contre un « péril national » , par Eric MANSUY, page 22)
Le dessous des cartes
Vous connaissez bien désormais cette page de la petite histoire de la Grande Guerre racontée à travers une image. Nous avons cette fois choisi une carte postale envoyée par un poilu à sa famille.
Nous sommes le 19 octobre 1916, Marcel, infirmier-brancardier au 87e régiment d’artillerie lourde s’apprête à remonter en ligne dans la Somme où en mai 1916 il a déjà reçu une citation à l’ordre de son régiment d’alors. Il a choisi cette image de carriole pour annoncer son départ aux siens qui habitent à Rougemont. Mais aussi et surtout, malgré tout ce qu’il a déjà vu et enduré, malgré le danger qui l’attend, il est avant tout le père, le mari qui pense à l’éducation de ses enfants…
Ce texte pourrait être celui de beaucoup beaucoup de ces hommes dont les valeurs humaines n’ont jamais failli devant la mort qui les guettait en permanence.
Lisons et respectons :
Chère petite Marcelle,
Tu vois ma chérie que je pense toujours à toi. Je suis content que tu es une petite .une gentille, plus gentille que ton frère car toi tu ne vas pas rouler, tu restes bien vers la Maman. Je suis bien content que tu obéis à Maman et dis à Paul qu’il soit très sage comme toi.
Tu lui feras une bouchette et écrits-moi quand il fume une cigarette.
Je pense que le 1er novembre, voilà la voiture qui nous mènera dans la Somme ou à Verdun. Au revoir.
Ton Papa qui t’aime de tout son cœur. Embrasse la Maman pour moi et bien fort, que ça claque plein la maison. Salut à Paul le petit rouleur.
Ton papa qui vous embrasse tous.
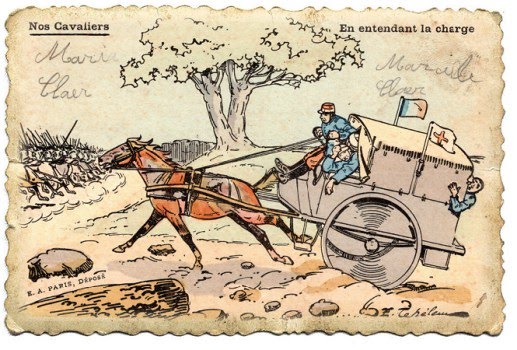
François Sellier
Accident à Chaux – enquête
Photos rapportées par Armand Hours et prises en 1918 sur le terrain de Chaux
Armand Hours
Armand Hours est né le 12 septembre 1894 à Misserghin, en Algérie. C’était, à l’époque de l’Algérie française, le département d’Oran. La guerre venue, Armand Hours, de la classe 1914, se retrouva incorporé le 19 septembre et presque immédiatement reformé temporairement pour insuffisance pulmonaire. Il rejoint alors Oran, où il habite au 25 de la rue Thiers avec sa femme, Hermine Ruiz, épousée le 19 août 1914.
Le recrutement de soldat pressant, la commission de réforme d’Oran du 8 octobre 1915 l’incorpore au Groupe d’Aviation à compter du 10 novembre 1915. C’est ainsi qu’il se retrouve intégré à la SPA53, déplacé de terrain en terrain, travaillant vraisemblablement comme mécanicien sur les moteurs rotatifs.Le terrain d’aviation de Chaux est actif depuis 1917 : les premiers baraquements ont été construits en février et les premiers appareils, des Nieuport 17, sont arrivés en mars (Roland Guillaume, La Vôge n°45). Il recevra en octobre 1918 la SPA53, alors équipée de SPAD XVI.
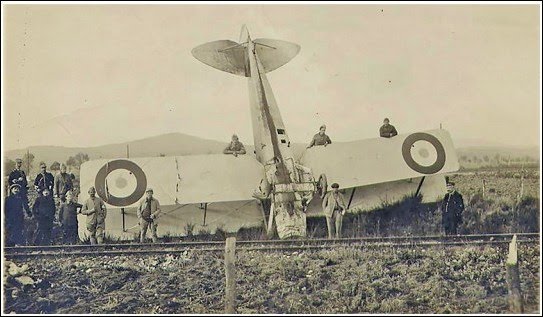
Les documents
Armand Hours a ramené de son séjour à Chaux deux photos de capotage du même avion, un SPAD XVI. Il a indiqué à ses descendants qu’elles avaient été prises à Chaux, Francis Bellois voulut s’en assurer, une manière de célébrer son grand-père et les 100 ans de ce capotage. J’avais déjà vu ce capotage à deux reprises. En effet, la photo est présente sur l’excellent site d’Albin Denis mais présentée comme se situant à Mayence en Allemagne. En 2015, une autre photo de l’événement était proposée à la vente sur le site Delcampe, c’est Lionel Luttenbacher qui me l’avait signalée. Je ne l’avais pas achetée, estimant qu’elle ne correspondait pas à la période de mes études sur l’aérodrome, me réservant pour la période 1924 à nos jours. Cette dernière photo était pressentie avoir été prise à Chaux par le vendeur. Hours a ramené de son séjour à Chaux par le vendeur.
Mais Armand Hours nous propose une troisième photo, prise sous un autre angle et cette dernière doit nous permettre de situer avec précision le lieu…
La voici.
(La suite dans : Accident à Chaux – enquête, par Marc DUMAS, page 35)
Mai – juin 1918 Les « Sammies » sont à Rougemont !
Les premiers soldats américains débarquent à St-Nazaire le 26 juin 1917 mais ce n’est qu’à partir du 15 mai 1918 qu’ils arrivent dans le secteur de Rougemont-le-Château.
Jusqu’au début de l’année 1917, les Etats-Unis d’Amérique ont respecté une stricte non intervention dans le conflit qui ébranle le « Vieux Continent ».
Le 1er février 1917, le président Woodrow Wilson rompt les relations diplomatiques de son pays avec l’Allemagne. Il espère ainsi faire pression sur le Kaiser qui a décrété « la guerre sous-marine à outrance» afin d’entraver l’approvisionnement de la Grande Bretagne et de la France par les Etats-Unis. Mais le 19 mars 1917, trois navires américains sont torpillés par les Allemands. Le 6 avril, le Congrès vote la guerre par 373 voix contre 50. Le Président Wilson déclare: «L’Amérique doit donner son sang pour les principes qui l’ont fait naître. »
Les Etats-Unis entrent à leur tour dans la guerre !
Le 13 juin, le général Pershing et le lieutenant Patton débarquent à Boulogne-sur-Mer, à la tête d’un premier corps expéditionnaire fort de…177 hommes ! Mais le 26 juin, à St-Nazaire, ce sont les 14 700 hommes de la 1ère Division U.S. qui arrivent avec armes et bagages (une tonne de matériel pour chaque homme !).
La 32e Division américaine et le 119th Machine Gun Battalion
Quant à la 32è Division U.S., dont une partie transite par Rougemont en mai 1918, elle vient parfaire sa formation sur le front d’Alsace avant d’être la première à percer la ligne Hindenburg dans l’Aisne. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’elle adopte le fameux insigne d’une ligne traversée de la flèche rouge, symbolisant la percée des lignes adverses. Elle devient alors la Red Arrow Division (division flèche rouge).
Cette unité n’a été créée qu’à l’automne 1917 en combinant la Garde nationale des Etats du Michigan et du Wisconsin (15 000 soldats fournis par le premier, 8 000 par l’autre). Plus tard, 4 000 soldats de l’Armée nationale de Camp Custer (Michigan) et Camp Grant (Illinois) sont affectés à la Division juste avant qu’elle ne gagne la France.
Le 13 janvier 1918, la 32e Division U.S. embarque pour l’Europe. Une partie arrive à Brest, une autre à St-Nazaire. L’Illustration commente l’allure de ces petits soldats de l’oncle Sam : « Avec leurs uniformes de drap olive, leurs feutres à large bord, leurs ceintures à pochettes multiples, cette allure de jeunes cowboys de l’Ouest américain, ils apportaient une note de pittoresque inédit dans nos décors de guerre. »

Bataillon de mitrailleuses, le 119th appartient à la 32e Division U.S. et c’est lui qui arrive au mois de mai 1918 à Rougemont-le-Château. Suivons son cheminement.
Le 119th quitte son camp d’entraînement au Texas le 4 février 1918 à destination de « quelque part » (sic). Le 18 février, les hommes montent à bord du « USS George Washington »
Arrivés à Brest le 4 mars 1918, c’est à bord du navire que les militaires américains passent leur première nuit en France. Le lendemain, les hommes découvrent notre pays d’une manière étonnante : ils sont entassés dans des wagons de chemin de fer marqués « HOMME 40 – CHEVAUX 8 » ! Habitués à des wagons deux fois plus grands et confortables, leur surprise est de taille… Coincés entre les caisses de haricots et de corned-beef, ils voyagent trois jours et trois nuits pour arriver au petit village d’Ourches-sur-Meuse, à l’ouest de Toul. Le bataillon est ensuite transféré à Boussenois (Côte d’Or) où il reçoit un premier entraînement intensif au combat (n’oublions
pas que les unités américaines n’ont encore jamais combattu avant leur arrivée sur le territoire français et ne sont donc aucunement rodés à la guerre).
Le bataillon est alors équipé de mitrailleuses Hotchkiss françaises (modèle 1914) et doté de camions Ford T qui l’accompagneront jusqu’à la fin du conflit.
Juste avant la fin de l’entraînement à Boussenois (qui dure six semaines), le major Frank Fowler prend le commandement du bataillon de mitrailleuses en remplacement du commandant Piasecki.
Des « Sammies » qui fascinent !
À la mi-mai 1918, arrivé au terme de sa formation, le 119th se met en route pour Rougemont-leChâteau. La moitié des hommes quitte Boussenois le 14 mai à 14 h 30 et se rend par camions à Vaux-sous-Aubigny où elle prend le train pour Fontaine. De là, les soldats marchent jusqu’à Rougemont. La seconde moitié du bataillon part, elle, en véhicules automobiles le 15 mai à 7 h 30 pour arriver directement à Rougemont à 21 heures, le même jour.
C’est donc à partir de 21 heures, ce mercredi 15 mai 1918, que les Américains parviennent au chef-lieu de canton sous-vosgien. Les rues du village s’emplissent subitement du ronronnement ininterrompu des moteurs à explosion. Des dizaines et des dizaines de camions, de camionnettes, de motocyclettes, de side-cars et d’hommes à pied se répartissent dans la cité. Le 119th totalise 338 hommes encadrés par 14 officiers, le commandement revenant, comme nous l’avons vu précédemment, au major Frank H. Fowler, assisté du premier lieutenant Leo M. Jackson.
Contrairement aux autres unités américaines, et notamment celles qui s’installent un temps dans le sud du Territoire de Belfort, à Grandvillars, le 119th est presque exclusivement constitué d’hommes blancs. En effet, dans la plupart des régiments américains venus combattre sur le sol français, les hommes de troupe sont noirs et les officiers sont blancs… Des rumeurs racistes ont d’ailleurs circulé sur le comportement des soldats noirs : violeurs et peu combatifs. Des rumeurs qui auraient été lancées par les autorités militaires américaines elles-mêmes, ségrégation oblige…
Mais ce n’est heureusement pas le cas à Rougemont. Si la population a pu craindre quelque peu les tirailleurs sénégalais de la 2e D.I.C. venus à Rougemont juste un an plus tôt, les soldats américains, eux, fascinent avec leur allure sportive, leurs crânes presque rasés, leurs guêtres en toile et à lacets et leurs chapeaux de boy-scout. On regarde avec des yeux tout ronds ces « Sammies » qui mâchouillent sans arrêt une espèce de gomme qu’ils étirent et qu’ils collent n’importe où quand ils en ont assez. Les enfants en particulier sont subjugués par ces grands gaillards qui leur distribuent des dattes, des oranges, des petites barquettes de confiture et les emmènent faire des tours de side-cars. Leurs conditions de vie sont tellement meilleures que celles des soldats français et que celles des Rougemontois ! C’est par caisses entières qu’ils reçoivent leurs oranges, leurs boîtes de « singe », leur maïs en boîte, leur tabac : « Ils avaient des petits sachets de tabac avec un cordonnet de fermeture. Ils nous [les enfants N.d.A] les donnaient quand ils étaient vides. On n’avait jamais vu ça. »
Comme pour toutes les troupes en cantonnement, les officiers logent à l’hôtel ou chez l’habitant, les hommes dans des lieux moins confortables, comme les granges ou les baraquements. Les soldats américains sont logés dans des baraques de cantonnement situées en haut de la rue d’Etueffont.
On assiste, curieux, à leur installation placée sous la responsabilité du lieutenant Howard M. Sivyer, officier chargé du logement, du campement, des subsistances, de la distribution des munitions, etc… Le bataillon est également pourvu d’un service sanitaire de campagne placé sous le commandement du médecin-lieutenant Atkin, avec une infirmerie et un service dentaire assuré par le capitaine Boyle. Ce service sanitaire est établi dans la rue de Masevaux.
Une cohabitation rocambolesque
Le rythme endiablé et les facéties des Américains perturbent les Rougemontois. « Ils font bien des victimes : chiens, poules, tout y passe. Ils vont comme des fous et ont déjà risqué d’écraser des enfants. ». Rappelons au passage que ces jeunes soldats n’ont pas encore connu le baptême du feu, ce qui pourrait expliquer leur insouciance…
D’autres témoignages nous font état de l’exubérance et de la décontraction de ces « Doughboys » :
(La suite dans : Mai-juin 1918 : Les « Sammies » sont à Rougemont !, par François SELLIER, page 50)
Les vieilles familles du Territoire : Les Jardot d’Évette
On ne saurait commémorer le centenaire de la Grande Guerre sans avoir une pensée particulière pour les cinq frères Jardot d’Évette. Jules Jardot et son épouse Marie-Honorine Marconot avaient six garçons, tous «paitchi pou lai Naition» (partis pour la Nation).
Cinq sont tombés là-bas au Champ d’honneur. Le sixième, aîné de la fratrie, ne dut son salut qu’à un vaste élan d’émotion légitime. Tout près de l’église paroissiale, aujourd’hui baigné par les notes joyeuses des Eurockéennes, le monument aux morts d’Évette nous décline discrètement un bilan des plus saisissants. Guerre 1914-1918 : 52 noms gravés pour une population qui ne comptait guère que quelques centaines d’habitants. Les familles Jardot ont payé le plus lourd tribut avec neuf victimes, parmi lesquelles, aux côtés des cinq frères précités, on relève encore quatre morts portant le même patronyme (deux frères et deux autres homonymes). On notera au passage qu’en plus des Jardot, deux autres familles de la commune ont perdu chacune deux fils (famille Grisey et famille Voisinet).

Qui était la famille Jardot ? D’où venait-elle ?
L’étymologie nominative nous désigne sans ambigüité la région Est de la France. Parmi nos patronymes français, beaucoup ont pour origine un nom de lieu. Ainsi sont apparus les Dubois, Dupont, Labbaye… Les ancêtres Jardot, quant à eux, ont certainement eu quelques affinités avec le jardin. Ce mot de la langue de Molière est porteur de la racine francique « gard » laquelle a donné « garten » et « garden » sous la forme anglo-saxonne.
Aux XVIè et XVIIè siècles, le patronyme apparaît phonétiquement : « Gerdat, Jerdat ». Viendra au tout début du XVIIIè siècle, la transcription contemporaine « Jardot ».
Aujourd’hui, le nom de famille est très présent dans de nombreuses localités sous vosgiennes, dont Évette où la souche ancestrale a des racines profondes. Y sont cités : Thibault Jerdat, né vers 1544, Jehan Gerdat, pelletier de profession en 1566, Jehan Jerdat en 1595, Nicolas Jerdaten 1597. D’autres familles locales, telles les Jardon,
ont sans doute des ascendances communes aux Jardot, compte tenu d’une implantation locale déjà ancienne : Henry Jardon, bourgeois de Belfort, est cité en 1598, Jean Jardonest présent à Chalonvillars en 1672.
(La suite dans : Les vieilles familles du Territoire : Les Jardot d’Évette, par Jacques MARSOT, page 50)
Métier d’antan : le voiturier
J’ai écrit ces quelques lignes pour que ne tombe pas dans l’oubli le dur et dangereux travail de voiturier. Ici, le voiturier n’est pas celui qui conduit calèches ou fiacres des personnalités mais le prédécesseur des débardeurs et grumiers d’aujourd’hui. À travers ce texte je tiens aussi à rendre hommage au fantastique travail de l’épouse de voiturier, toujours levée avant le mari pour fourrager les bœufs et préparer l’attelage avant de poursuivre sa pénible journée à l’entretien du cheptel, aux travaux ménagers et de mère de famille.
Neu son dains les djouès les pius longs. Po les voituries sô l’meument dè déchandre les sapes a peu les hâtais dé darivochmon et d’ôpuix po lé apotchâ tchi les rassou dè Tchô et d’Béfô.
Nous sommes dans les jours les plus longs. Pour les voituriers, c’est le moment de descendre les sapins et les hêtres de Riervescemont et de Lepuix pour les apporter chez les scieurs de Chaux et de Belfort.
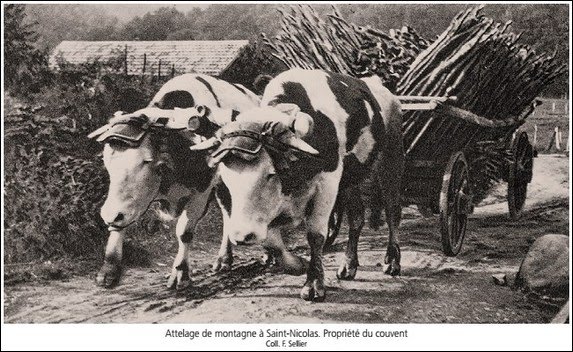
Al ô trôs houres, a Tchô lo djouè vint to docement darie lo Fayé, la fon’ne sôtche l’vâ po bayie è mindgie ô bues, tros bouènnes fourrées dains l’rétlo et in ôd’jo piai d’loitchin dove des poirottes tieutes a peu di son.
Il est trois heures. À Chaux, le jour se lève tout doucement derrière le Fayé, la femme sort le veau pour donner à manger aux bœufs, trois bonnes brassées dans le râtelier et une auge pleine de friandises avec des pommes de terre cuites et du son.
Cô l’houre d’appiayie. Lô greu Milo sôtche les bues, les fâ bouère in’ne bouènne lampée dains l’odge et c’mence è les appiayie. Al bote les tretchottes a peu lo tchvsie chu la tête di premie vâro. La fon’ne apôtche lo greu joug qu’als botons to les dou chu l’tchvsie, Milo pésse les courroies d’zo les écônes a peu sarre lo to. La fon’ne appotche lo douzîme varo, y bote les tretchottes a peu l’tchvsie et lè guide d’zo lo joug lavou qu’lo Milo fâ porail dove les courroies. A fô sovoi qu’al fô todje bota lo mâme bue à la main a peu l’ôtre à fue main. Al n’y en ai pé topiai qué vont des doues sen.
C’est l’heure d’atteler. Le gros Émile sort les bœufs, les fait boire une bonne lampée dans l’auge et commence à les atteler. Il met les protections en forme de boudin et le chapeau en cuir bourré de paille et cousu sur la tête du premier bœuf. La femme apporte le gros joug qu’ils mettent tous les deux sur le chapeau. Émile passe les courroies sous les cornes et serre le tout. La femme apporte le deuxième bœuf, y met les protections et le chapeau et le guide sous le joug où Émile fait la même chose avec les courroies. Il faut savoir qu’il faut toujours mettre le même bœuf à la main et l’autre à l’autre main. Il n’y en a pas beaucoup qui vont des deux côtés.
La fon’ne drosse lo timon di trin dévant. Milo fâ r’tiulâ les bues djuque qu’al puiésse bota lo bout di timon dains l’pétchu di joug et y botta la çia.
La femme dresse le timon du train avant. Émile fait reculer les bœufs jusqu’à ce qu’il puisse mettre le bout du timon dans le trou du joug et y mettre la clé.
Apré, di tin qu’la fon’ne réchte d’vant les bues, lo Milo prend la tempye di train d’darie di tché a peu bote lo to dains l’pétchu di train dévant, et bote lo brotcha. Avant d’patchi lo Milo rédia encouère si la mécanique tchmène bin, si les sarrous sont bin mis et si les dous crics, lo graind et l’pétai sont chu l’train dévant. Sans sola a n’porra rand fare.
Après, pendant que la femme reste devant les bœufs, Émile prend la perche du train arrière de la voiture et met le tout dans le trou du train avant et met la broche. Avant de partir, Émile regarde encore si le frein fonctionne bien, si les patins sont bien mis et si les deux crics, le grand et le petit sont sur le train avant. Sans ça on ne pourrait rien faire .
(La suite dans : Métier d’antan : le voiturier . Texte en patois du Rosemont d’André Marie, traduction en français de José Lambert, page 50)
Les traces des charbonniers en montagne (2è partie)
Aujourd’hui, le randonneur solitaire qui flâne ou transpire sur les sentiers et chemins forestiers du Pays sous-vosgien a du mal à imaginer qu’il y a cent ou deux cents ans la forêt était bien plus fréquentée. À la mauvaise saison il aurait entendu dans toutes les directions le bruit des cognées, merlins et passe-partout et en été c’est la fumée des fourneaux des charbonniers, le grincement des charrettes et les jurons des voituriers, qui auraient attiré son attention. Ces voitures en forme de tombereau qu’ont pouvait croiser au milieu d’un chemin creux descendant de la montagne, on les appelait aussi des bannes (ou des bennes) et, pour que la pluie ne mouille pas le charbon de bois qu’elles contenaient, on les couvrait d’une toile qui porte aussi le nom de banne. C’est que les clients es charbonniers n’aimaient pas le charbon humide, qu’il aurait fallu faire sécher avant de l’utiliser dans les foyers des usines et ateliers. En arrivant à l’usine à qui le charbon de bois était destiné, ce dernier était livré directement dans une halle à charbon, un hangar fermé où il était à l’abri des intempéries et des vols.

L’illustration ci-dessus montre le transport et la livraison du charbon de bois au 16e siècle à La Croix-aux-Mines. Il n’est pas impossible que la voiture représentée ici soit du même type que celles utilisées à la même époque dans les Mines du Rosemont.
Les utilisations du charbon de bois
De nos jours, le charbon de bois ne sert plus guère qu’à faire griller des saucisses mais, jusqu’à ce que la houille (le charbon de terre) soit utilisée, il était à la fois une source de carbone pour la production du métal à partir du minerai et le carburant le plus énergétique disponible pour obtenir de hautes températures. On l’utilisait alors dans plusieurs domaines de l’activité industrielle.
Fabrication du verre
Le travail du verre, pour la fabrication des bouteilles par exemple, ne requiert pas une température trop élevée, un feu de bois suffit. Par contre, l’opération de fabrication du verre à partir de silice et d’un fondant nécessite une température nettement plus haute, supérieure à 1400 degrés. C’est là que le charbon de bois, composé à 85% de carbone, était indispensable avant que les fours à charbon (de terre), à gaz ou électriques ne soient disponibles. Comme la production du verre n’était pas une spécialité du Pays sous-vosgien, ce sont dans les domaines de la métallurgie et plus particulièrement de la sidérurgie que le charbon de bois de nos montagnes a trouvé son utilité.
Les fonderies
Le terme « fonderie » désigne aussi bien l’établissement qui permet d’obtenir le métal brut à partir du minerai que la transformation de ce métal en objets moulés. L’exploitation des mines polymétalliques réparties d’Auxelles à Rougemont consommait du charbon de bois en grande quantité à différentes étapes du traitement du minerai ; prenons l’exemple du plomb qui se trouve dans les filons métallifères sous la forme de sulfure de plomb, communément appelée galène, de formule chimique PbS. Après tri, lavage et concassage, la galène est d’abord « grillée » à une température de 700 degrés environ pour éliminer le soufre. Celui-ci se transforme en gaz sulfureux (SO2) qui s’échappe dans l’atmosphère. Le plomb est oxydé par la même opération. L’oxyde de plomb (PbO) recueilli est traité ensuite à 900 degrés par une réduction à l’aide du carbone fourni directement par le charbon de bois avec lequel il est mélangé. Les étapes suivantes comme l’affinage, représenté par Heinrich Gross sur le volet de droite de la Fig. 1, sont également consommatrices de charbon.
La sidérurgie
La fabrication de l’outillage des mineurs, comme celui des artisans et des paysans, exigeait beaucoup de fer, d’acier et de fonte. Fort heureusement la région de Belfort est naturellement favorisée pour la production de fer : il suffit de se baisser pour trouver du minerai de fer à Eguenigue ou à Roppe. Il se présente sous la forme de granules qui font penser à des grains de café (Fig. 3) noyés dans une gangue argileuse. Il s’agit d’oxyde de fer (Fe2O3) de forme oolithique (grains de diamètre inférieur à 2mm) et pisolithique (taille pouvant dépasser 10mm). On sépare le minerai de la terre qui l’englobe par lavage. Avant de nécessiter le fonçage de puits de mines jusqu’à 100 mètres de profondeur, l’extraction s’est effectuée d’abord à ciel ouvert comme dans le cas de la minière d’Eguenique située au milieu des installations de la société Colas à la sortie de Roppe sur la D83 en direction de l’Alsace (Fig. 4). Les mines de Roppe et d’Eguenigue ont été exploitées jusqu’au milieu du 19è siècle.
La transformation du minerai de fer en fonte s’effectuait dans un haut-fourneau comme ceux qui étaient installés à Bethonvillers et à Belfort, dans le quartier du Fourneau, justement. Les principes physico-chimiques de l’opération s’apparentent à ceux que nous avons vu plus haut pour la réduction des oxydes de métaux non ferreux : chauffer très fort un mélange de minerai et de charbon de bois réduits en poudre. Par un processus assez complexe et qui ne peut être mené que par des ouvriers expérimentés, l’oxyde de fer perd son oxygène en même temps qu’il se charge de carbone pour former de la fonte (« alliage » de fer et de carbone) dont le point de fusion est inférieur aux températures limites que l’on pouvait obtenir avant le milieu du 19e siècle. Avant que l’industrie puisse disposer en quantités suffisantes de coke, l’affinage et la décarburation de la fonte pour obtenir de l’acier réclamaient encore de belles quantités de charbon de bois.
Les forges
L’acier et le fer obtenus à la sortie du haut-fourneau doivent encore être transformés pour être utilisables. C’est le rôle des forges, martinets, fenderies, platineries et taillanderies qui réclamaient beaucoup de charbon de bois pour chauffer le métal afin de le rendre malléable. Actuellement le terme de « forges » désigne l’atelier dans lequel le forgeron façonne le métal (le fer ou l’acier doux) pour lui donner la forme voulue : une belle grille ou un fer à cheval ; autrefois la forge était l’usine où la fonte était purifiée, affinée, pour en éliminer les impuretés comme le silicium, le phosphore…
Mais il n’était pas rare que toute la chaîne de production de la fonte, du fer et de l’acier, du haut-fourneau jusqu’à la taillanderie qui fabriquait le produit fini, soit désignée sous le terme de forges. Les Forges d’Audincourt (département du Doubs) en sont un bel exemple.
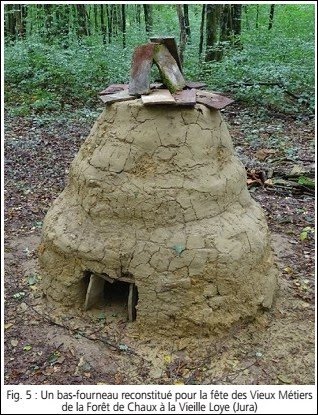
La gueuse, lourde barre de fonte brute coulée dans une rigole de sable au pied du haut-fourneau, était de nouveau portée à incandescence dans une fournaise où se consumait du charbon de bois en présence d’air injecté sous pression à l’aide de soufflets, le but étant cette fois de décarburer le métal pour en faire une loupe(bloc de fer incandescent). C’était l’opération d’affinage qui s’effectuait dans un atelier qui était tout simplement appelé affinerie ou encore renardière selon la méthode et le type d’installation utilisés. Le bloc de métal chauffé à blanc était battu avec un lourd marteau pour en expulser les impuretés : c’était l’opération de cinglage. Ce gros marteau appelé martinet a donné son nom à l’atelier qui l’abritait et son souvenir perdure dans la toponymie à Offemont. Avant l’utilisation de la machine à vapeur il était animé par la force d’une roue hydraulique et se trouvait par conséquent tout près d’un cours d’eau. Bien sûr, il était nécessaire de réchauffer fréquemment la loupe (appelée renard dans les renardières) pendant le travail d’affinage et c’est encore le charbon de bois qui était mis à contribution.
Le charbon de bois et l’histoire de l’industrie métallurgique
Comme le charbon de bois était indispensable dans l’industrie métallurgique jusqu’au 19e siècle et servait principalement à cette dernière, on peut tenter d’établir une histoire des charbonniers à travers les âges en se basant sur celle de la production et de la transformation des métaux.
Aux temps préhistoriques
De quand date la première transformation métallurgique opérée par un homme ? Ou plutôt : quand le premier charbonnier a-t-il livré le résultat de sa première carbonisation à son collègue, le premier fondeur du Pays sous-vosgien ? À l’âge du Bronze ? À l’âge du Fer ? Il ne faut pas compter sur les archives pour nous le dire et Jean-François Piningre, dans un article publié en 2007 débute son introduction par une constatation peu optimiste : « L’approche des périodes couvrant les âges du Bronze (2300 à 800 avant J.-C.) et le Premier âge du Fer ou période de Hallstatt (800 à 450 av. J.-C.) dans la Trouée de Belfort laisse en première analyse une impression de vide documentaire ».
Heureusement, dans la section intitulée Le Bronze ancien et les débuts de la métallurgie de la même publication, il nous redonne espoir : « Toutefois, depuis peu, les témoignages de paléopollutions métalliques datées de 1900 av. J.-C., décelées par l’étude de carottes prélevées dans la tourbière de Rosely à Plancher-les-Mines (Haute-Saône), témoignent de l’exploitation de minerais de cuivre vosgiens dès le Bronze ancien. ». Les vapeurs des métaux obtenus dans les fonderies se sont déposées dans l’environnement de celles-ci en laissant des traces que les instruments de mesures actuels nous permettent de déceler. On peut imaginer en passant que lesdites vapeurs ont dû être respirées par les fondeurs de l’époque et provoquer chez eux des…
(La suite dans : Les traces des charbonniers en montagne (2e partie), par Roland GUILLAUME, page 60)
L’école de Riervescemont, en remontant le temps…
1863 : « Considérant que les habitations se trouvent dispersées dans la montagne, il est de la plus grande nécessité, pour la commodité de chacun, de construire immédiatement la maison
d’école dans le centre de la commune »
En janvier 1862 la commune projette d’acheterla maison Piot qui sert d’école, mais en août suivant, l’inspecteur d’académie refuse cette acquisition « qui ne convient point à cette destination pour les motifs suivants : cette maison n’occupe pas un point central, elle est placée vers l’une des extrémités du hameau qui s’étend sur une longueur de plus de trois kilomètres ; ensuite elle est d’un accès très difficile en hiver puisqu’elle est bâtie sur le penchant d’une montagne rapide à plus de 50 mètres du fond de la vallée ;enfin elle est contiguë à un cabaret, le seul du hameau ;de plus la maison n’est nullement telle qu’on l’a décrite dans l’extrait du registre des délibérations du 15 janvier 1862… »
Serait-ce cette mairie quiaurait brûlé avec les archives de l’époque, selon les dires de nos Anciens ? La question reste posée…
De 1819 à 1832 il n’existait aucun bâtiment communal à Riervescemont. Le maire Jean-Baptiste Piot offrait alors sa maison d’habitation en échange d’une indemnité de la commune. En 1858, c’est Jean-Georges Piot qui louait une salle pour l’école par simple convention verbale ; un instituteur du même nom était en poste le 28 janvier 1843 avec 42 élèves en hiver et 19 en été !
Quelques noms d’instituteurs avant la construction du bâtiment communal
Les archives nous livrent quelques noms et quelques dates, hélas parcellaires : janvier-février 1858, PierreJoseph Renoux. En décembre de la même année : Charles Barberot. En 1865 : Jules Théophile François Xavier Gasser, père de l’illustre enfant de Riervescemont, Jules Théophile Gasser, né le 11 avril 1865 (médecin, chirurgien, conseiller général, maire d’Oran, sénateur, commandeur de l’Ordre de la Légion d’Honneur, candidat à l’élection présidentielle de 1947) [voir La Vôge n°45-2017]. La mère de Jules Gasser, Marie Marchal, native elle-aussi de Riervescemont, était la petite-fille de Jean-Baptiste Piot, maire du village de 1814 à 1843.
En 1878 : Jean-Baptiste Fréchin, qui succède M. Reiniche, enseignera à Riervescemont jusqu’en 1919.

Construction d’une maison d’école
Le 6 mars 1863, le conseil municipal de «RièreVescemont » délibère afin de construire une « Maison d’Ecole dans le centre de la Commune». La délibération du conseil municipal est rédigée comme suit :
« Considérant que les habitations se trouvent dispersées dans la montagne, il est de la plus grande nécessité, pour la commodité de chacun, de construire immédiatement la maison d’école dans le centre de la Commune. Après avoir examiné les terrains les plus propres pour l’emplacement de la dite maison, le Conseil, sur la proposition de M. le Maire a décidé que le pré appartenant aux Sieurs Piot Georges et Piot Jean Baptiste, propriétaires à Rière Vescemont, (sic) situé au centre de la Commune, section B n° 227 du plan, de la contenance d’environ six ares, était celui qui présentait la meilleure position. En conséquence, le Conseil après avoir débattu le prix avec les propriétaires, qui consentent à céder leur terrain à la Commune, accepte le dit pré à raison de Soixante francs l’are. Il prie M. le Préfet de vouloir bien l’autoriser à faire cette acquisition.»
Cette délibération est signée par le maire François Fergeux Piot.
Les plans pour la construction de la maison d’école prévoient :
- un rez-de-chaussée comportant deux entrées séparées : celle des filles à droite du bâtiment et celle des garçons à gauche, avant le corridor et les escaliers menant à l’étage.
- une grande salle d’école pouvant accueillir 60…
(La suite dans : L’école de Riervescemont, en remontant le temps…, par Marthe PELTIER, page 71)
Auxelles-Haut autrefois… une petite cité industrielle !
Auxelles-Haut : en découvrant aujourd’hui ce petit village, ce cadre champêtre, on a du mal à imaginer qu’il a participé, dès le XVIè siècle, au développement du premier pôle industriel de toute la région de Belfort, l’exploitation des mines du Rosemont. Le château et le village d’Auxelles, comme la plupart des villages du Pays sous-vosgien, apparaissent dans les textes dès le XIIe siècle. Cette petite agglomération est citée sous différents noms : Acellis, Acella, Aucella… Primitivement, c’est le village qui semble avoir reçu cette dénomination, mais l’antériorité du village par rapport au château n’a pas été formellement démontrée. Le château domine les maisons d’un village appelé Assel en 1521. Il ne s’agit pas d’Auxelles-Haut, mais d’Auxelles-Bas. Auxelles-Haut est un village récent.
La création du village Ober Assel
La création du village est liée à ce qu’on peut appeler une première mondialisation. Depuis le milieu du XVè siècle, l’or d’Afrique subsaharienne arrive en Europe par le Maghreb, débouché des routes caravanières du Sahara, et par Lisbonne, port d’attache des marins portugais qui ont fait des côtes africaines leur chasse gardée. Cette partie d’Afrique est en effet la première pourvoyeuse mondiale d’or jusqu’en 1492, date de la découverte de l’Amérique. L’or d’Amérique et les trésors précolombiens prennent alors le relais des sources africaines. Le stock d’or augmente en Europe (même si les Rosemontois n’en voient pas la couleur), désormais il arrive par l’Espagne. La conséquence est l’augmentation du prix de l’argent, un métal rare qui, pour l’essentiel, vient d’Europe centrale. En Saxe et dans les territoires autrichiens et hongrois des Habsbourg, les mines d’argent sont exploitées au maximum pendant un demi-siècle. Mais la découverte des mines d’argent américaines va tout bouleverser. En 1545, la découverte et l’exploitation des mines d’argent de Potosi au Pérou (en Bolivie aujourd’hui), de Zacatecas au Mexique, vont provoquer une crise économique dans les régions minières d’Europe centrale. Les mines de Potosi sont exploitées par un système de corvées imposé aux Indiens, la main d’œuvre est très bon marché. Les conditions de travail sont épouvantables, la mortalité terrible : Potosi était considérée par le dominicain Domingo de Santo Tomãs comme l’une des « bouches de l’enfer ». Les mines en Europe supportent mal cette concurrence, les mineurs y sont payés correctement et une ébauche de protection sociale a même été mise en place pour assurer la subsistance des familles de mineurs victimes d’accident.
En Saxe, en Autriche, certaines mines sont acculées à la faillite par manque de rentabilité et de nombreux mineurs perdent leur emploi.
Les filons d’argent et de plomb du Pays sous-vosgien étant prometteurs, ces mineurs vont venir en nombre, probablement à l’instigation de Ferdinand d’Autriche, frère de Charles Quint, souverain de la région de Belfort qui est alors la partie francophone de l’Autriche. La tutelle de la maison d’Autriche ne semble pas avoir été pesante pour les habitants. En effet, en 1525, à l’annonce de la défaite des troupes françaises à Pavie survenue le 24 février, les Belfortains ont fait « un feug de joye » pour fêter la capture de François 1er et de la fine fleur de la noblesse française par l’armée de Charles Quint. En revanche, dans le royaume de France, le traumatisme est réel, il renvoie aux pires jours de la guerre de Cent Ans…
À l’extrême-ouest de l’Autriche antérieure, Vorderösterreich, au-dessus du vieil Assel et du promontoire du château, un nouveau village s’est rapidement constitué, peuplé de migrants germaniques. Ce nouveau village, Neudorf en allemand, a vite posé des problèmes. Les Rosemontois ont mal vécu l’arrivée de ces nombreux étrangers auxquels ils ont trouvé tous les défauts. Les migrants sont jugés grossiers. Les Saxons et les Autrichiens parlent une langue germanique. Les Saxons sont de religion réformée, des protestants. Tous les mineurs dépendent de la justice des mines de Giromagny, justice des Habsbourg, archiducs d’Autriche.
Tout oppose les nouveaux arrivants aux habitants du vieil Assel qui parlent français, sont catholiques, et dépendent de la juridiction des Ferrette détenteurs du fief depuis 1520. Le choc culturel est rude pour les autochtones ; la société traditionnelle de l’époque, en territoire Habsbourg comme dans le royaume de France, est marquée par l’esprit de clocher, par un idéal d’enracinement ; elle laisse peu de place à la mobilité. Celle-ci ne s’exerce généralement pas sur de grandes distances et l’espace de vie de la plupart des ruraux se réduit à leur village et aux paroisses environnantes.
L’arrivée des migrants génère une situation exceptionnelle, provoque de nombreux litiges, et, peut-être pour éviter des incidents graves (comme à Giromagny où en 1564 les Rosemontois incendient les habitations des mineurs autrichiens), Ferdinand crée le 14 janvier 1569 le village d’Auxelles-Haut, ou plutôt officialise l’autonomie du nouveau village d’Ober Assel, par opposition à Auxelles-Bas, Nieder Assel. En 1593 on dénombre 130 maisons de mineurs à Ober Assel, seules six d’entre elles sont occupées par des Rosemontois. La population avoisine 650 habitants, il y en a 1 200 à Belfort. Au début du XVIIè siècle, Ober Assel et l’ensemble du Pays sous-vosgien constituent le pôle industriel de la région de Belfort. L’exploitation minière a entraîné le développement d’activités annexes : les fonderies, une forge industrielle à Etueffont (à l’emplacement actuel de la piscine), l’exploitation intensive des forêts par les charbonniers. La croissance industrielle de la Haute Savoureuse n’est pas le seul élément important de l’évolution économique du XVIè siècle. La hausse générale des prix a frappé l’esprit des contemporains. Ce phénomène n’est donc pas propre au XXè siècle ; Jean Bodin, magistrat et économiste français (1530-1596) est l’un des premiers théoriciens de l’inflation. Il rédige en 1568 sa Réponse aux paradoxes de monsieur de Malestroit, dans laquelle il attribue « la grande cherté de toute chose » à l’arrivée massive en Espagne d’or et d’argent d’Amérique. Cet afflux de richesses en Europe après 1550, même si ce n’est pas le seul moteur de l’inflation, va avoir un caractère malsain ; au-delà des flambées habituelles des prix des céréales après chaque mauvaise récolte, il va provoquer une hausse importante de leur prix sur le long terme, entre autres une hausse du seigle, élément essentiel de l’alimentation des habitants du Pays sous-vosgien, consommé sous forme de pains mais aussi et surtout sous forme de bouillies. Et l’afflux d’argent ne concerne en rien les petites gens !
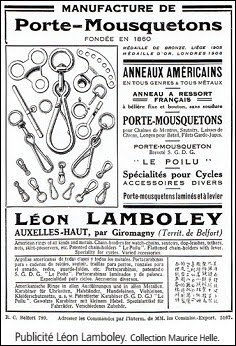
La guerre de Trente ans et le retour à la France
La guerre de Trente ans, période probablement la plus sinistre de l’histoire de la région, va mettre fin à un petit siècle de prospérité liée aux mines. Ce conflit est né en Bohême, à Prague en 1618, conflit où se mélangent des causes religieuses et politiques. Les conséquences seront désastreuses pour une partie de l’Europe. Dans le Pays sous-vosgien, touché entre 1633 et 1648, les armées vont se succéder : Suédois, Impériaux, Croates, Lorrains, Français. Les soldats, mal payés, mal nourris, mal vêtus, n’hésitent pas à piller, violer, torturer ; troupes amies, troupes ennemies, les comportements diffèrent peu. Conséquence des méfaits de la soldatesque et du pillage, la population est victime de la famine et de la peste.
La paix revenue, avec les traités de Wesphalie en 1648, il reste moins de 200 habitants à Ober Assel, moins de 500 à Belfort. Avec ces traités, la région de Belfort, qui incarnait bien « cette souveraineté singulière que les Habsbourg exerçaient sur leurs domaines, à la fois lointaine et attentive », devient française. L’activité minière va être relancée, mais elle n’aura
plus…
(La suite dans : Auxelles-Haut autrefois… une petite cité industrielle !, par Bernard PERREZ, page 74)
Le kiosque à musique de Valdoie
Liés au développement des sociétés de musique au XIXe siècle, véritables édifices urbains construits pour le divertissement, les kiosques sont synonymes d’espaces ouverts et d’endroits
de convivialité. Valdoie eut le privilège d’en posséder un, entre 1909 et 1949. Son histoire est particulière, depuis sa naissance dans l’enthousiasme jusqu’à sa disparition dans l’indifférence…
Coups d’œil sur l’histoire
Du début des sociétés de musique aux premiers kiosques
Les premières sociétés de musique amateur sont apparues en France dans la première moitié du XIXè siècle. Plusieurs éléments précurseurs sont significatifs de cette époque :
- la création en 1792 de l’Institut National de la Musique, consacré à la formation des musiciens,
- la grande idée des philanthropes vers 1820 de développer, entre autres, l’enseignement du chant et de la musique dans les écoles,
- la maîtrise du travail des métaux et des alliages de cuivre permettant la création d’instruments de musique fiables d’un coût accessible.
La troisième révolution française arriva, celle de 1848. Elle proclama la Seconde République le 24 février. Le ministre de l’Intérieur Antoine Marie Jules Senard adressa une lettre aux préfets le
15 juillet 1848, donnant autorisation de se produire en plein air et en public « à la condition que ces rassemblements aient lieu en des endroits au préalable définis et facilement cernables par les forces de police en cas d’apparition de troubles. »
Les rassemblements en plein air sont donc autorisés. Que faut-il de plus ?
Les musiques amateurs existent, le peuple a le droit de se rassembler dans un endroit bien défini, les musiques militaires dans les villes de garnison se produisent déjà en concert : alors, le moment est venu, car sans attendre, le premier kiosque, symbole de l’appropriation de la rue par les citoyens, est construit en France. C’est à Metz, ville de garnison, en 1852.
Les kiosques en France et à Belfort
En France, 4 000 kiosques ont été édifiés durant la seconde moitié du XIXe siècle, principalement sous la IIIe République, dans cette période appelée Belle Époque, et en grand nombre dans l’Est de la France. A Belfort, place d’Armes, un premier kiosque en bois et découvert a existé devant la cathédrale Saint-Christophe, entre 1877 et 1904 ; il a été reconstruit dans sa forme définitive en 1905 devant la mairie (afin de ne pas gêner les offices religieux). Le kiosque de la Roseraie a été bâti en 1912, sur un terrain appartenant à la SACM.
Le kiosque de Valdoie
Deux événements locaux concourent à la création du kiosque de Valdoie. Tout d’abord l’implantation à Valdoie en 1880 de la filature de laine peignée Schwartz originaire de Mulhouse. Cette entreprise a été importante : 292 personnes en 1889, chaudière et machines à vapeur, construction de logements et de maisons pour le personnel. Elle disparaît en 1929. Souvenons-nous que de nombreuses entreprises alsaciennes ont quitté l’Alsace après la défaite de 1870, comme la SACM qui s’installa à Belfort et qui deviendra Alsthom en 1928. Et ensuite en 1882, la création de la fanfare de Valdoie par l’entreprise Schwartz et son directeur Jules Chambaud « pour occuper sainement les loisirs des ouvriers». Les statuts sont déposés dix ans plus tard, le 19 juillet 1892. L’entreprise a mis des locaux à la disposition de la fanfare et a participé à son financement, notamment pour le salaire du chef et les achats d’instruments, de partitions et d’uniformes.

La construction du kiosque : une initiative de la Fanfare en 1908 et un transfert organisé
Depuis quelques années, la Fanfare souhaitait qu’un kiosque soit construit à Valdoie, sans doute à l’image de celui érigé à Belfort, place d’Armes en 1904. Sans réponse favorable de la commune, mais très probablement en accord avec elle, la Fanfare a alors pris une initiative volontariste importante : elle financera elle-même la construction du kiosque tant attendu. Et à cet effet, elle va organiser une tombola durant l’année 1908. Cette initiative fut un grand succès : plus de 6 000 billets vendus. Le tirage a été effectué le 20 décembre, avec 330 gagnants, la liste des numéros gagnants étant publiée dans la presse (journal La Frontière du 24 décembre 1908) et les lots devant être retirés avant le 20 mars 1909.
Par ailleurs, il était entendu que la Commune deviendrait propriétaire du kiosque après sa construction, puisqu’il serait installé sur un terrain communal. Et puis, tout s’enchaîne très vite.
D’abord, lors de la séance du 23 décembre 1908, le Conseil municipal (maire Emile Romond) demande à monsieur Scheib (président de la Fanfare et directeur de l’entreprise Schwartz) et à la commission travaux de la commune de proposer un emplacement. Proposition : devant l’école des filles, sur la pointe de la cour en déplaçant la grille (en réalité devant l’école
maternelle). Ensuite, le 29 janvier 1909, le Conseil municipal donne accord sur l’emplacement proposé : « ne gênant nullement à la circulation des piétons et des voitures, au contraire cela donnerait plus de dégagement à la place et à la rue et supprimerait le tournant si brusque à cet endroit».
La commune acte également que le kiosque lui appartiendra et attribue à la Fanfare une subvention exceptionnelle de 1 000 francs qui sera versée en deux fois : en 1909 et 1910. Le 10 juin 1909, le préfet, d’une part approuve les décisions du Conseil municipal (la construction et son emplacement) et d’autre part valide l’opération de transfert de propriété. Le kiosque a donc été construit
rapidement, dès la fin du printemps et durant l’été car les premiers concerts y sont donnés lors de son inauguration le 5 septembre 1909 par la fanfare de Valdoie.
La description et le coût du kiosque
Les documents archivés ne nous ont pas renseignés sur sa description, les appels d’offres et le constructeur, les dates réelles des travaux… Toutefois l’examen des photos d’époque permet
d’en donner une description assez précise : forme hexagonale, soubassement en pierre avec faces décorées, garde-corps en fer forgé, six colonnes (sans doute en fonte), toit conique aplati, frises sous le toit. Il était à l’évidence plus simple et de plus petite taille que les kiosques de Belfort, place d’Armes et Roseraie, qui sont octogonaux avec huit colonnes, toit arrondi et décorations plus fines.
La construction du kiosque a coûté 4 000 francs. Son financement a été assuré par le produit de la tombola de la Fanfare (2 600 francs), la subvention exceptionnelle de la commune (1 000 francs) et par des dons particuliers (400 francs). A titre de comparaison, on notera que le coût du kiosque de la Roseraie érigé en 1912, était de 9 500 francs, son constructeur étant l’entreprise Henri Grille de Belfort. Cette différence de coût peut s’expliquer par la petite taille du kiosque de Valdoie, mais aussi probablement par une qualité moindre.
Les travaux d’entretien
Étant devenu propriétaire, la commune a fait réaliser quelques travaux d’entretien juste après la Grande Guerre. Le kiosque est repeint en 1919 (coût 257 francs). De plus en 1920, lors de l’installation électrique pour alimenter la mairie et les salles de classe, il est équipé d’un éclairage électrique «ce qui remplacera avantageusement le…
(La suite dans : Le kiosque à musique de Valdoie, par Claude PARIETTI, page 87)
Clap de fin pour la quincaillerie Schenck de Giromagny
À partir des années 1930, la flamme postale apposée sur le courrier au départ de Giromagny promouvait la commune en vantant son air pur et son centre touristique. Quelques décennies plus tard, Giromagny reste connue bien au-delà du Pays sous-vosgien, pour son originalité : celle de posséder trois quincailleries. Ce type de petit commerce s’étant éteint progressivement, il est courant que les Terrifortains « montent » à Giromagny pour rechercher tel ou tel objet introuvable sur la place de Belfort. Bien ancrée dans le paysage sous-vosgien, la quincaillerie Schenck s’est éteinte après plus de 150 années d’activité à Giromagny.
Aloïse 1839-1920, le fondateur
Aloyse (Aloïse) Schenck, est né à Thann le 2 janvier 1839. Avec sa mère Catherine et son beau-père, il aménage à Giromagny vers ses dix ans. Le registre du dénombrement de la population de l’époque nous apprend que sa famille habite tout d’abord Grand-Place, puis faubourg de Belfort et qu’en 1856, à 17 ans, Aloïse exerce la profession de ferblantier. On peut penser que le jeune Aloïse a pu être conseillé par son beau-père, chaudronnier, ces deux professions ayant en commun le travail du métal. L’un travaillait le fer et l’étain, l’autre le cuivre.
Au XIXè siècle, les ferblantiers fabriquaient et vendaient des ustensiles en fer-blanc tels que des casseroles, assiettes ou bassines. De mémoire familiale, on sait que l’aïeul ne fabriquait pas d’assiettes mais des moules à gâteaux.
Quelques années plus tard, le père de famille, s’installe dans une maison du quartier du Hautôt, devenu successivement route de Rougegoutte puis rue André Maginot, au n°3. Comme l’atteste une facture de 1894, Aloïse Schenck intervient sur les toitures, répare, peint les chéneaux. Il vend et pose des éviers en fonte émaillée et propose à la vente : couteaux de poche et de table, couverts en fer battu, cafetières, fers à repasser, lampes, tuyaux de poêles… bref, articles en tout genre que l’on peut trouver dans une quincaillerie. La maison Schenck vendait des couleurs en poudre ainsi que articles funéraires.

Edouard 1880-1945
Édouard né en 1880, fils d’Aloïse, a appris le travail de ferblantier avec son père. Le moment venu, il lui succède à la tête de l’entreprise et poursuit l’activité, aidé par son épouse, Marie. Un papier à en-tête de 1912, indique : « Entreprise de travaux de ferblanterie, zinguerie et couverture ». Édouard Schenck vend des cuisinières d’Alsace, des fourneaux, des verres à vitre, du papier peint, des ressorts de sommiers, des objets presque oubliés à ce jour comme des faux et des pierres à faux, etc.
Paul 1912-1986
Leur fils Paul, né en 1912, prendra la suite du commerce. Il n’est alors plus question de couverts et casseroles en fer-blanc dans les étals mais de droguerie, d’articles de quincaillerie, d’articles de ménage, de vaisselles pour liste de mariage. La quantité de matériel était achetée selon les besoins. Les plus de 50 ans se souviennent des petits casiers de bois accrochés au comptoir comprenant des pointes et des clous de différentes tailles. Ils étaient vendus à l’unité et au poids et non pas par paquet de 10 ou 20 comme…
(La suite dans : Clap de fin pour la quincaillerie Schenck de Giromagny, par Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ, page 87)
1939-1945, une enfance au pied du ballon d’Alsace
L’article qui suit est une évocation des souvenirs d’Hubert Mathieu. Né le 14 avril 1935 à Lepuix-Gy, Hubert a vécu entre 1939 et 1945 à Malvaux et a vu bien des événements survenus dans le secteur sous-vosgien lors du second conflit mondial. J’ai rencontré Hubert dans le cadre de ses activités au sein du club cycliste de l’ACTB en 2017. Malgré son âge, Hubert était encore très impliqué dans la formation des jeunes coureurs. Après quelques discussions, il a accepté d’évoquer les souvenirs de cette difficile période que fut pour lui l’occupation et la libération. Son témoignage oral et écrit est la base de cet article. Il ne se veut pas exhaustif. Ce sont des éléments qui émergent et évoquent des moments souvent tragiques, toujours passionnants, que j’ai essayé d’éclairer par quelques recherches. Un prochain article évoquera avec plus de détails et d’éclairages historiques l’année 1944 entre Malvaux et le massif du Ballon. Pour aujourd’hui, écoutons simplement Hubert nous raconter ses mémoires.
Préliminaires à la guerre…
Il est indispensable pour démarrer et suivre cet article de poser quelques bases généalogiques. Plusieurs membres de la famille vont avoir un rôle dans cette histoire et il convient de les connaître quelque peu avant toute lecture. Hubert Mathieu est né à Lepuix-Gy. Il est le deuxième fils d’une fratrie de trois garçons : Roger né à Malvaux en 1932 est son ainé et Roland né en 1937 a complété la famille. Ses parents sont également originaires du pays sous-vosgien. Le père, Lucien Mathieu est né à Giromagny en 1907 et sa mère Marie-Anne Mathieu est née Haas en 1901 à Lepuix-Gy.
Elle est la fille de Charles-François Haas, né en 1869 également à Lepuix-Gy. Il y a donc un lien étroit entre la famille et la vallée étroite qui mène au ballon d’Alsace. En 1936, le père, Lucien, travaille au Tissage du pont à Lepuix mais il se retrouve au chômage comme tant d’ouvriers dans cette période où la grande crise économique fait encore des dégâts en France.
Il trouve du travail pour quelques temps en participant à la construction du chemin Marcel Tassion mais en 1937, il faut que la famille quitte la proximité des sommets vosgiens pour rejoindre la ville de Belfort. Grâce à son beau-frère Henri Valette, Lucien trouve un emploi à la ville de Belfort. « Courant septembre, Père trouve un emploi de cantonnier à la ville de Belfort ainsi qu’un logement au 4 rue Siegfried à Belfort. » Henri Valette, dont nous reparlerons plus tard est un peu plus âgé que Lucien. Né en 1891 à Millau, employé à la SNCF, il est en poste à Belfort et s’est marié avec la tante d’Hubert Mathieu, Maria Haas, née à Giromagny en 1896. Ils ont un fils, cousin d’Hubert, Lucien Valette, né en 1922. « C’était l’avant-guerre. Nous vivions heureux à Belfort. Je me souviens des joyeux noëls ainsi que des défilés des troupes le 14 juillet et de la fête foraine. »

Mais les rumeurs de guerre avec l’Allemagne s’amplifient. Lucien, qui a effectué son service militaire en Tunisie entre 1927 et 1928 au 72e RTT en tant que 2e canonnier, est rappelé au sein de la même unité en août 1939. Il effectue cette période d’abord à Valdoie. La guerre commence et pour le très jeune Hubert, c’est aussi le début d’une période riche en souvenirs, parfois exaltants, souvent dramatiques.
« Dès le mois d’août, nous étions avertis que la guerre était inévitable. Père reçut l’ordre de mobilisation pour le 72e RTT, 9e compagnie, présence au corps le 5 septembre 1939. Fin août, la petite famille quitte Belfort et va se réfugier chez le grand père Charles Haas, 70 ans, habitant route du Ballon à Lepuix-Gy. La grand-mère Sophie étant décédée en 1938, Grand-Père étant seul, il nous hébergea de septembre 1939 à septembre 1945. (…) Au début, c’est pour nous de belles vacances à la campagne, les travaux à la ferme, les récoltes de pomme de terre, les fruits à cueillir, le cochon à tuer, la goutte à distiller (…) l’hiver avec beaucoup de neige faisait notre joie. Nous vivions bien chez Grand-Père mais il nous manquait notre père, de qui nous étions sans nouvelles. Il se battait face à l’ennemi qui envahissait notre pays par le nord (…). »
1939-1940 : Les tribulations d’un soldat français
Pour l’armée française, c’est vite la débâcle et la fin des combats. Avec les restes de son régiment, Lucien est capturé dans le secteur d’Ecot, dans le Doubs, à la fin du mois de juin 1940. Pour lui, commence le long chemin du prisonnier de guerre. Il est d’abord envoyé au frontstalag 142 à la citadelle de Besançon. De là, il est prévu que les soldats français capturés rejoignent en train l’Allemagne pour y être internés. Dans la mémoire d’Hubert Mathieu, « en août 1940 il y était encore et il devait être envoyé par train en Allemagne. Avec la complicité de cheminots, au courant, il a pu s’évader à Belfort avec d’autres hommes. Le train avait volontairement été mis sur une voie de garage à Belfort. Il s’est caché chez Lucien Valette. ». Il est en effet très probable que le beau-frère de Lucien Mathieu, Henri Valette, ait en grande partie organisé cette évasion en gare de Belfort. Mis au courant du passage d’un train de prisonniers en partance vers l’Allemagne et dans lequel se trouvait Lucien, il aura réussi à le placer de telle manière qu’une évasion soit facilitée. Quoiqu’il en soit, Lucien Mathieu a échappé aux camps de prisonniers allemands et il doit d’abord se cacher. Il faut dès lors faire très attention. De faux papiers attestant de sa présence à Belfort sont nécessaires. Selon Hubert, c’est grâce au révérend-père Henri Schwander de la maison des Pères de Cravanche que de nouveaux papiers sont établis. La maison des Pères abrite depuis 1934 des membres de la congrégation des rédemptoristes d’Alsace. C’est là qu’un embryon de résistance se serait créé, fournissant des faux papiers aux proscrits de toute sorte, fort nombreux à cette époque. Dans un premier temps, Lucien se cache chez Henri Valette, son beau-frère. Le fils de ce dernier, Lucien Valette, chef routier scout, demeure à Belfort au 7 rue Briand. Il a entendu l’appel d’un général inconnu, Charles de Gaulle et souhaite le rejoindre pour continuer le combat. Il lui propose de partir avec lui mais Lucien Mathieu souhaite résister sur place, probablement conscient de ses responsabilités familiales. Pour l’histoire, Lucien Valette rejoindra la zone libre puis l’Afrique du Nord. Il s’engagera dans l’armée, passa par l’école militaire de Cherchell d’où il sort aspirant à 22 ans. Probablement parachuté en France, il combattra avec le groupe de sabotage du maquis Paul Claie. Il sera tué (fusillé) le 22 août 1944 à La Pezade lors des combats de la Libération. Pour l’heure, Lucien Valette même muni de ses vrais-faux papiers doit être attentif. Officiellement démobilisé le 12 septembre 1941, il retourne à la vie civile. Est-ce à ce moment qu’il rejoint officiellement un groupe de résistance avec Henri Valette ? Quel groupe ? Pour quelles actions ? Les souvenirs d’Hubert manquent de précision sur ce sujet. Il n’était qu’un enfant et on ne parlait pas de ces choses là. De plus, étant éloigné à Malvaux, il n’a pas le loisir de voir son père tous les jours. Par contre, il vit l’arrivée des Allemands dans le secteur en direct ! « Dès le printemps, les militaires défendirent la route du Ballon, creusant des tranchées, installant des postes de défense avec mitrailleuses. Maman gagnait un peu d’argent en lavant et repassant les pantalons et chemises des officiers. (…).

Pendant que Roger, mon grand frère, 8 ans, fréquentait l’école de Malvaux, Yvonne, une jeune fille de 14 ans aidait Maman et s’occupait de mon frère Roland, 3 ans et de moi (…) Les Allemands étaient annoncés. Un avion allemand en flammes touché par un tir de mitrailleuse, rasant la maison, est allé s’écraser dans les bois ». À ce jour, des recherches préliminaires n’ont pas permis de confirmer ce fait. Il n’existe pas a priori d’autres témoins de cet événement qui reste du domaine du conditionnel.
L’arrivée des troupes allemandes crée une véritable panique. Des rumeurs d’exactions se répandent et Charles Haas juge plus prudent de mettre la famille à l’abri. L’unique vache familiale est attelée à une voiture et tout le monde se met en sécurité en juin 1940 au lieu-dit « la Côte », dans la maison de la tante Marthe. Cette précaution n’aura peut-être pas été inutile, au retour, la famille découvre la maison de la route de Belfort pillée. « Nous fîmes connaissance avec l’ennemi, des cosaques ou russes blancs, qui montaient de petits chevaux, armés de fusils et de lances, toute une section avait pris possession de la propriété voisine de mon grand-père. Le soir, ils chantaient autour d’un grand feu de bois. Ils sont restés cantonnés là une quinzaine de jours, puis de vrais militaires allemands sont venus les remplacer et la maison a été occupée par des officiers. Un matin, nous eûmes leur visite, cherchant des armes. Ils voulaient savoir où était Père. Mère et Grand Père leur firent comprendre qu’ils n’étaient pas la bienvenue et ils nous laissèrent tranquille pour un temps.
Maman reçut une missive de la Croix Rouge nous apprenant que Père était prisonnier à la citadelle de Besançon.». La suite de cette captivité nous est déjà connue ! Une remarque s’impose cependant sur la présence de cavaliers cosaques à Lepuix-Gy en 1940. Il n’y a pas encore à cette date de soldats venus d’URSS dans les rangs de la Wehrmacht. Les premiers enrôlements se feront en novembre 1941. Il y a probablement ici confusion, soit de dates, soit de types de troupes. L’armistice étant signé, Lucien parvient à se faire démobiliser. Il retrouve sa véritable identité et son poste à la voirie de Belfort. C’est à cette époque qu’il aurait eu ses premiers contacts avec la Résistance belfortaine. Il profite d’un stratagème lui permettant de se protéger d’une éventuelle arrestation. Il loge 7 rue Duvillard dans le quartier du Mont à Belfort. Il s’agit là d’un logement rendu insalubre par un incendie. Mais officiellement, il réside toujours 4 rue Siegfried, deux rues plus loin. Ainsi il peut vivre à peu près tranquillement. Cependant, l’étau se resserre en 1943. Probablement dénoncé, il est convoqué à la Kommandantur de Belfort pour renouveler son laissez-passer. Méfiant, Lucien ignore la convocation. Il est temps de…
(La suite dans : 1939-1945, une enfance au pied du ballon d’Alsace, par Stéphane MURET, page 96)
La ferme à galerie, une spécificité architecturale
Il est des domaines où les archives sont peu éloquentes et où l’observation du terrain et la comparaison de l’existant, priment, comme en archéologie.
La ferme traditionnelle de la région est dite ferme à chari. Elle est composée de trois éléments sous un même toit :
- une grange au centre du bâti, qui sépare le logement de l’étable.
- le chari qui est le porche en avant de la grange, il est destiné à abriter un charriot en cas de mauvais temps.
- ce porche a son linteau supérieur qui est, soit formé d’une poutre en bois, soit constitué d’une voûte en grès.
On rencontre de nombreuses fermes le long des routes à Sermamagny, Grosmagny et à Chaux. Leurs façades principales sont, la plupart du temps, orientées vers le sud, ce qui n’a rien de surprenant, le sud étant la direction la plus lumineuse et la plus chaude. Un observateur attentif remarquera cependant qu’un élément revient souvent : il s’agit d’une sorte de balcon situé au-dessus de la façade principale, la plupart du temps au-dessus de la grange.

Prolongement extérieur d’un étage
Quel nom donner à ce type de ferme ? Le terme le plus approprié serait celui de « ferme à galerie ». La Base numérique du patrimoine d’Alsace utilise un terme précis pour ce genre d’élément : la galerie. « La galerie ou balcon est le prolongement extérieur d’un étage, en mur gouttereau ou en pignon, abrité par un débord du toit. La galerie peut être en encorbellement ou portée par des poteaux et peut se trouver aussi bien sur le logis que sur de la grange ».
Les plans de l’Intendance d’Alsace, relatifs aux routes et ponts à construire, fournissent parfois un relevé précis des villages. Quatre plans donnent de précieuses indications sur les villages de Lepuix, Sermamagny, de Valdoie et d’une petite partie de Chaux.
Il ressort de ces plans que les galeries existent dès le XVIIIè siècle. Elles se présentent différemment. Parfois elles sont sans piliers porteurs, enserrées entre les ailes du corps de ferme, parfois elles longent toute la façade et sont soutenues par trois (cas à Chaux) ou quatre piliers (cas à Lepuix). Les plans de Sermamagny et de Valdoie ne sont pas assez précis, mais donnent une idée du nombre de fermes à galerie repérables par leur forme en U. Les photographies et cartes postales anciennes sont malheureusement rares et montrent généralement le côté des fermes situé le long des routes, c’est-à-dire le corps de logis. Hélas, les galeries sont presque toujours cachées derrière le bâtiment voisin. La photographie la plus intéressante concerne Valdoie ; il s’agit d’une carte photo écrite en 1914 (Fi 2484). La galerie dotée d’une belle balustrade, repose sur un pilier central et sert de balcon. Comment se présentaient ces galeries à l’origine ? Aux balustrades en bois plus ou moins travaillées – selon le goût du jour – qui ornent les galeries subsistantes, on pourrait imaginer une façade en bois à claire-voie, un peu comme sur le dessin publié par le CAUE. Cependant rien n’est certain, faute d’une…
(La suite dans : La ferme à galerie, une spécificité architecturale de « la Vôge », par Jean-Christian PEREIRA, page 106)
Histoires de machines… « à percer »
Vers 1900 les matériels de perçage étaient déjà performants et variés, comme on pouvait le voir au Tissage du Pont où avait été réuni un assortiment de perceuses de diverses tailles.
La plus impressionnante, et le mot est faible, était une machine à percer de type américain, qui valait 2700 F en 1913 (soit 8300 € de 2017). Elle pesait 1050 kg et perçait jusqu’à 50 mm de diamètre, au moteur uniquement, avec plusieurs vitesses de rotation par poulies étagées et un réducteur final à engrenages planétaires. La descente mécanique offrait 8 vitesses d’avance et un déclenchement automatique en fin de course.
Plus loin, une « EL 48 » représentait les grosses machines à percer de fonderie, moins sophistiquées, avec des capacités maxi de 18 à 55 mm pour des prix de 300 à 600 F (925 à 1850 €). L’illustration suivante est une machine de ce genre en configuration de base : descente automatique de perçage mais entraînement par manivelle avec volant d’inertie, engrenages non protégés. Les poulies pour fonctionnement au moteur étaient en option (15 à 25 F, 45 à 75 €), ainsi que le couvre-engrenages (10 à 15 F, 30 à 45 €) ; la plupart des machines en furent tôt ou tard équipées.
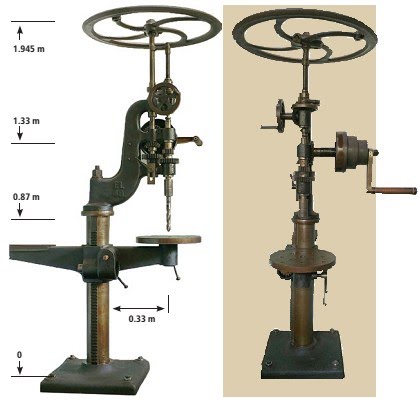
Était aussi exposée une série de perceuses sensitives à descente manuelle par levier, destinées aux travaux légers avec des petits forets fragiles.Ces machines d’établi de capacité réduite (10 à 12 mm), pour la plupart entraînées par poulies, valaient de 90 à 250 F (280 à 770 €). Quelques modèles plus évolués ou plus gros, ne dépassant guère 16 mm, pouvaient atteindre 500 F (1500 €).
La « machine à percer » EL 48
D’apparence tantôt grêle tantôt massive selon la vue, elle se placerait en milieu de gamme, pour 400 à 450 F de 1913 (environ 1300 €), plus 20 F pour les poulies.Composée d’un nombre réduit de pièces robustes, elle est principalement assemblée par goupilles coniques, avec des rattrapages de jeu à bague filetée. La conception est simple mais impose de démonter beaucoup de pièces (dont le lourd volant supérieur) pour accéder au moindre élément.
Le « support de plateau à trous et d’étau » est tournant, à hauteur réglable par crémaillère et vis sans fin. Il comporte deux bras opposés : d’un côté un plateau circulaire tournant, de l’autre une glissière pour un étau spécifique. La descente automatique est d’utilisation incontournable : le petit volant ne permet que l’approche et le dégagement rapide.
Matériaux & marquages
Presque tout est en fonte sauf les arbres, vis et écrous, goupilles et clavettes ; tous les éléments de bâti sont creux. Des grosses lettres « EL 48 » sont venues de fonderie à gauche du bâti ; à droite est rivée une plaque de la maison…
(La suite dans : Histoires de machines… « à percer », par Patrick LACOUR, page 106)
Lo lavou et M’sio lo tiurie
Le lavoir et M. le curé
Texte traduit par André, Colette, Pierre et Louis du groupe « Djoza potois » de la Haute Savoureuse – Illustrations de François Bernardin

(La suite dans : Lo lavou et M’sio lo tiurie, par François Bernardin et le groupe « Djoza potois », page 112)
Magazine
In memoriam par François Sellier
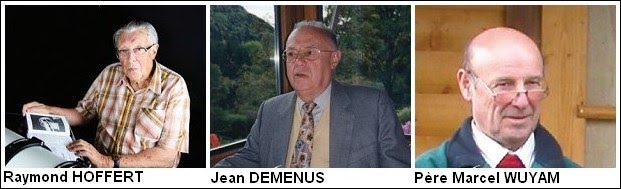
Né en 1925, Raymond Hoffert était une « figure ». Grand, costaud, doté d’une voix de stentor et d’un savoir hors du commun, Raymond fut d’abord instituteur, puis directeur d’école et aussi auteur de plusieurs livres de grammaire pour les écoliers. Décoré dans l’ordre des Palmes académiques jusqu’à en atteindre le grade de commandeur, il fut également un grand connaisseur et un grand animateur du patrimoine, de l’astronomie, du tourisme intelligent, de la nature et de bien d’autres choses encore…Raymond Hoffert fut également et pendant de longues années le commissaire aux comptes de l’AHPSV. Beaucoup se souviennent de la déclamation de ses rapports sur la tenue des comptes de l’association, qui commençaient toujours par un vibrant « Nous, Hoffert Raymond, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés…» et qui se terminaient immanquablement par de chaleureux applaudissements. C’est un homme de savoir, un homme de conviction à l’humour subtil, qui nous a quittés le 17 janvier 2018.
Né à Giromagny en 1922, Jean Demenus était un personnage connu et reconnu dans la cité sous-vosgienne. Après des études d’histoire à la faculté de Strasbourg, titulaire d’une licence d’histoire-géo, il enseigna un temps à Mulhouse avant d’intégrer le lycée Follereau à Belfort. Pas facile d’enseigner l’histoire à des jeunes gens plus enclins au maniement de la lime, du fer à souder ou du tire-ligne. Pourtant, Jean Demenus, en passionné, racontait tellement bien l’histoire qu’il savait captiver les élèves, même les plus indifférents. Et c’est avec la même sensibilité et la même passion qu’il devint la mémoire de Giromagny, lui, le fils du boulanger qui n’avait pour ainsi dire jamais quitté son village. Très croyant, Jean était aussi engagé dans la paroisse comme chantre, comme catéchiste, comme collecteur du denier du culte et même comme balayeur de l’église…Jean Demenus fut très longtemps un membre éminent de l’AHPSV : un des premiers administrateurs, l’auteur de nombreux articles dans La Vôge et aussi une précieuse référence de connaissances pour les curieux de l’histoire sous-vosgienne.Jean Demenus nous a quittés le 12 mars 2018.
Né en 1930, Marcel Wuyam fut ordonné prêtre en décembre 1957. Vicaire épiscopal et aumônier de lycée à Gray dans un premier temps, Marcel est arrivé à Belfort en 1966. Chancelier puis économe diocésain, il devint curé de Giromagny en 2000 et intervint aussi dans les paroisses de Lepuix et de Rougegoutte. Adhérent de longue date à l’AHPSV, le Père Wuyam fut aussi un des auteurs de La Vôge.Il nous a quittés le 21 mars 2018.
« Le malheur de les avoir perdus, ne doit pas nous faire oublier le bonheur de les avoir connus. »
La vie de l’association par Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ
État des lieux photographique
Évoqué en partie Magazine des n°41 et 43 de La Vôge, l’état des lieux photographique réalisé par Roland Guillaume est terminé depuis 2015. Il restait encore une étape importante : le dépôt des 57 858 photos aux Archives départementales qui assureront leur conservation.M. Joseph Schmauch, directeur des Archives départementales, a bien voulu accepter la prise en charge des clichés déposés sous forme numérique. Ils seront conservés et consultables par les futures générations désireuses de découvrir le Pays sous-vosgien de 2013.
Trente années après…
En 1987, François Liebelin déposait en préfecture du Territoire de Belfort les statuts de la toute jeune Association pour l’Histoire et le Patrimoine Sous Vosgiens. Quelques mois plus tard, paraissait une nouvelle revue d’Histoire locale baptisée : La Vôge. Trente années après, l’AHPSV est toujours active. Une poignée de passionnés poursuivent l’œuvre de feu le président fondateur.
Le nouveau conseil d’administration : lors de l’assemblée générale du 3 mars 2018, un nouvel administrateur a été élu et a rejoint le conseil d’administration. Il s’agit de Marthe Peltier de Riervescemont. Les postes de messieurs Jacques Colin, Philippe Dattler, Maurice Helle, Guy Miclo étaient à pourvoir. Seuls Jacques Colin et Guy Miclo ont souhaité se représenter. Ils ont été élus à l’unanimité.Le Conseil d’administration de l’A.H.P.S.V. se compose ainsi : Marie-Louise Cheviron, Jacques Colin, Martine Demouge, Roland Guillaume, Marie-Noëlle Marline,Guy Miclo, Claude Parietti, Marthe Peltier, Bernard Perrez, François Sellier. François Sellier de Rougemont le-Château, conserve la fonction de vice-président, Bernard Perrez, de Rougegoutte, reste à la trésorerie et Roland Guillaume de Bourg-sous-Châtelet au poste de secrétaire. Pour ma part, je conserve la fonction de présidente.
Les nouvelles tables de La Vôge
Les premières tables de La Vôge, ont été éditées en 2007. Elles ont permis la recherche d’un article par thème, par lieu ou par auteur. Mais dix années se sont écoulées et la collection de La Vôge s’est enrichie de dix numéros ! Les premières tables étaient donc devenues obsolètes. Grâce au travail de Claude Parietti, les dix dernières années ont été répertoriées et ajoutées. Ainsi, de nouvelles tables des matières indexant la collection de 1987 à 2017 ont-elles pu être éditées. Celles-ci viennent marquer le 30è anniversaire de La Vôge. Le fascicule est offert à nos lecteurs.
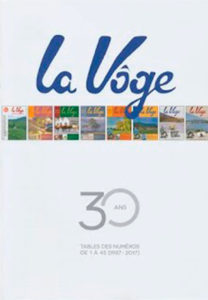
Fête du timbre 10 et 11 mars 2018
Plus d’une centaine de villes de France participaient à la fête du timbre 2018. Giromagny était l’une d’elles. Cette année, le thème retenu au niveau national était L’automobile et le sport avec la mise à l’honneur de l’Alpine A110 et de la R5 Turbo. L’AHPSV a participé à cette grande manifestation organisée par l’Amicale philatélique de l’Est-Belfort (APHIEST) et la ville de Giromagny, en présentant le constructeur automobile Germain Lambert.

Si une rue de la commune porte son nom, il semble que peu de Giromagniens le connaissent. L’AHPSV se devait de présenter cette entreprise en activité dans la cité de 1947 à 1953. L’automobile « La 16 » de Lambert construite à Giromagny et gagnante du Bol d’or 1952 avait quitté, le temps du week-end, la Cité de l’automobile de Mulhouse pour revenir sur sa terre natale. Plusieurs panneaux présentaient les véhicules automobiles Lambert mais aussi les courses de montées du ballon d’Alsace au début du XXe siècle, telles que la Coupe Lederlin.
Riches de nouveaux contacts et motivés par le succès de cette manifestation, les membres de l’AHPSV envisagent l’édition d’un numéro de La Vôge spécial Germain Lambert.
« D’ici et d’ailleurs » le 3 juin 2018
La 1ère édition de la rencontre interculturelle « D’ici et d’ailleurs» permettait aux exposants de Giromagny et d’ailleurs de faire découvrir leurs pays d’origine à travers spécialités culinaires ou objets artisanaux. L’AHPSV présentait une exposition sur le thème de l’immigration à Giromagny, Lepuix et Auxelles au XVIe siècle. Les panneaux successifs expliquaient la découverte et l’exploitation des filons de minerais dans nos montagnes. Une main d’œuvre venue du Tyrol, de la Bavière, de la Saxe, s’installa dans notre pays pour exploiter ces mines. Nous retrouvons, aujourd’hui encore, l’influence de la langue germanique dans les appellations de lieux et dans certains patronymes. L’exposition nous laissait découvrir que 300 ans plus tard, les habitants du Pays sous-vosgien tentaient leur chance en Amérique. Plus de 800 personnes du secteur ont migré à l’ouest, à la recherche d’un monde meilleur. Quelques panneaux présentaient également la langue locale (patois du Rosemont) utilisée par nos aïeux.
Les classes en balade sur le sentier minier
Accompagnés de leur instituteur M. Patrick Colin, les élèves de CM1-CM2 de Lepuix sont partis à la découverte du sentier minier du Phanitor, sandwichs et chips dans le sac à dos. Bien qu’ils vivent tous au pied de la montagne, peu d’enfants avaient déjà parcouru le sentier avec leurs parents. Trois membres de l’AHPSV ont guidé la classe pour la journée. A chaque entrée de galerie l’émerveillement était au rendez-vous. Tous sont allés jusqu’au front de taille de la mine de grès du XVIesiècle, situé à 60 mètres de l’entrée. Lampe de poche en mains, ils ont pu admirer les différentes couleurs de la pierre et percevoir les marques des coups de pointeroles dans le grès.Une semaine plus tard c’est une dizaine d’élève de l’IME de Saint-Nicolas qui découvrait le sentier minier. Quatre membres de l’AHPSV accompagnaient les jeunes et leurs éducateurs.
Les cicatrices du terrain : les limites
De la simple clôture que l’on aligne sur le bord de notre petite propriété jusqu’à la frontière qui sépare notre patrie du pays voisin, la carte du monde est quadrillée de multiples traits qui s’entrecroisent ; un réseau qui change au gré de l’Histoire en laissant des traces plus ou moins durables sur le sol et en laissant souvent perplexe le ramasseur de champignons qui découvre par hasard un groupe de chanterelles au pied d’une pierre dressée.
Les fossés
Une limite peut être marquée sur le terrain de différentes façons : en relief, comme nous le verrons plus loin avec les murets, murs et murailles, ou en creux avec des fossés plus ou moins profonds, comme Romulus qui, d’un sillon creusé à l’aide d’une charrue tirée par deux bœufs, traça la première enceinte de la ville de Rome. Quand on n’a pas de pierre disponible pour construire un muret, on creuse une rigole, un fossé ou une tranchée. Dans nos montagnes on remarque plus souvent des murets que des fossés mais ils ne sont pas si rares car ces derniers sont plus discrets, sans doute à cause de l’érosion qui nivelle tout. On a le droit de se demander pourquoi les propriétaires tiennent autant à matérialiser ainsi les limites de leurs propriétés ; une des raisons est peut être la facilité qu’il y a à déplacer une borne ou à la faire disparaître…Pour marquer la limite de la parcelle 115 sur le territoire de la commune de Rougegoutte dans le vallon du Quet c’est un talus qui a été aménagé (fig. 1).
Les limites des anciens champs (on l’a vu dans La Vôgen°42) nous rappellent, par des longues raies parallèles où s’attarde la neige (fig. 2) qu’autrefois on labourait des surfaces qui nous semblent aujourd’hui incroyablement petites. La raie de charrue qui marque la limite entre deux parcelles était souvent l’objet de sourdes manœuvres de la part de deux paysans voisins.

Les murets
Nous les avions évoqués brièvement l’an dernier dans cette même rubrique. Ces amas de pierres plus ou moins bien construits qui escaladent la montagne droit devant eux ne s’occupent ni de la pente ni des obstacles naturels. Ils ont l’allure de petites murailles de Chine et, la plupart du temps, il faudrait creuser profond dans les archives pour leur trouver une significa…
(La suite dans : Les cicatrices du terrain : les limites, par Roland GUILLAUME, page 119)
Transmission du drapeau des anciens combattants de Giromagny
« Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un exceptionnel réseau d’associations d’anciens combattants s’est mis en place. Plus de 10 000 communes possédaient « leur » association. Toutes possédaient un drapeau. Dans les années 1960 – 1970, un grand nombre de ces associations ont disparu. Dans le meilleur des cas, leurs drapeaux ont été déposés dans les mairies des communes où ils vieillissent souvent en dehors des regards.Le Souvenir françaisa souhaité donner une « seconde vie » à ces drapeaux associatifs en les déposant dans les établissements scolaires des communes concernées. A cette fin, des conventions sont signées entre la municipalité dépositaire du drapeau, l’établissement scolaire qui va recevoir le drapeau et le comité local de l’association Le Souvenir français qui va en coordonner la gestion. Ainsi le drapeau reprend-il vie. Il est porté par une classe à chaque 11 novembre et 8 mai et devient un élément de l’enseignement de la citoyenneté. Ce grand projet a reçu un accueil chaleureux de l’association des Maires de France et de celle des Maires Ruraux de France. »
La création de l’association des Anciens Combattants de la Grande Guerre 1914-1918 de Giromagny
L‘Association fut fondée le 26 août 1927. Lors de l’assemblée constitutive, ce sont environ 150 anciens combattants qui étaient présents à la mairie de Giromagny. M. Émile Lardier, maire de Giromagny, a été le premier président élu par le Comité.
Les statuts sont adoptés
L’article 1er des statuts, stipule :« Il est formé entre les anciens combattants de la Grande Guerre 1914-1918 ayant droit à la carte du combattant […] une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui prend le nom d’Association des Anciens Combattants de la Grande Guerre 1914-1918 de Giromagny. »
Article 2 : l’association a pour but :
- « de créer et de maintenir entre ses membres un lien permanent de relations, d’amicale assistance et d’étroite solidarité, continuant entre eux l’union née dans les tranchées et sur les champs de bataille. »
- « de se consacrer à l’étude de toutes questions d’ordre pratique, de préparer, soutenir et réaliser toutes solutions en vue d’améliorer le sort des anciens combattants éprouvés par les conséquences de la guerre ainsi que leurs veuves orphelins ou ascendants. »
- « de les assister par ses conseils, ses renseignements, ses démarches et d’une façon générale par tous les moyens, spécialement pour faciliter leur placement ainsi que pour la demande et l’obtention de pensions, gratifications ou secours. »
La réunion de l’assemblée constitutive relatée dans le journal L’Alsace
L’édition du 1er septembre 1927, se fait l’écho de cette réunion de constitution de la nouvelle association, voici quelques extraits :« […] nous relevons avec intérêt qu’un article de ce règlement indique d’une façon formelle que si la Société n’exclut pas les réjouissances, fêtes ou banquets, ceux-ci ne pourront causer aucune dépense à la caisse de la Société. M. Ginot, Directeur d’école, expose ensuite les avantages que les membres de la Société pourront espérer de l’État et de l’Association. 1) de l’État : La loi du 19 décembre 1926 qui crée sur le plan de l’Office des Mutilés, l’Office national des combattants affecte à celui-ci une somme de 20 millions pour 1927. L’Office consentira aux Anciens Combattants, à des taux extrêmement réduits, des prêts pour : achats de jardins, achats de terrains à bâtir, construction d’habitations à bon marché. 2) […] le comité se mettra à la disposition de chacun pour l’obtention de la carte du Combattant et pour tous renseignements utiles. L’association que nous vous demandons de constituer en bonne et franche camaraderie, nous ne la voulons pas comme une société de banquets, mais comme une œuvre prudente, ferme de mutualité. La mutualité permet d’entrevoir de superbes avantages avec de l’organisation. Mais il faut des efforts persévérants et prudents et de la patience […] »
L’acquisition du 1er drapeau
Les membres du Comité réunis le 8 février 1931, décident de l’achat d’un drapeau qui portera les inscriptions brodées suivantes : « Association des Anciens Combattants de Giromagny ; au centre : la croix du combattant, les armes de Giromagny. La dimension est de 80×80, le prix de 790 frs. »
Le drapeau sera officiellement remis à l’association le 11 novembre 1931, lors de la cérémonie au monument aux morts. Trois porte-drapeaux sont désignés. A partir de 1935, « il est décidé que le drapeau participera aux obsèques des camarades anciens combattants ». Ainsi, depuis cette date, le porte-drapeau accompagné d’une délégation assistent aux obsèques des anciens combattants.
Modification du nom, modification des statuts
Lors de la création de l’association, les membres présents ne pouvaient imaginer qu’après la Grande Guerre qui devait être la « der des ders » la France aurait à revivre d’autres conflits. Au cours de l’assemblée générale du 11 novembre 1949, il est décidé de modifier le nom de l’association et d’accueillir les combattants d’autres conflits.
L’article 1er des statuts devient :
« Il est formé entre les anciens combattants de la Grande Guerre 1914-1918 et des guerres suivantes ayant droit à la carte du combattant […] une association […] qui prend le nom d’Association des Anciens Combattants de Giromagny. »
La dissolution de l’association
Lors de la constitution en 1927, l’effectif qui était de 75 adhérents n’a fait que croître pour atteindre 267 adhérents en 1934. L’association a milité pour la retraite du combattant et a organisé, entre autres, des tombolas pour récolter des fonds afin d’aider ceux qui étaient dans le besoin. Dans un but de vivre des moments plus festifs, le comité a organisé un banquet annuel. Après 90 années d’activités au service des anciens combattants porteur de la carte, l’association ne comptait plus qu’une vingtaine d’adhérents en 2016 dont…
(La suite dans : Transmission du drapeau des anciens combattants de Giromagny, par Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ, page 121)
Petite leçon de patois sous-vosgien n°2
Pour cette deuxième « leçon » j’ai également choisi un thème simple : les plantes. Les jardins et les forêts étaient au cœur de la vie paysanne d’autrefois, c’est pourquoi ces lieux regorgent de mots patois, certains subsistant jusqu’à aujourd’hui. Gardez cependant en tête qu’il y a des différences de langage entre les villages, ces mots sont donc les plus communément admis. Dans le beu (bois), on peut y trouver différentes essences, comme des tchânes (chênes), des frânes (frênes), des tiyots (tilleuls), des plaines (platanes), des hâtais (hêtres) ou encore des sojes (saules). Il y a aussi des conifères, tels que la sape (sapin) ou la fiotte (pin) dont les ras de sape (branches de sapin) portent des guillottes (pomme de pin). On peut enfin trouver dans la forêt quelques arbres
plus petits : du savu (sureau) ou du satarbin (sorbier). Il suffit de se baisser pour découvrir de nombreux trésors : en été, il y a des brimbelles (myrtilles sauvages) appelées aussi bérues, et en automne il y a des bourlis (champignons). Les znilles (noisettes) et étchôlons (noix) sont également au rendez-vous. Mais attention aux otchues (orties) !
Dans le tiètchiou quètchi (jardin), il y a toujours le potager. On y voit par exemple des tcheus(choux), des rônes (betteraves rouges), des…
La suite dans : Petite leçon de patois sous-vosgien n°2, par Louis MARLINE, page 123)
L’aménagement du Nouveau Saint-Daniel à Lepuix
Dans le Pays sous-vosgien, quand on parle de patrimoine, on pense au Vieux château de Rougemont, au Fort de Giromagny, à toute une foule de petites églises, de jolies maisons, d’espaces naturels protégés, d’anciennes usines qui tombent doucement en ruine… et, si on est lecteur de La Vôge, on pense aux mines polymétalliques du Rosemont. Car quand on lit La Vôge, on connaît (et on possède souvent dans sa petite bibliothèque) l’ouvrage de François Liebelin : Mines et mineurs du Rosemont, la bible de ceux qui s’intéressent à la fois à l’histoire du Pays sous-vosgien et aux mystères de son sous-sol.
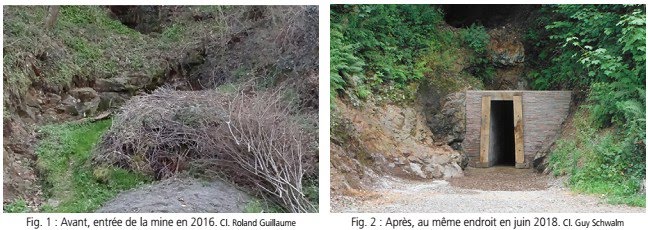
Une mine exceptionnelle
Pour que les mines du Pays sous-vosgien aient fait l’objet d’un pavé de près de 400 pages, il faut qu’elles soient bien exceptionnelles, ces mines, non ? En effet, elles le sont, non seulement sur le plan historique puisqu’elles sont à l’origine de l’esprit d’industrie qui a animé pendant des siècles la haute vallée de la Savoureuse, mais aussi, encore maintenant, par les richesses minéralogiques et archéologiques qu’elles recèlent. Si les exploitations de la vallée de La Madeleine et d’Auxelles ne sont pas négligeables, loin s’en faut, celles du district minier de Giromagny sont quand même les plus importantes de notre région puisqu’elles ont produit au total : « plusieurs dizaines de milliers de tonnes de plomb, quelques milliers de tonnes de cuivre, et près de cent tonnes d’argent…» nous dit Frédéric LATASSE, ce qui en fait le troisième district minier du massif des Vosges après ceux de La Croix-aux-Mines et de Sainte-Marie-aux Mines. Mais il y a plus impressionnant que ces masses énormes de métaux lourds : ce sont les prouesses technologiques des ingénieurs anciens qui ont réussi à descendre à 380 mètres en dessous du niveau de la vallée à Giromagny dans la mine Saint-Pierre(située dans le quartier qui a gardé son nom) et à 390 mètres de profondeur dans la mine qui nous intéresse ici. Celle-ci débouche au pied de la montagne, dans la partie du quartier du Phanitor située sur le territoire de la commune de Lepuix, rue des Mines. Cette mine si intéressante a été nommée Le Nouveau St-Daniel, parce qu’en fait ses galeries rejoignent celles du Vieux St-Daniel en traversant au passage les filons exploités dans quatre autres mines anciennes et en particulier celle très ancienne de Pfennigthurm dont le nom déformé a donné celui de Phanitor qui désigne encore le quartier.
Une mine protégée
Mais le Nouveau St-Daniel n’est pas seulement un endroit où les archéologues peuvent observer les vestiges d’installations industrielles anciennes dont certains sont uniques en France, où les géologues et minéralogistes peuvent examiner minutieusement les entrailles de la montagne, où les historiens ont sous les yeux les lieux décrits dans les archives ; c’est aussi un abri pour une faune qui affectionne les milieux tranquilles, sombres, frais et humides, comme les chauves-souris, par exemple. Des mines, il y en a des dizaines dans les Vosges du Sud mais à part la mine en grès du…
La suite dans : L’aménagement du Nouveau Saint-Daniel à Lepuix, par Roland GUILLAUME, page 125)
Inauguration de la mine Saint-Daniel à Lepuix
Le 9 septembre 2018 était jour de fête pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l’aménagement de l’entrée de la mine Saint-Daniel. Et ce grand jour a été l’occasion pour plus de 80 personnes de visiter avec un bon niveau de confort et un haut niveau de sécurité cette mine ancienne dont ils entendaient parler depuis des années. Ces visiteurs étaient d’abord les élus de la commune et les voisins de la rue des Mines à Lepuix, curieux de voir ce que fabriquaient depuis plus d’un an ces Trolls casqués et boueux qui faisaient parfois tarir les fontaines. Ensuite il y eut les familles des Trollsqui voulaient voir de plus près ce qui occupait tant leurs maris, pères ou grands-pères. Et bien sûr il y eut les membres de l’A.H.P.S.V., à qui avait été présenté en assemblée générale cet important projet.
Fort heureusement, tous les invités n’ont pas pu effectuer le déplacement, car le nombre de visiteurs par groupe et le nombre de groupes par jour sont très limités et il aurait fallu refuser du monde. Il est très difficile en effet à deux groupes de se croiser dans les galeries et l’effectif d’un groupe ne peut guère dépasser dix personnes, guide compris. Et, bien que le parcours sous terre ne fasse que quelques centaines de mètres, il faut compter une bonne heure pour le boucler.

Ce grand jour était aussi le jour des bilans. Bilan moral d’abord, présenté par Marie-Noëlle Marline, présidente de l’A.H.P.S.V., et par Bernard Bohly, président de l’équipe des Trolls, qui ont rappelé les enjeux de l’opération lors d’une petite cérémonie amicale qui s’est déroulée par un très beau temps devant l’entrée de la mine. Bilan financier ensuite qui se monte à 3 132 € de dépenses pour l’AHPSV (dont 1 000 € de subvention à recevoir de la Communauté de communes), sans compter le coût des services rendus par la commune de Lepuix. Le montant des dépenses, supérieur à celui qui avait été budgété, s’explique par l’utilisation de techniques et de matériaux différents de ce qui avait été prévu et ce, pour diverses raisons (dalle sur hourdis, pierres de parement, canalisations de drainage, béton en sacs…).
Autre dépassement par rapport aux prévisions : le nombre de journées de travail qui dépasse très largement les cinquante journées. Les Trolls, qui ne sont pas simplement des terrassiers et des maçons, sont très concernés par l’histoire, les technologies minières, l’archéologie industrielle… pour lesquelles ils ont des compétences reconnues. Bien sûr, il ne s’agissait pas d’un chantier de fouilles et aucun vestige de nature archéologique n’a été mis au jour mais le déblaiement, qui aurait pu être fait sans précaution par une quelconque entreprise de BTP, a été effectué avec minutie sous l’œil soupçonneux de Bernard Bohly, prêt à tout stopper si le moindre objet découvert n’avait pas été un déchet moderne (car l’entrée de la mine avait une allure de décharge sauvage sous certains aspects).
Cette journée historique a marqué l’aboutissement (mais sans doute pas la fin) d’une belle collaboration qui a commencé en 2014 avec le projet de nouvelle édition de l’ouvrage de l’ancien président de l’A.H.P.S.V., François Liebelin, « Mines et Mineurs du Rosemont ». Le guitariste virtuose Jan Vanek, passionné également par l’univers des mines, était là et a animé la matinée. Le verre de l’amitié qui a suivi les discours officiels a été, comme on s’y attendait, un grand moment de discussions et de retrouvailles.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de patauger dans le ruisselet qui court dans les galeries et de cogner leur casque au plafond de celles-ci, il y aura d’autres visites (trois par an, en dehors de la
mauvaise période). Aucune date n’est fixée pour l’instant.
Journées européennes du Patrimoine
Au fort Dorsner de Giromany
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, l’A.H.P.S.V. participait aux Journées du patrimoine aux côtés de l’Association du fort Dorsner à Giromagny. Roland Guillaume, notre secrétaire et guide habituel au fort, présentait au public cinq exposés différents (au choix) sur des sujets très particuliers :
- Pourquoi un fort à Giromagny ?
- Le télégraphe optique.
- La tourelle Mougin.
- Album des photos anciennes du fort.
- Le transport et le montage des tourelles.
Ce dernier sujet était celui d’un article de La Vôge n°45 de 2017. Malgré le caractère plutôt pointu de ces exposés, le public était vivement intéressé et ce sont plus de cent personnes qui les ont suivis, prouvant – s’il en était besoin – que nos contemporains se sentent très concernés par leur histoire et leur patrimoine.Sur les deux jours, les très méritants bénévoles du fort ont enregistré 745 visites (un record !) dont 134 enfants. Ils ont noté qu’une proportion assez importante de gens venait d’autres départements et avaient fait spécialement le déplacement. Nous avons profité de l’occasion pour faire connaître notre action et notre revue La Vôge (un visiteur est même reparti avec le dernier numéro sous le bras !) et pour nouer des contacts.
Au Vieux-château de Rougemont
La municipalité de Rougemontle-Château et le Foyer rural avaient choisi le 16 septembre, Journée européenne du patrimoine, pour procéder à l’inauguration de la nouvelle signalétique installée sur le site du Vieux-château. Trois panneaux explicatifs rédigés en français, anglais et allemand sont venus remplacer les précédents devenus illisibles sous les effets conjugués du soleil, du gel et…de certaines mains malfaisantes.
D’un coût élevé, cette nouvelle signalétique a été financée par la région Bourgogne-Franche Comté (80%) et la commune (20%) ; elle doit permettre aux très nombreux promeneurs de trouver réponse aux questions qu’ils peuvent se poser en découvrant ou redécouvrant ce site médiéval fouillé de manière exhaustive de 1977 à 1990. Une bonne soixantaine de personnes est venue assister à cette inauguration suivie d’une visite commentée du site et… du traditionnel vin d’honneur qui accompagne les inaugurations !
Ce numéro de La Vôge vous intéresse et vous souhaitez le lire dans son intégralité ?
