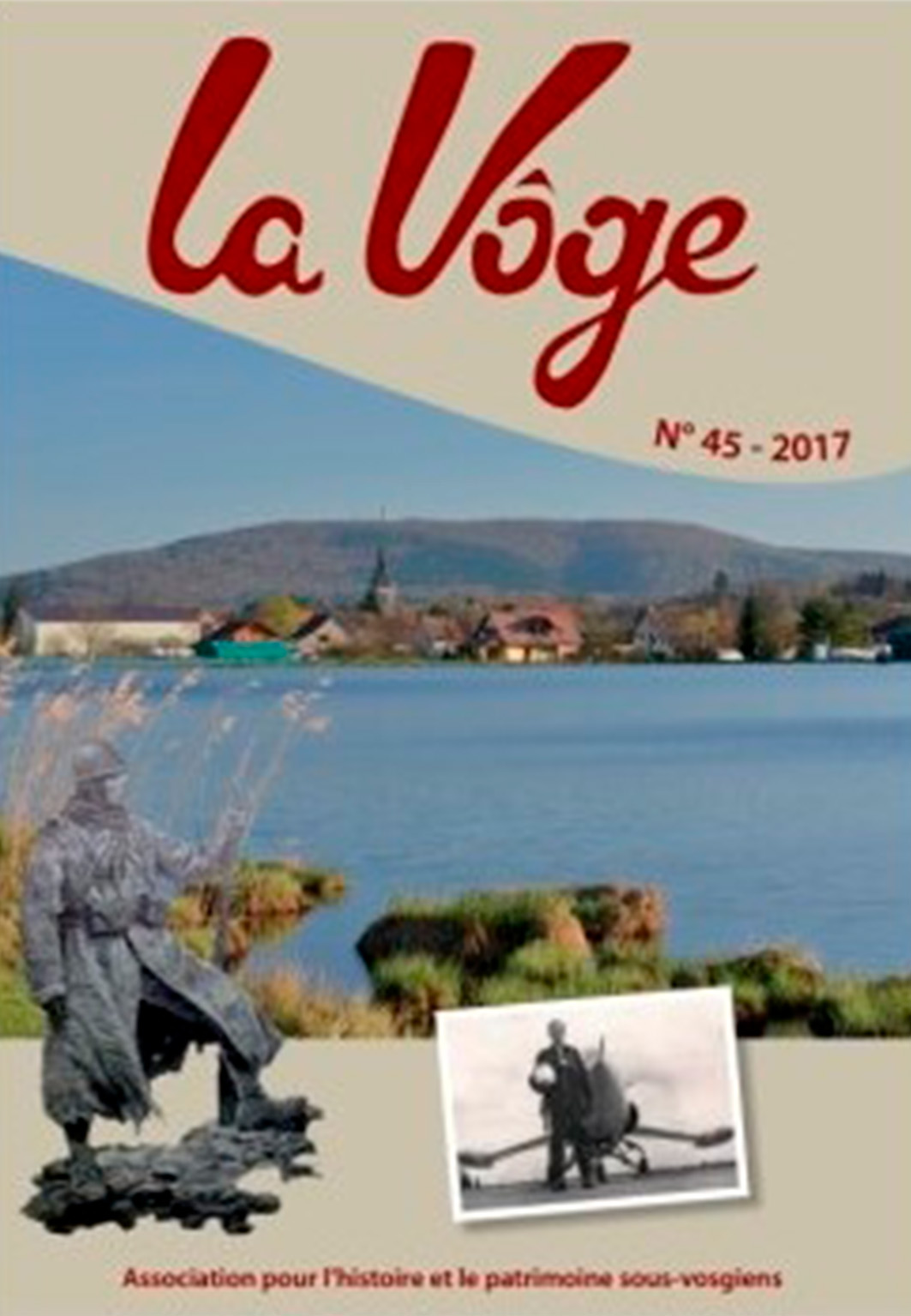
Édito
Pour la quatrième fois de suite, nous réservons une large partie de ce numéro à la Grande Guerre. Le poilu figurant sur la couverture nous rappelle cet engagement que nous avions pris en 2014. Ainsi, poursuivons-nous notre regard sur hier, comme pour aider à rechercher un sens à aujourd’hui. L’actualité confrontée au passé, souvent nous interpelle :
- 1917 : La SACM construit, à Belfort, de très gros canons pour vaincre l’Allemagne et, tout au long de la Grande Guerre, produit cinq millions d’obus dans le même but.
- 2017 : ALSTOM, héritière de la SACM, se lie à l’Allemand Siemens pour constituer LE géant européen de la construction ferroviaire.
Comme quoi l’Histoire ne se répète pas toujours, lorsque l’on consent à en tirer les leçons…
François Sellier.
Table des matières
| Édito | François Sellier | 1 |
| Il y a 100 ans ! Revue de Presse | Maurice Helle | 2 |
| Les traces de la Grande Guerre (2e partie) | Jean-Christian Pereira | 13 |
| Le dessous des cartes | François Sellier | 23 |
| Printemps 1918, le spectre de l’évacuation des civils | Eric Mansuy | 25 |
| Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort- (2e partie) | Roland Guillaume | 35 |
| La maison Mazarin de Giromagny et la famille Lardier : une complicité de deux siècles. | Marie-Noëlle Marline-Grisez | 60 |
| Le pot de terre contre le pot de fer | Martine Demouge et Bernard Perrez | 63 |
| Le carré militaire de Giromagny | Maurice Helle | 70 |
| Médecine à travers les siècles dans nos campagnes | Jacques Marsot | 77 |
| D’un Monseigneur à l’autre…biographie de Mgr Maurice Feltin | Colette Torra-Cuenat | 79 |
| Les traces des charbonniers en montagne (1re partie) | Roland Guillaume | 84 |
| Crash sur la Beucinière…une étoile au tapis | Stéphane Muret | 94 |
| Une tombe, une histoire | Gérard Jacquot | 101 |
| Une autre tombe, une autre histoire | Maurice Helle et Jean-Christian Pereira | 103 |
| Le cadastre napoléonien à Lachapelle-sous-Chaux en 1809 | Claude Parietti | 109 |
| Jules Gasser, illustre enfant de Riervescemont | José Lambert | 115 |
| Les tourelles du fort Dorsner | Jérôme Roffi et Roland Guillaume | 121 |
| L’enseignement primaire à Romagny sous Rougemont | François Sellier | 129 |
| Histoire de machines | Patrick Lacour | 134 |
| La p’tite histoire en patois : Changement au menu | Traduction : José Lambert, Illustrations : François Bernardin |
136 |
| MAGAZINE | ||
| Hommage à Francis Péroz | François Sellier avec l’aide d’Elisabeth Péroz | 138 |
| Vie de l’Association | Marie-Noëlle Marline-Grisez et Roland Guillaume | 139 |
| Les cicatrices du terrain : ruines, murets et amoncellements | Roland Guillaume | 142 |
| La petite leçon de patois sous-vosgien | Louis Marline | 143 |
| Plus Fort que jamais ! | Jérome Roffi | 144 |
| Appel à témoins | Roland Guillaume | 145 |
| La Vôge a lu | François Sellier | 145 |
| Un écrin pour la Vôge | 148 |
Il y a 100 ans ! – Revue de Presse
Que dire de l’année 1917 ?
En peu de mots : les échecs militaires qui se poursuivent et, pour la population, l’aggravation des conditions de vie marquées par le renchérissement, les restrictions, voire la pénurie
des denrées et produits essentiels tels que farine, beurre, fromage, sucre, charbon, essence…Toutes les activités, toute l’économie doivent concourir à l’effort de guerre et permettre aux «usines de guerre» de donner leur rendement maximum. Sur le plan international, les Etats-Unis après l’annonce allemande de généraliser la guerre sous-marine, rompent en février leurs relations diplomatiques avec les empires centraux, et début avril, le président Wilson proclame l’état de guerre entre son pays et l’Allemagne.
Le général Pershing commandant le corps expéditionnaire débarque sur le sol français mijuin à Boulogne-sur-Mer alors que les premiers Sammies arriveront à Saint-Nazaire à la fin du même mois. Si le camp allié peut compter dorénavant un nouveau belligérant à ses côtés, il s’interroge par contre à propos de la situation révolutionnaire en Russie : le tsar Nicolas II doit abdiquer mi-mars laissant le champ libre à des changements politiques radicaux. La Russie à bout de forces sera-t-elle encore en mesure d’honorer ses engagements militaires ?
En France, pour en finir avec la guerre d’usure, le général Nivelle lance une offensive sur « le Chemin des Dames » (un plateau calcaire situé entre la vallée de l’Aisne au sud et la vallée de l’Ailette au nord). Du 16 avril au 24 octobre, cette bataille – même si quelques positions stratégiques sont enlevées et des gains territoriaux enregistrés – s’avère être un échec sanglant… les pertes sont lourdes : par exemple, entre le 16 et le 20 avril les Français déplorent 35 000 tués ou disparus ainsi que près de 95 000 blessés (source : La Marche de
l’Histoire n° 21). Cette hécatombe ouvre une crise morale sans précédent dans l’armée française : de nombreuses mutineries, refus d’obéissance, désertions, montrent à quel point le Poilu français ne supporte plus d’être envoyé « au casse-pipe »… d’autres stratégies plus économes en vies humaines doivent s’imposer !
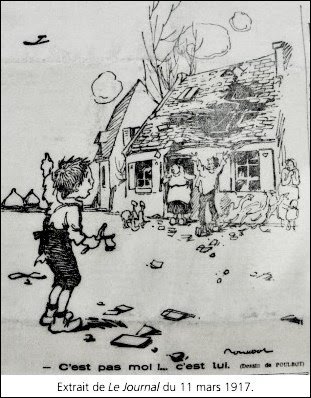
Le remplacement du général Nivelle par Pétain mi-mai, contribue à ramener le calme et la confiance parmi la troupe, au prix cependant de condamnations aux travaux forcés, peines de prison et condamnations à mort. D’une manière générale, la situation des Alliés en cette fin d’année n’engage guère à l’optimisme : fin octobre, l’armée italienne subit face aux troupes austro-allemandes, une défaite humiliante à Caporetto, et en Russie, début novembre (révolution d’octobre) Lénine et Trotsky s’imposent comme les nouveaux maîtres du pays ; l’armistice de Brest-Litovsk signé en décembre, met un terme aux combats sur le front russe. Cette situation militaire n’est pas sans effet sur le contexte politique français : les crises ministérielles se succèdent, démission des cabinets Briand, Ribot, Painlevé… et en novembre, le sénateur G. Clémenceau prend la tête du gouvernement (président du Conseil).
En marge de la guerre au cours de cette année, plusieurs personnalités quittent ce monde : en Allemagne, à l’âge de 79 ans, le comte Zeppelin inventeur des fameux dirigeables auxquels il a donné son nom, en France, à Meudon, Auguste Rodin âgé de 77 ans. Les habitants terrifortains confrontés aux dures réalités de cette économie de guerre de plus en plus contraignante, aux restrictions de tout genre, affectés par les deuils qui touchent la plupart des familles, suivent néanmoins avec autant d’intérêt les exploits des aviateurs dont les actions individuelles, chères au tempérament français, leur assurent une grande popularité. Ainsi, la disparition du capitaine Georges Guynemer le 11 septembre dans le ciel des Flandres et dans des circonstances non encore élucidées, est-elle ressentie comme un drame national. Ce « héros légendaire tombé en plein ciel de gloire » comptait à son actif en juillet 1917, 45 victoires et 21 citations… (source : Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918 – Collection Bouquins). La presse locale s’enflamme également pour les prouesses des « 2 As belfortains » de l’escadrille N81, le sous-lieutenant Marcel Hugues et l’adjudant-pilote André Herbelin.
Toujours au chapitre des aviateurs, un des premiers monuments commémoratifs rassemble lors de son inauguration le dimanche 23 septembre à Petit-Croix, bon nombre de personnalités et de patriotes « en souvenir et à la gloire de Pégoud » (La Vôge n° 43 parue en 2015 évoque cette manifestation).
Encore à propos d’aviation, quel retentissement à Belfort que la chute du premier avion ennemi au pied des arbres de la propriété Schmitt-Stractman (à proximité de la rue du Rhône). De type Rumpler destiné aux bombardements, il a été abattu le jeudi matin 18 octobre par un appareil de l’escadrille N150 de Chaux, piloté par le lieutenant Louis Delrieu. L’épave a été présentée à la population sur la place d’Armes le dimanche suivant…sous bonne garde tant les amateurs de…
(La suite dans : Il y a 100 ans ! Revue de Presse, par Maurice Helle, page 2)
Les traces de la Grande Guerre
2è partie : pendant la Grande Guerre
Les cantonnements
Une note de l’intendance de janvier 1917 sur l’organisation du ravitaillement donne une base de 45 000 hommes sur le front de la trouée de Belfort. Une étude est réalisée pour ravitailler, en cas de besoin, 120 000 hommes depuis Belfort. Cette note est sans doute en lien avec l’arrivée prochaine du 40è corps et de la 73è division d’infanterie. Avec de tels effectifs, les casernes ne suffisent pas, il faut loger les militaires en cantonnements chez l’habitant. Des cantonnements nombreux et variés.
Au début de la guerre, que l’on espère courte, il est fait usage de tentes, en plus du logement chez l’habitant. A la séance de la commission de Défense de 1912, il est prévu lors de la mobilisation, en plus du logement dans les villages de la ligne des forts, de loger la troupe sous 11 000 tentes. Il est même demandé de compléter les stocks de tentes afin de pouvoir abriter 25 000 hommes, en cas de bombardement des villages. Il faut donc imaginer en août 1914, en plus des villages regorgeant de troupes, des prairies constellées de dômes blancs.
Les cantonnements à travers les archives communales
La plupart des archives communales du Territoire de Belfort conservent de nombreux dossiers sur le cantonnement de troupes. Le plus gros du volume des archives représente les états mensuels payés par habitant pour les nuitées. Ils sont dressés sur un état imprimé ou écrits dans un cahier d’écolier. Si souvent il n’est pas possible d’établir le volume exact des troupes logées, les états donnent un nombre global de nuitées par propriétaire et par mois. Il est cependant possible pour une commune d’établir une liste chronologique des troupes en cantonnement. C’est aussi un des seuls moyens de relever le passage d’unités étrangères telles les troupes italiennes, américaines, voire tchécoslovaques.
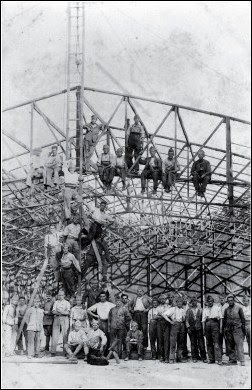
Enfin, ces dossiers permettent d’avoir un regard au quotidien sur l’organisation des cantonnements. Inventaires du matériel, plaintes au maire pour dégâts, sont souvent des pièces qui complètent les états de frais pour nuitées. Il existe aussi des dossiers militaires «oubliés» par les majors de cantonnement. Ces documents comprennent, à partir de 1917, un croquis ou un plan de la commune, un état détaillé des ressources en logements, un renseignement des ressources en eau, les consignes en cas d’incendie, un état des abris en cas de bombardement, les consignes en cas d’alerte pour bombardement. Ils sont souvent établis en langue anglaise, à partir de 1918, pour les troupes américaines.Des exemplaires de ce type sont conservés dans les archives communales de Bourogne, de Dorans, de Reppe et de Delle. Parmi ces dernières, des dossiers de cantonnement concernant le secteur de Beaucourt ont été oubliés par les militaires en 1919.
La réglementation du cantonnement
Le journal La Frontière du 7 novembre 1915 donne la définition du cantonnement.« Etre logé c’est être installé dans des maisons particulières, dans les conditions ordinaires de l’habitation, c’est-à-dire que les hommes puissent coucher dans des lits. Cantonner, c’est utiliser au mieux les logements mis à disposition d’un nombre d’hommes, d’animaux et de matériel trop considérable pour qu’ils puissent être logés. Après le recensement des installations défensives existant à la fin 1914 et des voies de communications mises en place tout au long de la guerre, intéressons-nous aux installations logistiques qui furent créées progressivement pendant le conflit et notamment au cours des années 1917 et 1918. normalement ».
Ce n’est qu’à défaut de place dans les bâtiments appartenant à l’État, au département, aux communes et aux établissements publics que les militaires devront être logés et cantonnés chez l’habitant. Le cantonnement comprend aussi les indemnités pour les chevaux et les mulets qui sont payées avec le fumier des bêtes. Les dégâts commis par les troupes logées ou cantonnées ouvrent droit à des indemnités.Les réquisitions de logement et de cantonnement des troupes sont facilitées par des états dressés dès le temps de paix, tous les trois ans, par les maires. Ces derniers doivent veiller à ce que la charge du logement soit répartie avec équité entre tous les habitants. En toute circonstance, les troupes ont droit chez le logeur au feu et à la chandelle. Le billet de logement constitue une obligation à laquelle nul ne peut se soustraire. On n’est pas obligé de fournir ces prestations à titre gratuit, tout au moins dans une certaine mesure.
Le cantonnement donne lieu à indemnisation (sauf pendant la période de mobilisation) aux termes de l’article 31 du décret du 2 août 1877, dès lors que le nombre de lits ou places occupés au cours d’un même mois excède le triple du nombre des lits ou places portés sur l’état des ressources de la commune. Ce taux d’indemnisation est fixé par lit d’officier ou de soldat et par nuit. Les trois premières nuits sont donc à la charge de la commune. L’armée, elle, rembourse à partir de la quatrième nuit de couchage. Les barèmes sont de deux francs par officier, vingt centimes par sous-officier et cinq centimes par homme de troupe.
Le cantonnement chez l’habitant est majoritaire
Dans la grande majorité des communes, la troupe loge dans les granges et quelquefois dans les greniers aménagés. Une ferme abrite entre 10 et 25 hommes. Les officiers ont droit à des vraies chambres. Les édifices publics tels que les écoles, sont les premiers à être réquisitionnés, souvent pour accueillir infirmerie, centre de commandement, centre téléphonique ou centre administratif.
Les dossiers de cantonnements donnent une idée des capacités : Brebotte qui compte 183 habitants, peut héberger 508 hommes et 376 chevaux ; Bourogne peut recevoir 1 400 hommes de troupe et 600 chevaux ; Courtelevant 800 hommes ; Grandvillars 867 hommes ; Joncherey 490 et Chaux 1 240 hommes (pour 620 habitants) ; le secteur de Reppe accueille 1 700 hommes, 100 chevaux et 24 officiers en 1917. A partir de 1916, les installations se multiplient : baraques-douches, baraques-cuisines, foyers du soldat. Les rues sont entretenues par la troupe. Au foyer de Joncherey, le 15 avril 1918, il est donné une séance de cinéma ; la salle peut contenir 250 hommes (A.D.T.B. 33ed 4 H 53). Des fours à incinérer les ordures sont aussi construits (A.D.T.B. 33ed 4 H 56). Les majors de cantonnement veillent à l’approvisionnement en matériel de couchage (paillasses, sacs de couchage, tables).
Des lieux de cantonnement sont créés à partir des baraques préfabriquées : en 1918 des baraques type Épinal sont dressées à Saint-Germain, d’autres sont installées entre Giromagny et Chaux en 1917. Courtelevant (A.D.T.B. 28ed 4 H 7) compte, en 1918, une baraque type Épinal comme écurie (30 m x 8 m pour 50 chevaux), une écurie type suisse (33 m x 8 m pour 50 chevaux) et des baraques de type Adrian pour une salle de réunion, un dépôt de munitions, un réfectoire. A Reppe en 1918, le village peut abriter 635 hommes, 17 officiers et 324 chevaux. Il existe dans cet état de logement, trois baraques type Épinal de 48 hommes chacune et une petite baraque comme infirmerie.
Un exemple est bien connu, à Rougemont-le-Château, grâce à l’ouvrage de François Sellier, « Un Village à la frontière de La Grande Guerre ». Ce 26 janvier 1915, à Rougemont-le-Château, la cohabitation des troupes et des habitants s’organise. La salle et la cuisine de l’hôtel Bardin sont réquisitionnées par l’état-major. Dans chaque hôtel, des chambres sont réservées aux officiers, d’autres sont logés chez les particuliers. Les hommes sont répartis dans les granges. L’école sert aussi de QG et de central téléphonique. Comme dans les autres communes, si les unités restent un bon moment dans leurs lieux de cantonnement, à partir de la fin 1917, elles se multiplient et demeurent moins longtemps en place.
En 1918, un inventaire indique 14 baraqueslogement au « camp des Italiens » et à « SaintNicolas », deux baraques-écuries et une baraque-foyer du soldat. Dans les consignes du
cantonnement, la troupe balaiera les rues le matin à 8h30 et le soir cette tâche sera à la charge de la population civile (A.D.T.B. 89ed 4 H 5). Boron, est un autre exemple documenté. Lors de ses fréquents voyages dans cette commune, L. Herbelin livre ses impressions sur le village transformé en lieu de cantonnement. « Quatre ou cinq maisons de Boron, non occupées par leurs propriétaires, mais réquisitionnées pour la troupe, ont été littéralement mises au pillage par les soldats. Les portes intérieures, les cloisons en planches, les poutrages, tout y a passé. L’une de ces maisons construite en bois et en torchis ne vaut plus, avec son corps de grangerie, qu’à être…
(La suite dans : Les traces de la Grande Guerre, par Jean-Christian Pereira, page 13)
Le dessous des cartes
Une nouvelle fois, découvrons à travers la photographie, une petite histoire de la Grande Guerre. Nous sommes à Rougemont-le-Château le 23 mai 1915. Dimanche de Pentecôte. Les photos sont de Pierre Jaminet.
Avec la 10e division de cavalerie
À la sortie de la grand-messe, la plus grande partie des Rougemontois et des militaires en cantonnement se rassemblent sur la place du village pour assister (comme souvent) à un concert de musique militaire. Cette fois, il s’agit d’une prestation de trompettes de cavalerie. Toutes les trompettes de tous les régiments composant la 10e division de cavalerie sont présentes.
Cette division est arrivée le 14 décembre 1914 après s’être vaillamment comportée sur la Marne.
Rougemont et les villages avoisinants « regorgent » de troupes. La petite gare du « Tramway » accueille certains jours jusqu’à 20 trains de ravitaillement pour nourrir tous ces hommes…
L’alignement parfait des fanfares, l’éclat des cuivres sous le soleil de mai, le chant du départ superbement « envoyé » par les dragons donnent le frisson et ravivent, si besoin est, le sentiment patriotique !

En costume d’Alsacienne
Un peu plus bas dans la rue, juste devant le petit café du Cheval blanc, le général de Contades-Gizeux, commandant la division, écoute le concert. Une jeune fille en costume d’Alsacienne se présente à lui avec une belle gerbe de fleurs et l’embrasse. Cette jeune fille est Violette Bardin, fille du propriétaire de l’hôtel du « Tonneau d’Or » à Rougemont.
Après cette touchante marque d’attention pour leur général, les fanfares défilent devant les troupes impeccablement alignées, avant de regagner leurs cantonnements respectifs. Ce dimanche de Pentecôte 1915 avait été choisi par le Secours national et le groupe parlementaire des départements envahis, pour être la « Journée française de bienfaisance ». Les fonds collectés étant destinés aux populations d’Alsace et de Lorraine et aux orphelins de guerre. On notera l’affiche apposée sur le petit bâtiment situé à côté du café. A Rougemont, la collecte a rapporté la somme de 826 F qui contribuera à, comme le dit La Frontière « sécher les larmes de ceux qui restent au foyer et tranquilliser aussi l’esprit de ceux qui combattent pour nous».
Pour un instant, le temps d’un concert et d’une accolade, il y eut comme un air de fête qui flotta sur la place de Rougemont-le-Château. Hélas, le soir, le canon se remit à tonner à la
cadence régulière d’un métronome, du côté de l’Alsace…
Sources
- Journaux La Frontière et L’Alsace
- SELLIER, François. Un village à la frontière de la Grande Guerre. Editions France Régions. 1987.
- Photos Jaminet, issues de la collection de Gilbert Dona et de François Sellier.
(Le reste de l’article dans : Le dessous des cartes, par François Sellier, page 13)
Printemps 1918 : le spectre de l’évacuation des civils
Les Allemands vont finir par revenir. Dans les environs de Belfort – entre autres – c’est l’idée récurrente qui semble hanter les états-majors alors que la guerre dure, même si la portion
septentrionale du front du Sundgau connaît de moins en moins de combats depuis l’hiver 1914-1915.
En août 1914, le déclenchement des hostilités a mené au départ, en vertu de la « Note relative à l’évacuation des bouches inutiles de la Place de Belfort » indexée sur le plan de défense de la ville mis à jour le 31 décembre 1912, de 22 000 personnes du camp retranché. En outre, en octobre 1914, les quatre listes établies par la direction de la Sûreté Générale du ministère de l’Intérieur, intitulées « Etat faisant connaître la résidence actuelle des personnes évacuées du département du Haut-Rhin », révélaient également l’évacuation, quoique dans une moindre mesure qu’à Belfort, d’habitants d’une quarantaine de communes essaimées dans l’ensemble du Territoire. Une telle situation, bien que devant rester prévisible, allait-elle devoir se reproduire ?

En décembre 1916, c’est du côté français que deux projets d’offensive sont élaborés, qui concernent l’ensemble de la VIIe armée, et y incluent une zone s’étendant, tout ou partie, de Thann à la frontière suisse. La situation évolue en juin 1917, quand le général de Castelnau signe une « instruction relative à l’exécution des travaux de défense », qui prend clairement en compte des options offensives mais également défensives. Dans les faits, il existe depuis janvier 1917 un « Plan de défense » – auquel se greffe, début 1918, un « Plan de renforcement».
Ce « Plan de défense du front de Haute-Alsace (du Judenhut inclus à la frontière suisse) » présente entre autres « l’ensemble des mesures arrêtées par le général commandant l’armée en vue de parer avec les seules troupes dont il dispose, soit à une attaque inopinée de l’ennemi, soit à une attaque prévue, mais qui, par sa soudaineté et sa violence, n’a pas permis de fournir à temps au commandement local les forces nécessaires à la bataille – autrement dit, de faire jouer le plan de renforcement ». Le contenu de la partie portant sur les « possibilités d’action de l’ennemi » laisse songeur : « Aucune trace de préparation du terrain au voisinage immédiat des premières lignes ne permet de conclure à une attaque imminente ; les opérations récentes viennent de nous prouver d’ailleurs que cette préparation n’est pas indispensable. En résumé, l’équipement du front ennemi, principalement entre Guebwiller et la Suisse, n’est pas d’ordre strictement défensif : tel qu’il est actuellement, il peut se prêter au déclenchement par surprise d’une offensive puissante ». Au final, il semble que le flou le dispute au fantasme : même si rien de tangible ne prouve que les Allemands vont passer à l’attaque, rien ne prouve le contraire…
La crainte de l’invasion, ou le nébuleux fantasme de 1918
En conséquence, mieux vaut prévoir le pire. Il se fait jour, sans surprise, que « dans une offensive allemande se développant des Vosges à la Suisse, la zone centrale, c’est-à-dire la plaine de Haute-Alsace, apparaît nettement comme la région où l’ennemi porterait son effort le plus puissant ». Si cette attaque se produisait, elle serait conjuguée à deux attaques secondaires – l’une dans le secteur Thur-Doller, l’autre dans les environs de Pfetterhouse. Au centre, là où les assaillants porteraient leur effort principal, existent deux trouées, à savoir la trouée de Valdieu et la trouée de Soppe. Dans ce cas de figure, c’est, en profondeur, une très vaste zone qui serait touchée par les combats. Elle engloberait, du nord au sud :
- sur une première ligne de résistance, les bois de Langelittenhaag jusqu’à l’Est de Pfetterhouse ;
- sur une deuxième ligne de résistance, de Guewenheim jusqu’à l’Ouest de Pfetterhouse ;
- sur une troisième ligne de résistance, de Sentheim à Courcelles ;
- sur une quatrième ligne de résistance, du Barrenkopf à Brognard.
Sur le terrain, l’anticipation du surgissement de cet hypothétique Armageddon apparaît dans ce qu’en décrivent ceux qui en subiraient les affres, et en creux se révèlent alors ici les grands absents de ces plans de défense et de renforcement : les civils. A Rougemont-le-Château, Reine Schmitt en fait état dans sa correspondance, le 25 janvier 1918 : « On fait au-dessus de Rougemont beaucoup de travaux de défense. Si seulement les fritz n’attaquaient pas de ce côté-là. Il est vrai qu’ils pourraient se faire soigner, car le terrain s’y prête bien ». La crainte de dévastations à venir paraît être reléguée derrière le mécontentement que les travaux de défense font naître au sein de la population des communes concernées, qui en troublent le travail et la vie quotidienne, et frappent de plein fouet le rendement des exploitations. Et pourtant, face à une guerre dont l’industrialisation a fait émerger, en plus de trois ans et demi, une artillerie à la portée et à la précision de plus en plus mortifères, et l’emploi de gaz de combat, qui frappent sans distinction civils et militaires, la perspective de batailles
livrées dans la très vaste zone délimitée ci-dessus, ne peut que faire frémir. Heureusement, les hécatombes potentiellement engendrées par de telles…
(La suite dans : Printemps 1918 : le spectre de l’évacuation des civils, par Éric Mansuy, page 25)
Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort
2è partie : pendant la Grande Guerre
Le 3 août 1914 arrive au 1er groupe d’aviation de Longvic (Côte d’Or) le soldat Mathey Jacques François Émile, de la classe 1895, domicilié à Valdoie, rue de Turenne. Á 39 ans il est mobilisé dans le cadre de l’armée territoriale et comme il sait lire, écrire et compter, il sera affecté à une tâche plus ou moins administrative donc ne réclamant pas des conditions physiques exceptionnelles. En tant que commerçant dans le civil, on peut imaginer qu’il sera magasinier, comptable ou secrétaire (à moins qu’il ne soit parachuté «cuistot», coiffeur,
infirmier… ?), sa fiche-matricule ne nous donne pas ce genre de détail ; ce qu’elle nous dit, par contre, c’est qu’il aura passé toute la guerre à côté des avions. Et c’est ce qui nous intéresse…
Mais laissons un peu Emile Mathey toucher son paquetage et parfaire son instruction, et prenons un peu de hauteur pour faire le point sur l’aviation militaire au tout début du conflit.
Résumé de la première partie
Pour le civil ordinaire habitant Belfort ou le Pays sous-vosgien, l’aéroplane est apparu dans le ciel en juillet 1909. D’abord comme une attraction foraine sur le terrain de manœuvres militaires du Champ de Mars avec les évolutions du capitaine Ferber, connu également sous le pseudonyme de François de Rue (fig. 1) ; ensuite quand Belfort, en tant que place forte modèle, a eu le privilège d’accueillir non seulement un port d’attache de ballons dirigeables, mais aussi une escadrille de monoplans Blériot, la troisième des escadrilles créées en France. Belfort est non seulement le fer de lance du dispositif de défense que constitue la Ligne Séré de Rivières, mais fait aussi partie de l’avant-garde dans le domaine de la technologie militaire.
Sans être revanchard comme certains extrémistes, le Belfortain aimerait quand même bien voir l’Alsace et la France ne faire qu’une comme avant, il y a une quarantaine d’années. Bien sûr, en juillet 1914 on traverse encore la frontière dans les deux sens sans autres difficultés que les petites brimades des gabelous mais quand même, ces jeunes cousins qui ne parlent pas un mot de français, ce Kaiser arrogant qui lorgne sur nos colonies… on ne peut pas dire que c’est réjouissant ? Et puis, notre belle Armée avec ses irrésistibles canons de 75, ses fantassins pleins d’entrain, ses beaux cavaliers que l’on admire quand ils caracolent crinière au vent, et ses gracieux aéroplanes militaires… on ne serait quand même pas fâchés de les voir se mesurer à l’ennemi héréditaire, non ?
Justement, voilà que le 3 août 1914, les grandes manœuvres et les défilés du 14 juillet laissent la place aux opérations militaires réelles ; les intellectuels de l’État-Major vont enfin pouvoir tester leurs théories et envoyer les fantassins à l’assaut des mitrailleuses ennemies. Comme on le verra plus loin, ces grands stratèges, qui doutent encore de l’intérêt de l’avion, vont souvent contester, du moins au début de la guerre, les informations rapportées par les observateurs volants.
Le développement de l’aviation militaire avant la guerre
Même si le futur maréchal Foch déclare aux grandes manœuvres de Picardie en 1910 : « L’aviation, c’est du sport. Pour l’armée, c’est zéro! », il se trouve de nombreux militaires clairvoyants comme le général Brun et le général Roques pour voir dans l’avion un auxiliaire des armées en campagne. C’est ce dernier, alors Inspecteur permanent de l’Aéronautique, qui fait acheter à titre expérimental les premiers aéroplanes militaires (appelés « avions » en hommage à Clément Ader).
En 1911, le «coup d’Agadir» met en évidence le risque d’un conflit armé entre l’Allemagne et la France, il ne faut donc pas perdre de temps. Les grandes manœuvres ont montré l’utilité de l’avion en tant qu’auxiliaire de la cavalerie (pour les reconnaissances lointaines) et de l’artillerie (pour le réglage des tirs). Le 31 mars 1912 paraît au JO la loi d’organisation de l’aéronautique militaire qui sera complétée par la loi du 9 juillet de la même année ; elle permet d’intégrer dans une structure efficace les avions achetés grâce aux dons de la population. Ainsi, fin 1913 plusieurs centaines d’avions seront disponibles. Mais il ne suffit pas d’avoir des avions, il faut aussi former les pilotes et le personnel, mettre au point les procédures et
le matériel nécessaire, faire travailler ces nouvelles ressources avec les armes traditionnelles que sont l’infanterie, l’artillerie et la cavalerie.
L’aviation française au 3 août 1914
L’avion de 1914 n’est pas armé, il manque encore de fiabilité et reste très vulnérable aux caprices de la météo ; c’est sans doute ce qui laisse sceptiques certains hauts responsables et les fait douter de voir un jour cette fragile machine constituer un des éléments d’une arme nouvelle. Au moment de la mobilisation, la France peut aligner 23 escadrilles de 6 avions, soit 138 appareils. Mais que sont devenus les autres, puisque les souscriptions en avaient financés plus de 200 ? Eh bien ils sont en réserve et vont compléter les rangs éclaircis par les pannes, les accidents et les pertes dus au conflit. Au total, on peut compter 274 avions disponibles, à peu près en état de vol. Les Allemands n’en ont guère plus.
On peut être surpris par le nombre de marques et de types différents représentés par ces avions : Maurice Farman, Henri Farman, Voisin, Blériot, Deperdussin Caudron, REP (Robert
Esnault-Pelterie), Nieuport, Breguet, Dorand, Morane-Saulnier… Sans être spécialiste de la gestion des stocks, on imagine les difficultés d’approvisionnement et de stockage des pièces
détachées ou encore les problèmes de maintenance que pose cette diversité d’appareils. Mais il faut se souvenir que l’aviation est encore un immense chantier d’expérimentation et que, début 1914, l’expérience de la guerre aérienne se limite, pour l’armée française, à quelques opérations au Maroc.
Très vite (dès octobre 1914), le nombre d’escadrilles va être porté à 31 et surtout, après la stabilisation du front, les missions confiées à l’aviation vont changer de nature.
Évolution de l’aviation de 1914 à 1920
Le rôle premier (et unique) attribué à l’aviation avant le conflit est d’aller voir au loin ce qui se passe chez l’ennemi pour renseigner les étatsmajors. Cette fonction est traditionnellement assurée par la cavalerie, mobile et rapide. Sur les gravures, elle est souvent représentée par un officier à cheval, à
moitié dissimulé dans un bosquet planté sur une petite hauteur et observant les mouvements de l’ennemi, jumelles en mains. L’avion, lui, a une mobilité bien plus grande, peut se glisser très au-delà des premières lignes sans trop de risques, observer en prenant de la hauteur et rapporter à toute vitesse ses constatations à celui qui l’a envoyé en mission. De même nature que la reconnaissance aérienne, le réglage des tirs d’artillerie à longue distance est une fonction qui revient naturellement à l’observateur aérien, aérostier ou aviateur. L’observateur est le coéquipier naturel du pilote, et il est la plupart du temps – tout au moins au début – officier d’artillerie, seul juge, semble-t-il, capable de déterminer si un coup est trop court ou trop long. Dans les deux cas, l’avion communique avec le sol en lâchant son message enfermé dans une cartouche freinée par un long ruban coloré et il reçoit les directives en observant les panneaux de signalisation étalés au sol. La TSF ne viendra que plus tard. Très tôt on envisage d’utiliser l’avion pour porter la destruction chez l’ennemi, loin derrière les lignes. Le premier objectif traité par l’aviation française en utilisant les techniques du bombardement est le hangar à zeppelins du terrain allemand de Frescaty près de Metz. La mission a été confiée à deux avions de la 16e escadrille et c’était le 14 août 1914. A cette époque les bombes ne sont que de simples obus jetés par-dessus bord ; ils tombaient là où ils voulaient et décidaient eux-mêmes s’ils allaient éclater ou non. Autre projectile original : la fléchette ou « balle Bon » ; lâchée par centaines sur les troupes au sol, elle a d’abord beaucoup impressionné avant d’être délaissée au profit du mitraillage ; on racontait qu’elle pouvait traverser un cavalier et son cheval (en ressortant par un sabot ? ).
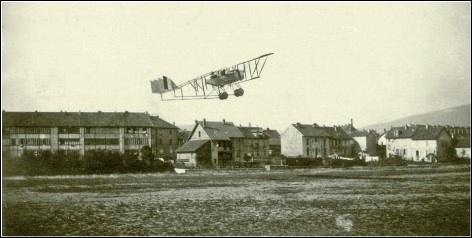
Si les avions rentrent souvent de mission avec les ailes percées comme des écumoires, l’efficacité des mitrailleuses au sol et des canons de défense contre avions (DCA) est quand même relativement limitée ; un point noir qui bouge dans le ciel doit accumuler toutes les guignes du monde pour « encaisser » une balle de fusil dans un organe vital, le pilote, par exemple. Pourtant il faut bien débarrasser le ciel des avions d’observation ennemis et protéger ses propres bombardiers lors des missions lointaines. C’est pour ces raisons que sont créées les escadrilles de chasse formées d’avions rapides et très maniables et bien sûr armés de mitrailleuses (ou de canons ! ). Ils sont pilotés par des hommes au profil particulier qu’on ne peut mieux décrire qu’au travers des citations accompagnant les médailles reçues pour leurs exploits. En voici une décernée à Eugène Gilbert de l’escadrille MS-49 qui séjourne à Chaux de mars 1917 à juillet 1918 :
« Le sergent GILBERT Adrien Eugène, pilote à l’escadrille M.S.49 : d’une audace et d’une habileté au-dessus de tout éloge, a engagé le 17 juin un combat avec un Aviatik puissamment armé et l’a abattu dans nos lignes après une lutte très vive où l’avion français fut criblé de balles ».
Il n’est pas le seul, on pourrait citer Navarre, Guynemer, Gastin, Arnoux, Bouyer, Brétillon, Pégoud… figurant tous dans la liste des «As» pour avoir abattu au moins cinq appareils ennemis et qui ont tous fait un séjour plus ou moins long au pied de nos Vosges avec leurs escadrilles respectives.
(La suite dans : Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort, par Roland Guillaume, page 35)
La maison Mazarin de Giromagny et la famille Lardier : une complicité de deux siècles
La Bergrichterhaus ou Maison de justice des mines
À partir du milieu du XVIè siècle, lors de la période faste de l’exploitation des mines du Rosemont, un afflux de population qualifiée, d’origine germanique, émigre vers Giromagny pour exploiter les filons. Grâce à la découverte de gisements prometteurs de plomb et de cuivre argentifère, cette petite bourgade est en pleine extension. A cette période, la famille des Habsbourg règne sur la Seigneurie du Rosemont. La justice des mines, basée à Masevaux, est transférée à Giromagny ; il devient alors nécessaire d’y construire une maison forte
pour le juge des mines chargé de faire respecter le règlement. L’archiduc d’Autriche Ferdinand II organise le nouveau village en ordonnant, entre autres, la construction d’une halle, de la première église de Giromagny, de fontaines et d’un pont sur la Savoureuse. C’est à cette période également que sortent de terre les premiers hôtels particuliers construits par les riches concessionnaires miniers.
François Liebelin, dans son livret La maison seigneuriale de Giromagny, nous rapporte un extrait d’un document d’époque :
« Cette maison est édifiée rive droite de la Savoureuse. C’est un gros pavillon carré à un étage avec un mur de près de 3 pieds d’épaisseur. L’intérieur est fort simple : un couloir, une grande salle d’audience appelée le « poêle », une cuisine, plusieurs pièces, des cachots, etc…Le logement du Juge Messire Grégoire Heyd est au premier étage, lequel étage est surmonté de plusieurs greniers ».

Construite à partir de 1562, déclarée bien national en 1791, l’ancienne maison de la justice des mines a appartenu au roi de France de 1656 à 1659. C’est à partir de cette date que la demeure prend le nom de maison Seigneuriale ou maison du Roy, et cela jusqu’à la Révolution. Le cardinal Mazarin la reçoit dans la donation faite par Louis XIV en 1659 ( à sa mort, en 1661, sa nièce Hortense Mancini hérite de ses biens.)
Bon nombre d’occupants se sont succédés au fil des années et des événements survenus dans le Pays sous-vosgien, mais la demeure n’a pas toujours été entretenue comme il convenait ni été traitée avec le respect qui lui était dû :
« En 1674, l’Alsace est envahie par les Impériaux (Autrichiens). L’armée française commandée par le Maréchal de Turenne débloque notre région et une partie de sa cavalerie s’arrête à deux reprises à Giromagny pour ferrer les chevaux. La maison seigneuriale, transformée provisoirement en caserne est mise à sac ».
Treize années plus tard, les dégâts n’étaient pas encore réparés. « […]La maison seigneuriale ayant été occupée tant par les commissaires des vivres, que par les charrons de l’armée de feu M. de Turenne, pendant deux campagnes (1674-1675) a été ruinée et particulièrement la chambre où se doit tenir la justice ordinaire des mines et autres assemblées publiques pour les intérêts de Monseigneur le Duc, laquelle chambre sert présentement de grenier à foin pour cause de la ruine qu’en ont fait les charrons de l’armée etc… »
Au début du XVIIIè siècle, la toiture à deux pans passe à quatre pans, l’entrée principale est déplacée sur la façade ouest face à la place actuelle. Le linteau placé au-dessus de la porte qui atteste cette modification indique 1734. Lors de l’acquisition de l’ancienne maison seigneuriale par M. Pierre-Antoine Lardier en 1817, il n’existe plus guère d’éléments du XVIe siècle. A partir de cette date, la maison Mazarin connaît enfin une période de calme. En quelques générations, la famille Lardier saura embellir cette propriété au passé mouvementé.
Des hommes de loi engagés en politique
Après presque trois années de vacance pour l’étude notariale de Giromagny, le 24 janvier 1811, Napoléon, empereur des Français, nomme Pierre Antoine Lardier notaire impérial. Voici ce qui peut être lu sur le document écrit au palais des Tuileries : « Sur le rapport de notre Grand Juge, Ministre de la Justice, nous avons nommé et nommons le S. Pierre Antoine Lardier pour remplir les fonctions de notaire impérial à la résidence de Giromagny, canton de ce nom, arrondissement de Belfort, département du Haut-Rhin avec droit d’exercice dans le ressort de la justice de paix de ce canton. Notre Grand Juge Ministre de la Justice est chargé de l’exécution de notre présent décret ». Les actes enregistrés par l’étude notariale de Pierre-Antoine Lardier le sont dès février 1811 et jusqu’à 1849. Né le 17 octobre 1785 à Châtenois-les-Forges, Pierre-Antoine et son épouse Marie-Thérèse Mange sont parents de sept enfants. Trois seront notaires (l’aîné, Charles Joseph exerce à Belfort, le deuxième, Hippolyte François à Héricourt et le plus jeune des enfants Hyppolite Émile à Giromagny). Pierre-Antoine décède le 22 septembre 1863 à Giromagny. Hyppolite Émile, né le 10 décembre 1819, a déjà pris la succession de l’étude : il a, en effet, été nommé
notaire de Giromagny par arrêté du ministre de la Justice en date du 13 juin 1848, cela jusqu’en 1890. Il épouse Joséphine Grisez, fille de Jean-Baptiste Grisez, brasseur à Lachapelle-sous-Rougemont. Adjoint au maire et conseiller d’arrondissement, il décède le 26 octobre 1901 à Giromagny. Leur fils unique, Émile (1855-1910) devient premier clerc de notaire. Celui-ci épouse Marie-Madeleine Scherb de Turckheim qui décède en 1886 à l’âge de 25 ans. Ils n’ont qu’un fils prénommé comme son papa, Émile, né en 1885. En 1890, après 79 années d’exercice et un nombre considérable d’actes enregistrés, l’étude notariale Lardier s’éteint. La maison Mazarin ne sera plus le témoin de ventes immobilières, contrats de mariage et autres actes officiels signés en ses murs. Le successeur est Georges Léon Saint. Les dernières modifications importantes de la maison datent du début du XXè siècle. Émile Lardier, hérite de la propriété au décès de son père en 1910. Il n’a que 25 ans. Il entreprend de gros travaux. De nouvelles fenêtres sont percées sur la façade sud ainsi que sur la façade ouest. Il apporte plus de confort à l’intérieur de la demeure avec l’installation, notamment, d’une immense salle d’eau. Son aïeul, Hippolyte Émile ayant acheté un terrain adjacent à la propriété, le parc se trouve considérablement agrandi, ce qui ajoute encore plus de splendeur à la propriété. Émile Lardier fait aménager le lieu par un ami architecte au château de Versailles. Un bassin est construit et c’est sans…
(La suite dans : La maison Mazarin de Giromagny…, par Marie-Noëlle Marline-Grisez, page 60)
« Le pot de terre contre le pot de fer »
Le Pays sous-vosgien a constitué le premier pôle industriel de la région de Belfort au XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, grâce à l’exploitation des mines de plomb argentifère du Rosemont. Après un XVIIIe siècle compliqué sur le plan économique, marqué par le déclin des mines et un retour forcé aux activités agricoles, un début d’infrastructure industrielle se met en place au début du XIXe siècle. Sous l’impulsion de quelques manufacturiers dynamiques, filatures et tissages du coton passent progressivement au stade industriel. Ferdinand Boigeol est le personnage emblématique de ce bouleversement dans la Haute-Savoureuse.
Sans doute marqués par la Révolution française de 1789, les socialistes anglais et français du milieu du XIXe siècle parlent volontiers d’une « révolution industrielle » et en répertorient les conséquences sociales. Parler de « révolution » sous-entend des changements brutaux ou, pour le moins, de profondes mutations. Et effectivement le vieux monde rural est désorienté ; le paysan, le fileur, le tisserand, dans les filatures et tissages mécaniques, deviennent « ouvriers de fabrique » ; le travailleur est désormais rivé à sa machine. Ce bouleversement ne se passe pas sans heurts au sein de la fabrique, les ouvriers craignent que les machines ne prennent à court terme leur travail. En 1826, Ferdinand Boigeol « provoque une véritable émeute parmi son personnel, en introduisant les douze premiers métiers à tisser mécaniques achetés en Angleterre » pour sa manufacture de Giromagny. Mais à l’extérieur de la fabrique les problèmes sont parfois importants : son environnement est désormais perturbé, les agriculteurs sont bousculés dans leur quotidien, et nous allons voir au Puix une situation dégénérer.
Marie Marconnot, veuve Petizon : une femme de caractère
Marie Marconnot est née le 6 nivôse an IX (27 décembre 1800) à Lachapelle-sous-Chaux. Le 31 mai 1825, elle épouse Joseph Petizon, tisserand au Puix, dont on peut suivre le début de carrière (1818-1827) dans son « livret d’ouvrier ». Joseph meurt en 1853. De ce mariage sont nés huit enfants ; trois sont encore mineurs au décès de leur père. Au recensement de 1856, toute la famille vit chichement dans une maison située au bas du village, sur la rive droite de la Savoureuse, tout près du « grand pont », face au tissage que Ferdinand Boigeol vient de construire sur la rive gauche de la rivière. Marie, recensée « cultivatrice », est propriétaire, entre autre, d’un pré qui touche au canal usinier, ancien canal dit des mines, propriété du Sieur Boigeol. Ce canal va être à l’origine d’un conflit, à priori banal, mais qui sera exceptionnel par sa durée ; dix années au cours desquelles Marie Marconnot, la veuve Petizon, va défendre « bec et ongles » ses intérêts et ceux de ses enfants face à l’industriel.
Les débuts du conflit
Un jugement du tribunal de paix du canton de Giromagny, rendu le 13 septembre 1856 plante le décor. Marie et ses enfants sont propriétaires d’un pré situé sur la commune du Puix
au lieu-dit « pré du chêne », ce terrain est « […] traversé par un canal de conduite d’eau de la Savoureuse tant pour l’arrosement des propriétés que pour le roulement des moulins Ruez
et Romain ; il est arrivé que le défendeur (Ferdinand Boigeol) a converti le moulin Romain en un établissement industriel et pour se procurer une plus grande quantité d’eau pour le roulement de son établissement, il a fait curer ce fossé, le vingt- trois août dernier et s’est permis par le fait de ses ouvriers de commettre à leur préjudice un fait de nouvel œuvre en curant et rendant plus profond ce canal, en coupant dans leur propriété environ soixante centimètres de largeur sur environ six mètres de longueur pour donner à ce canal plus de largeur qu’il n’avait auparavant ; lesquels faits ils prennent pour trouble à leur possession annale, publique et paisible ». Marie demande au tribunal de condamner le Sieur Boigeol à remettre le terrain en état dans les trois jours et réclame 200 francs de dommages-intérêts.

L’industriel ne l’entend pas de cette oreille et « […] si les demandeurs sont en possession de leur pré, lui défendeur est en possession du canal tel qu’il doit être, telle que sa largeur est déterminée par le passage à travers la route départementale, numéro quatre, tel enfin que le constate l’état des lieux ; attendu que d’un autre côté tout usinier a le droit de curer le canal d’emmener, de prévenir les usurpations des riverains et de le tenir libre de toute entrave, qu’il a le droit de le parcourir le jour et la nuit et de déposer momentanément sur les rives les déblais qui proviennent du curement ».
Ferdinand Boigeol demande donc que Marie Petizon et consorts soient déboutés ; par ailleurs, en raison du « trouble civil » apporté par leur démarche, il réclame mille francs de dommages intérêts « et subsidiairement les condamner en outre en cinquante francs de dommages-intérêts par jour depuis le trente août dernier pour avoir fait arracher les piquets et couper les madriers qui devaient consolider la berge du canal le long de son terrain et avoir empêché les ouvriers de continuer le travail […]».
Mille ans de lutte par-dessus les moulins
On le voit, F. Boigeol frappe fort ; en effet, dans les années 1850, mille francs représentent environ deux années de salaire pour un ouvrier de fabrique. Pourquoi une telle agressivité à propos de la prise d’eau d’un moulin ? Est-ce pour intimider ? On peut répondre par l’affirmative à cette dernière question. Mais il est peut-être utile de faire un petit rappel sur l’importance des moulins. Dès le Xe siècle, la propriété d’un moulin est bien encadrée ; elle comprend les droits sur une partie du cours d’eau en amont et en aval avec l’interdiction
d’y poser une prise d’eau, ou d’y édifier une autre installation qui puisse être préjudiciable à la plus ancienne. Sur le plan technique, le moulin a beaucoup évolué au cours des siècles ; équipée de cames et de bielles, la roue hydraulique se transforme en véritable moteur industriel, le seul en usage jusqu’à l’invention de la machine à vapeur. Avant l’invention de la machine de Watt, l’industrie toute entière est mue par la roue du moulin à eau. Nous en avons un bon exemple en Pays sous-vosgien avec les machines d’exhaure très sophistiquées mises en service dans les mines aux XVIe et XVIIe siècles. Avec le déclin des mines, l’activité des moulins est liée, pour l’essentiel, à l’agriculture : moulins à grain, à huile, pilons pour l’orge, mais aussi moulins à foulons, à tan, ribes à broyer le lin et le chanvre. Au début du XIXe siècle, dans la Haute Savoureuse, le renouveau d’activité industrielle est fondé également sur l’énergie hydraulique, d’anciens moulins sont réaménagés et de nouvelles industries apparaissent : papeterie, filature et tissage mécaniques. Les moulins ont incontestablement servi de points d’ancrage aux nouvelles industries, car posséder le moulin « datant de temps immémorial» revient à posséder le droit d’eau. Ce qui n’a pas suffi à désamorcer les conflits, loin de là, et l’entreprise Boigeol-Japy en a fait l’amère expérience…
(La suite dans : « Le pot de terre contre le pot de fer », par Martine Demouge et Bernard Perrez, page 63)
Le carré militaire de Giromagny
Plus que les années précédentes à Giromagny, les cérémonies du 11 novembre au cimetière communal ont revêtu en 2016 une importance particulière et inaccoutumée, à l’occasion de l’inauguration du carré militaire par le maire Jacques Colin.
Outre les représentants des sociétés, municipalités, associations, écoles primaires, acteurs habituels des cérémonies patriotiques, des figurants français et allemands costumés en tenue militaire d’époque, apportaient côte à côte une note historique chargée de symboles.
Que le message transmis à travers ces scènes de fraternisation effectuées par les groupes 14-18 de l’Association Transhumance et Traditions (A.T.T) et du 109e Badois, soit bien compris par les jeunes générations !
Le carré militaire : 55 tombes et deux monuments
Dans un ordonnancement tout militaire, s’alignent 52 stèles chrétiennes et 3 musulmanes, fraîchement repeintes, aux plaques restaurées et ornées de la cocarde du Souvenir français (53 relatives à la 1re Guerre mondiale, 2 à la 2e). Ces dernières apparaissent en premier plan du carré dans l’alignement de deux monuments rappelant également la guerre 39/45 : une stèle en grès rose ornée d’une croix de Lorraine et une autre de dimensions plus modestes en granit.
La première porte la dédicace suivante :
Aux généreux de la 1re DFL1
Les Français libres du Territoire
La deuxième :
A nos morts 1939-1945
Suit une liste de dix noms, et :
Gymnastes, Souvenez-vous
S’agissant d’évoquer le souvenir de gymnastes, cette stèle érigée à l’origine faubourg de France dans l’enceinte des installations sportives de l’Amicale (société de gymnastique encore active aujourd’hui et jadis également de préparation militaire) a été déplacée en son lieu actuel dans le souci de créer un espace mémoriel commun.

La stèle commémorative des gymnastes
Quelques lignes pour se souvenir de ces dix victimes et de leur destin tragique.
- Reiniche André : né à Giromagny le 17 juillet 1891, il y demeure Petite rue du Tilleul ; résistant, il participe en particulier au sein de son groupe à l’évasion de prisonniers anglais
du camp d’internement situé aux casernes de Giromagny. Arrêté le 18 mars 1944 (vraisemblablement sur dénonciation) par la Gestapo qui trouve à son domicile un important
dépôt d’armes et de munitions, il est condamné à mort le 22 avril 1944 par le tribunal militaire de la Feldkommandantur 560 à Besançon pour détention illégale d’armes ; il est fusillé à la
Citadelle de cette ville le 3 mai 1944. Père de trois enfants, gazier selon son acte de décès, il était titulaire de la médaille militaire et bien intégré à la vie locale comme en témoigne
son élection au conseil municipal lors des élections complémentaires de 1933.
Les trois personnes suivantes de la liste sont unies quasiment par le même sort :
- Pichenot Lucien : (ou Lulu-Alex) né à Giromagny le 3 mai 1920, célibataire et chef cantonnier aux Ponts et Chaussées, il est domicilié à Delle. Il noue de solides attaches à Giromagny où ses parents demeurent.
- Peroz Maurice : né à Giromagny le 3 juin 1920, célibataire, il exerce la profession de mécanicien carrossier.
- Dalcegio (ou Dalceggio) Atilio : né en Italie le 10 janvier 1921, tourneur, célibataire domicilié à Giromagny, engagé volontaire au printemps 1942, il est libéré en novembre de la même année.
Pour échapper aux réquisitions forcées du STO, ils entrent tous trois dans la clandestinité et sont faits prisonniers, « les armes à la main » par les Allemands le 16 avril 1943, au refuge de la Haute-Planche (Planche des belles filles sur le ban communal de Plancher-les-Mines). Sur le motif « réfractaire à la loi sur service obligatoire du travail et détention d’armes », Peroz et Dalcegio tombent sous les balles d’un peloton d’exécution allemand à la Citadelle de Besançon le 29 juin 1943, et Pichenot quelques mois plus tard, le 23 octobre 1943.
- Bredmestre Prosper et Bredmestre Jean (Baptiste) : deux frères nés à Giromagny, respectivement le 24 août 1911 et le 26 septembre 1921, domiciliés à Champagney (Haute-Saône) qui sont condamnés à mort par le tribunal militaire de la Feldkommandantur 661 à Vesoul. Pour quelles raisons ? Nous l’ignorons à ce jour. La sentence exécutée le 29 avril 1944 dans cette même ville, plonge leur mère veuve Eugénie Bredmestre demeurant à Auxelles-Bas, laissée longtemps dans l’ignorance des exécutions, dans le désespoir.
- Thevenot André (Armand) : né à Giromagny le 31 décembre 1915, époux de Jeanne Toupence, il est sous-officier (maréchal des logis), et fait partie des victimes du drame de Banvillars, où dans cette paisible localité, les Allemands assassinent dans la matinée du 10 octobre 1944, 27 personnes dont les corps ne seront découverts qu’au début du mois de décembre suivant (24 cadavres seulement seront identifiés). A cet acte barbare, échappe le curé doyen de Giromagny, seul rescapé, le chanoine Pierre, qui arrêté par la Gestapo de Belfort le 7 octobre 1944 à l’âge de 63 ans, apporte son témoignage dans un journal de guerre à son retour de Dachau en mai 1945. Dans celui-ci, le chanoine déclare qu’il a reconnu le sous-officier Thevenot de Giromagny qu’il avait marié quelques années auparavant et qui lui confie un message oral à destination de son épouse.
- Marion Henri : originaire de Seppois-le-Bas (Haut-Rhin) où il est né le 20 mars 1914, célibataire, domicilié en dernier lieu 32 rue Thiers à Giromagny, il est soldat affecté au 371e RI ; il décède en captivité le 2 juin 1942 à Mulheim an der Ruhr (ou Muelheim, ville allemande du bassin de la Ruhr du Land Rhénanie du NordWestphalie).
- Prevot Marcel : né à Lepuix-Gy le 4 décembre 1924, il rejoint les rangs de la Résistance en juillet 1943 « Aux corps francs d’action immédiate » puis contracte en janvier 1944 un engagement au service de la France combattante. Dirigé dans le département de Corrèze, il y trouve la mort au combat le 17 avril 1944 à Neuvic d’Ussel.
- Benoît (Gaston) Joseph : naît à Giromagny le 8 mai 1920 où il y est domicilié 4 Grande-rue. Célibataire, son décès le 4 décembre 1944 à Karlsruhe en Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg) est porté à la connaissance de la mairie de Giromagny par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre confirmant ainsi son statut de déporté.
Deux sépultures concernent la guerre 1939-1945
À côté du monument commémoratif des gymnastes, deux stèles rappellent le souvenir de deux autres victimes de la 2e guerre : Weiss Auguste et Grand Georges. La croix de ce dernier porte la mention Sergent Bataillon de choc MPF en 1944. Si le sergent appartenait à une unité militaire régulière, il en était tout autre pour Auguste Weiss, un ouvrier agricole alsacien, né à Soppe-le-Haut (Haut-Rhin) le 1 décembre 1921, abattu par des…
(La suite dans : « Le carré militaire de Giromagny », par Maurice Helle, page 70)
Médecine à travers les siècles dans nos campagnes
Pour le bon peuple, les soins médicaux ne se limitaient guère qu’à des saignées et des tisanes…
Au Moyen Âge, la médecine reposait essentiellement sur les connaissances transmises par la civilisation gréco-romaine. L’énorme influence de l’Église, tant temporelle que spirituelle, lui apporta toute sa contribution : les médecins étaient pour la plupart des clercs. Tout praticien de la profession était indifféremment appelé : mire, physicien, apothicaire ou chirurgien, ce dernier terme étant utilisé jusqu’au début du XVIIIe siècle. À la fin du XVIe siècle, le monde médical devint plus individualisé et mieux structuré. Bien que regroupés en corporation et en dépit de quelques progrès, nos médecins subirent les affres du XVIIe siècle ; partout on brûlait sorciers et sorcières, et parmi eux certains « guérisseurs » assimilés à
des agents du diable. Pour le bon peuple, les soins médicaux ne se limitaient guère qu’à des saignées et des tisanes ; de plus, la seule vue de la panoplie chirurgicale (scies, tenailles, bistouris, seringues…) rappelait à chacun des instruments de torture. Les soins dentaires, avec leurs instruments au manche d’ivoire soigneusement rangés dans des mallettes métalliques, bénéficiaient d’une meilleure notoriété ; pourtant de nombreux barbiers s’improvisaient dentistes, ajoutaient même aux prestations les soins de bouche.
1693 : Condamnation des médecins de Giromagny
« La communauté de messieurs les chirurgiens établie par le roi dans la ville et dépendance de Belfort » traduisit en justice les sieurs Faidy, Mandelier et Poirot, tous « chirurgiens » à Giromagny. Il leur était vivement reproché d’exercer « sans avoir fait valoir leur capacité et sans avoir subi l’examen », toutes choses requises par les édits royaux. Les accusés
demandèrent « que leur soit faite lecture des édits royaux en question » ; ils ne voyaient cependant aucune utilité à passer un examen de capacité : « Nous sommes chirurgiens
après avoir fait apprentissage ; l’examen est réservé à ceux aspirant à la dite profession ! » Les juges cependant demeurèrent inflexibles dans leur verdict : « les accusés sont condamnés à se conformer à l’ordonnance du roi de février 1692 relative à l’exercice de l’art de la chirurgie stipulant examen par les dits chirurgiens jurés du dit Belfort ; ils sont de plus condamnés aux dépens».

1703 : Maçon chiropracteur poursuivi à Grandvillars
Face aux juges, Joseph Thomas, chirurgien bourgeois, vitupérait avec force : « De quel droit le dénommé Jean Pietremotel maçon a-t-il enlevé l’appareil à Jean-Georges Dahy ? Ce maçon n’a aucune connaissance en chirurgie, ne peut produire aucune lettre d’apprentissage ; il doit être sanctionné ; les gens ne doivent s’adresser qu’à des experts en la profession» – « C’est à la demande expresse du père de l’enfant Dahy que je suis intervenu ! » répliqua le maçon « rebouteux » et d’expliquer : « Depuis la pose de l’appareil l’enfant criait jour et nuit, n’avait aucun repos, avait de grosses inflammations ; je me suis aperçu que l’os de l’épaule démise n’avait pas été bien remonté ; j’ai remis l’os que j’ai fait rejoindre ; après l’enfant
s’est senti soulagé et ses douleurs s’apaisèrent ; il va de mieux en mieux ».Tout en affirmant « être tout à fait capable dans ce type d’intervention », le maçon chiropracteur étala « Nombre de lettres » en témoignage. Face au chirurgien bourgeois Joseph Thomas, la balance de la justice pencha en direction du maçon rebouteux, lequel fut déclaré acquitté.
François Roy (1885-1903) médecin-vétérinaire En ces dernières décennies du XIXe siècle, lorsqu’on se rendait à la ferme de François Roy à Urcerey, on allait certes s’entretenir avec le maire, mais c’était aussi «Tchi l’médissin» (chez le médecin) que la porte vous était ouverte ; tout comme, quelques maisons plus bas, on vous accueillait «tchi l’mairtchâ» (chez le maréchal-ferrant). Comment François soulageait-il ses concitoyens et leurs bêtes ? Jusqu’au milieu du siècle dernier dans sa demeure a existé une armoire ancienne avec un rayon de livres peu avenants au premier coup d’œil ; dans ces ouvrages aux pages épaisses et jaunies, de nombreuses planches attiraient l’attention : il s’agissait de dessins de notre environnement végétal, celui de nos vergers, nos prés, nos forêts. Depuis la nuit des temps, la nature a toujours soigné l’homme. François soignait principalement par les plantes ; mais d’où venait cette vocation médicale chez ce fermier ? La réponse est dans les archives familiales ; un grand-oncle de François, né en 1760, apparaît dans plusieurs actes notariés où, avec son patronyme, suivent les mentions « dit le médissin » et « médecin-vétérinaire ». A la fin de sa vie, n’ayant aucune descendance, le grand-oncle légua par testament sa ferme à Joseph, son neveu le plus proche ; ce dernier transmit assez rapidement le bien à son fils François. Celui-ci distribua tisanes et soins jusqu’à sa mort. Aujourd’hui seule subsiste la ferme des « médissins » ; celle-ci, la plus ancienne du village, a été rénovée. Ses murs très épais abritent un intérieur sobre, parfois insolite, un peu à l’image de ce que fut la médecine dans nos villages.
(La suite dans : « Médecine à travers les siècles dans nos campagnes » , par Jacques Marsot, page 77)
D’un monseigneur à l’autre…
Un cardinal à Giromagny : biographie de Maurice Feltin
Si Maurice Feltin fut le cousin (issu de germains) de notre grand-mère paternelle, Athalie Cuenat (née Hartemann), il ne s’agit nullement de dresser le portrait «apologétique» de ce haut dignitaire de l’Église, ni de porter un jugement de valeur sur sa vie privée et publique, mais de faire découvrir aux lecteurs, cet ecclésiastique de haut rang qui fut aussi curé de Giromagny !
En feuilletant les dernières pages du numéro 44 de La Vôge, mon regard a été attiré par un petit article classé dans la rubrique « Magazine » relatant la venue, début juin 2016, du Prince Albert II de Monaco à Giromagny qui « pour la première fois recevait un chef d’Etat ». Mémoire du passé, images du présent. En découvrant certaines photos illustrant les reportages de la visite princière, le 6 juin 2016, je fus quelque peu frappée par leur similitude avec ces documents familiaux concernant Maurice Feltin et qui, durant de longues années, ont « dormi » dans la maison du faubourg de France, à Giromagny, où notre aïeule s’était retirée après sa retraite en 1938. Et c’est simultanément qu’a surgi une impression de « flashback » ou de « déjà-vu », un sentiment fugitif laissant une sorte de sensation troublante et faisant remonter des souvenirs enfouis dans ma mémoire. En vérité, les photos du cardinal ont été longtemps reléguées au fond d’un vieux meuble de notre maison familiale. Un secrétaire quelque peu atypique (au-delà de son utilisation, il servait davantage à entasser des objets hétéroclites) composé d’une partie cylindrique sur le dessus, de multiples tiroirs et d’un plateau que l’on pouvait tirer pour dégager un plus grand plan de travail. C’est là que notre grand-mère a conservé durant des années et jusqu’à sa mort, quelques « pieuses reliques » auxquelles elle portait, probablement, un grand respect et une admiration mêlée d’une certaine affection.

Je me souviens notamment de deux photos en noir et blanc, au verso desquelles on peut encore lire la mention « Le cardinal Feltin à Giromagny », d’une carte de visite au graphisme raffiné portant son adresse parisienne, ainsi qu’une revue Paris Match (janvier 1953) dont la couverture représente un portrait en pied du cardinal photographié à Rome, pour la première fois revêtu de « la pourpre », huit pages de cette revue constituant un reportage sur la cérémonie de consécration, par le pape Pie XII, de 24 nouveaux cardinaux (dont l’archevêque de Paris, Maurice Feltin) le 12 janvier 1953. Indéniables similitudes. Par le fait du hasard, ces deux photos sont désormais en ma possession, et ce sont elles qui sont à l’origine du présent article, faisant ressurgir des armoires et tiroirs les témoignages d’un temps passé, le vécu d’un lointain ancêtre que, personnellement, je n’ai pas connu. Deux photographies du passé, en noir et blanc, qui pourraient presque se superposer ou se fondre avec les images en couleur, plus nombreuses, et évoquant une actualité plus récente. Des souvenirs immortalisant, dans un même environnement, mais à une soixantaine d’années d’intervalle, deux éminences accueillies par les édiles et la population de Giromagny, sur les parvis de l’hôtel de Ville et de l’église St-Jean-Baptiste de cette commune. Des images révélant aussi un même accueil chaleureux de la population, toutes générations confondues, une foule de curieux venue acclamer ses hôtes illustres, deux « Monseigneur » dont l’un est alors âgé d’environ 70 ans au moment de sa venue à Giromagny (en 1953) alors que l’autre, né en 1958, n’avait pas encore vu le jour à cette date. Deux personnages, possédant des attaches géographiques communes, l’un par sa naissance (la commune de Delle où est né le cardinal) et l’autre par héritage de l’un de ses nombreux titres, seigneur de Delle, reçu par la maison de Monaco.
Enfin, un dernier point, mais pas le moindre, celui de leur physique, presque semblable, une corpulence toute en «rondeur» dégageant une sympathie naturelle, une même bonhomie et affabilité bienveillante.
Maurice Feltin (1883-1975)
Maurice Feltin est né à Delle le 15 mai 1883. Il est décédé le 27 septembre 1975, à l’âge de 92 ans, des suites d’un œdème pulmonaire à Thiais (Val de Marne), au monastère des Annonciades, où il s’était retiré depuis 1966. La messe des funérailles a été célébrée le 2 octobre 1975 à Notre-Dame de Paris, et, comme ses prédécesseurs, il a été inhumé dans le caveau des archevêques de cette cathédrale. Maurice Feltin est un descendant de Pierre Feltin, forgeron né en Lorraine et venu s’installer à Foussemagne où il a eu douze enfants nés entre 1695 et 1715, de deux épouses différentes. Son dernier fils, Jean-Claude, médecin, a eu huit enfants dont le dernier Pierre-François Feltin (1757-1832), médecin, a épousé en 1780 à Fontaine, Anne-Marie Hartemann (1758-1839) arrière-petite-fille de Joseph Hartemann né vers 1633, meunier d’abord à Lachapelle-sous-Rougemont puis à Fontaine, décédé en 1698.
Le moulin restera dans la famille jusqu’en 1885. Ils ont eu neuf enfants dont le benjamin (notaire à Delle, tout comme son fils et son petit-fils) était l’arrière-grand-père de Maurice Feltin et l’ainé, l’arrière-grand-père de notre grand-mère Athalie Hartemann (1882-1969) qui a épousé, en 1904, Emile Cuenat, instituteur. Un article a été consacré à ce dernier dans le numéro 43 de La Vôge. Maurice Feltin était donc le cousin (issu de germains) de notre grand-mère paternelle.
Études et vocation religieuse
Après des études chez les bénédictins de Delle-Mariastein, puis chez les jésuites de Lyon, il reçoit sa formation philosophique au séminaire de Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux près de Paris.Ordonné prêtre en juillet 1909, il est vicaire de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Besançon jusqu’à la première guerre mondiale, pendant laquelle il sert comme sergent brancardier. Officier dans l’armée, il reçoit de nombreuses médailles (il est, notamment, décoré de la médaille militaire). Dans la publication Delle-Info n°93 de septembre 2014, le cardinal Feltin figure parmi une liste de onze Dellois mis à l’honneur durant la guerre (citation à l’ordre de l’armée, et remise de la croix de guerre avec étoile) : « […] sergent, bien qu’il refusa les galons, pendant les combats du 25 au 30 septembre 1915, est allé, malgré les violents bombardements de l’artillerie allemande, effectuer des pansements et livrer des médicaments aux formations engagées, assure depuis plusieurs mois, avec le plus grand dévouement le service de réapprovisionnement du corps d’armée (1915) ». Par la suite, après la guerre, il exerce son ministère dans le diocèse de Besançon. En premier lieu, il est curé-doyen de Giromagny de 1919 à 1925, à l’époque où notre grand-mère exerce comme institutrice dans cette même commune (d’octobre 1918 à septembre 1921). C’est durant cette période qu’il prit part, le dimanche 31 octobre 1920, avec de nombreuses autorités dont le ministre du travail, M. Joudain et M.Lardier, maire de Giromagny qui « ouvre la série des discours » à l’inauguration du…
(La suite dans : « D’un monseigneur à l’autre… », par Colette Torra-Cuenat, page 79)
Les traces des charbonniers en montagne – 1re partie
Autrefois, nos montagnes étaient peuplées de petits lutins, de loups et… de charbonniers. C’est du moins ce qu’on peut lire dans les contes et légendes et ce que nous racontaient nos arrières- grand-mères. Ces trois catégories d’habitants de la forêt inspiraient de la crainte aux gens d’en bas, ceux qui ne rataient pas une messe et envoyaient leurs enfants au catéchisme. Mais si les loups ont disparu et si les lutins ne donnent plus de nouvelles, les charbonniers, eux, ont laissé des milliers de traces dans le massif du ballon d’Alsace : les places où ils édifiaient les meules de rondins qu’ils transformaient en charbon de bois.
Les plateformes de charbonniers
Les places de charbonniers (on les appelle aussi « charbonnières »), sont un peu comme les trèfles à quatre feuilles : on peut être un promeneur émerveillé par les douces ondulations des champs et des prés d’Evette-Salbert et n’en avoir jamais trouvé un seul, faute de regarder à ses pieds. On peut être un randonneur amoureux-fou des sentiers du massif du Ballon et n’avoir jamais remarqué une place de charbonnier, faute de s’étonner des petites anomalies du relief, de la présence de morceaux de charbon ou encore d’une terre particulièrement noire sur un talus bordant un chemin forestier. Vous allez me dire : « on n’en trouve quand même pas partout, non ? ». Eh bien si, il y en a partout dans le Massif vosgien, mais pas n’importe où. Je m’explique. Si on regarde une carte des places de charbonniers que j’ai déjà répertoriées au hasard de mes randonnées dans le nord du Territoire, on voit qu’il s’en trouve sur toutes les communes. L’inventaire n’est pas complet – et ne le sera sans doute jamais – ce ne sont là que quelques repérages effectués plus ou moins au hasard.
Oui, il s’en trouve sur toutes les communes, mais pas n’importe où car, pour faire du charbon de bois, il faut du bois… Et la forêt n’a pas toujours eu l’emprise territoriale qui est la sienne en 2017. En outre, certains secteurs forestiers sont plus particulièrement exploités pour faire du charbon de bois, comme la Tête des Mineurs, par exemple, où l’on peut dénombrer jusqu’à 90 places de charbonniers à l’hectare. La nature des essences y est pour quelque chose : ici on trouve le hêtre en abondance, ce Fagus sylvatica dont dérive le nom de la montagne qui prolonge vers le sud la Tête des Mineurs : le Fayé. Un inventaire minutieux effectué sur la Pointe des Roches, secteur proche de la Tête des Mineurs, sur une superficie de 84 hectares, a permis de constater que la plupart des 74 places de charbonniers étaient situées à moins de 30 mètres d’un chemin. La raison est évidente : faciliter le transport du bois à carboniser et l’enlèvement du produit fini par les voituriers.
La forme des plateformes

Sans prétendre établir une typologie, on peut distinguer une place de charbonnier d’une autre par ses dimensions, son état de conservation, la présence ou non de morceaux de
charbon. Il semble bien que les places les plus grandes sont les plus récentes et que ce sont elles qui présentent le plus fréquemment des morceaux de charbon de tailles et de quantités significatives dès qu’on gratte un peu leur surface. L’allure générale d’une aire de charbonnier est une surface horizontale permettant d’y inscrire un cercle d’un diamètre de 4 à 6 mètres. En montagne, elle est relativement facile à repérer puisqu’elle ressemble à une entaille faite dans la pente ; la terre, déblayée en amont, est entassée en aval de la pente pour former un remblai et doubler ainsi la largeur de la terrasse. Les deux talus ainsi formés se remarquent assez facilement même dans les pentes les plus faibles. Bien sûr, avec l’érosion, les angles s’émoussent, les creux se remplissent et les bosses s’adoucissent. Cette usure, qui augmente au fil du temps, pourrait permettre de classer les charbonnières par ordre chronologique si elle ne dépendait pas d’autres facteurs comme la pente, la nature du sol et de la végétation… et si les travaux forestiers ne venaient pas sillonner, racler ou remblayer des vestiges déjà bien dégradés.Les charbonnières ne sont guère photogéniques. La plupart du temps elles ont été colonisées par des arbres de toutes les tailles ou encombrées par des troncs d’arbres morts. Heureusement, la neige s’y attarde un peu et souligne par sa blancheur l’horizontalité du replat. La place photographiée ici (fig. 3) se situe dans le vallon de la Goutte des Mineurs, petit affluent de La Madeleine.
Le dernier charbonnier du Pays sous-vosgien est vraisemblablement mort depuis longtemps et une épaisse couche de feuilles mortes s’est déposée au fil des ans sur la dernière charbonnière qui a fumé dans nos forêts. Toutefois, on peut se faire une bonne idée de ce qu’était le travail de nos charbonniers en allant faire une petite excursion dans la Forêt de Chaux (pas notre Chaux à nous, mais cette belle forêt qui est au sud de Dole, dans le département du Jura ! ) où, sur le territoire de la commune de La Vieille-Loye, un petit écomusée très intéressant fait revivre les vieux métiers de la forêt et fait la place belle à la fabrication du charbon de bois ; on peut y voir une plateforme parfois occupée par une meule. Là-bas, le relief est peu marqué et il est moins facile de retrouver sous la couche d’humus les plateformes anciennes.
Où peut-on voir une place de charbonnier dans nos montagnes ?
Il y en a partout mais elles ne sont pas toujours faciles d’accès. En voici trois que l’on peut atteindre sans trop marcher et sans GPS.
St-Nicolas
Position GPS (donnée à titre indicatif) : 47.7451 / 6.9397
Du hameau de St-Nicolas prendre la petite route d’Etueffont sur 310 m à partir du pont. A cet endroit, sur la gauche, démarre un sentier de randonnée qui conduit à Rougemont en suivant la rive droite de la St-Nicolas. Marcher sur 60 m et, à gauche, à quelques mètres du sentier, rechercher…
(La suite dans : Les traces des charbonniers en montagne, par Roland Guillaume, page 86)
Crash sur la Beucinière… Une étoile au tapis !
Le 5 octobre 1967, un avion de chasse canadien percute à grande vitesse les pentes du ballon d’Alsace. L’avion et son pilote disparaissent en quelques secondes dans la brume dense qui s’est répandue sur la forêt.
Depuis la vallée, 5 octobre 1967 en matinée…
« Vers 10h15, j’ai entendu un avion à réaction venant de Belfort et se dirigeant vers le Ballon d’Alsace. Nous avions l’habitude d’entendre des avions à réaction et je n’y ai pas particulièrement prêté attention. Quoi qu’il en soit, au bruit de son moteur, je pouvais imaginer qu’il volait à basse altitude. […] M. Demeusy et moi avons entendu un bruit plus fort, similaire à un coup de tonnerre. […]. À ce moment le ciel était très couvert et le brouillard cachait la montagne. […] J’ai tourné mon regard vers la forêt de la Beucinière. J’ai vu au travers de la forêt comme un feu important, comme un éclair. J’ai également vu une importante fumée noire. Le feu a duré 10 secondes puis plus rien ». Emile Marsot, 74 ans, retraité vivant à Lepuix-Gy, vient d’assister en direct à l’accident d’avion qui va coûter la vie à un pilote canadien sur les pentes surplombant son village. Il n’est pas le seul à avoir vu, de manière très fugace, la chute de l’avion. A ce moment précis, il se trouve en compagnie de Désiré Demeusy, 67 ans, dans un champ appartenant à ce dernier, à proximité de la rue de Belfort. Le témoignage de M. Demeusy est concordant. Vers 10h15, sous un ciel très couvert et un plafond très bas, il a perçu un bruit de réacteur signalant un avion volant à basse altitude sur le secteur du Querty-La Beucinière. Un bref éclair de lumière, une explosion, une lueur d’une vingtaine de secondes et puis le brouillard qui se referme. Les deux hommes ont compris. Ils viennent d’assister à un accident d’avion. Il leur faut prévenir les autorités. La chaîne d’information se met en place. Emile Marsot, en rentrant chez lui, fait un court détour par la mairie de Lepuix-Gy où il signale l’événement au secrétaire. Ce dernier appelle la brigade de gendarmerie de Giromagny. C’est le gendarme Henri Bulle qui réceptionne l’appel téléphonique. À 10h45, soit une demi-heure après les faits, quatre gendarmes sont à Lepuix-Gy. Ils pénètrent dans les bois et commencent à monter la pente en direction de la Planche des Belles Filles. Après une heure de marche difficile à cause d’un brouillard extrêmement dense à partir de 800 mètres d’altitude, ils découvrent la première pièce qu’ils identifient vite comme une pièce d’aéronef moderne. Elargissant peu à peu leur recherche, vers 13h ils découvrent enfin l’impact. L’avion s’est littéralement désintégré en percutant la montagne, éparpillant ses débris sur une centaine de mètres et entraînant son pilote dans la mort.

Un pilote solide et expérimenté
Ce pilote, c’est le Squadron Leader Donald Joseph Misselbrook. Il est né le 25 octobre 1929 à Turtelford, dans l’immense et sauvage province du Saskatchewan au centre du Canada. Il est le deuxième fils d’une fratrie de quatre garçons et une fille. Il vit une jeunesse classique pour un jeune Canadien, jouant notamment au hockey. Il a travaillé tôt dans une boucherie locale puis comme aide-charpentier et a passé cinq mois dans la réserve militaire.
Le 12 octobre 1952, il se décide à entamer une carrière militaire professionnelle en s’engageant dans la Royal Canadian Air Force, la RCAF. Il postule rapidement pour devenir pilote et obtient ses ailes le 1er mai 1953 sur la base de Portage la Prairie. Un rêve se réalise… C’est aussi là qu’il rencontre une secrétaire de banque, Diane Allison Whybe, alors âgée de 20 ans. C’est le coup de foudre et ils se marient rapidement. Le jeune pilote est nommé outremer au 439e Squadron à North Luddenham puis à Marville en France, dans la Meuse, le 6 janvier 1954. Il y découvre un chasseur rapide et racé, le F-86 Sabre, appareil sur lequel il accomplira plus de 1 000 heures de vol. De 1957 à 1960, son expérience l’amène à devenir instructeur sur T-33. Il obtient sa qualification de chef de patrouille le 9 mai 1959.
La suite logique de sa carrière est de voler sur l’appareil le plus moderne de l’armée de l’air canadienne, le F-104 Starfighter. Il le fait d’abord sans enthousiasme, mais obtient rapidement sa qualification sur cet appareil. L’année 1967 démarre et tout va désormais évoluer très vite : le 1er mai Donald Joseph Misselbrook est promu chef d’escadrille (Squadron Leader) et le 5 août il est envoyé au 3e Wing, 427e Squadron basé en Allemagne. Il y commence son entraînement au combat aérien le 14 août. L’une des missions assignées aux Starfighters canadiens est en effet la pénétration à basse altitude et haute vitesse dans le cadre d’un bombardement nucléaire. Cette mission spécifique nécessite une parfaite maîtrise de l’environnement et est, bien sûr, à replacer dans le cadre de la guerre froide. Le monde est divisé entre les blocs de l’Est et de l’Ouest. Les Canadiens sont intégrés à l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) et leurs escadrilles aériennes sont installées en France (jusqu’en 1966) et surtout en Allemagne sur les bases de Baden Solingen ou Zweibrücken, « home » du 427e RCAF Squadron. De plus, les conditions de vol dans le secteur de la Forêt Noire et du massif des Vosges sont particulières… l’altitude, les conditions météorologiques changeantes et délicates nécessitent une bonne connaissance des procédures et un entraînement poussé. A 38 ans, le Squadron Leader Misselbrook est devenu un pilote expérimenté.
Totalisant 4257 heures de vol sur jet dont 921 heures sur F-104, c’est désormais un pilote confirmé. Humainement, l’homme suit une belle trajectoire : cinq naissances, toutes des filles, sont venues combler son mariage. Toute la petite famille a suivi le père en Allemagne et vit sur la base. Une grande famille ne fait pas peur à notre pilote canadien ! Lui-même est issu d’une importante fratrie. Ses filles se souviennent d’un homme strict mais juste, extraordinairement actif. Les nombreux déménagements qui ont émaillé sa vie professionnelle n’ont pas altéré l’unité de la cellule familiale. Au contraire, c’est une famille soudée et aimante qui le suivra partout.
Très sportif, Donald a joué au hockey, sport national canadien, mais aussi au base-ball, au curling, au golf et a pratiqué la natation. Il ne dédaigne pas la chasse et la pêche. Très social, il entraîne sur la base des équipes de jeunes hockeyeurs, qu’il doit d’ailleurs retrouver le 5 octobre 1967 en fin de journée, après sa mission. Il a plusieurs hobbies, comme le travail du bois, la photographie. Très habile de ses mains, bon bricoleur, il donne des «coups de main» à sa famille et aidera notamment l’un de ses frères à construire sa maison. Il n’hésite pas non plus à construire en une nuit une fausse cheminée afin que ses enfants puissent suspendre leurs chaussettes la nuit de Noël ! « Il riait facilement et permettait aux gens de se sentir à l’aise à la maison et avec lui.
« C’était un homme bon » se rappelle Sharon, l’une de ses filles. « Il avait toujours le sourire, se montrait amical et fraternel, toujours là quand vous aviez besoin de lui. Il adorait son métier, son pays et sa famille »se souvient également une deuxième fille, Shelly. Mais par-dessus tout, c’est voler qui lui procurait le plus grand plaisir, peut-être parce que c’était là qu’il se sentait le plus libre. On retrouve cette passion de la vitesse et des sensations fortes dans la voiture de sport rouge qu’il aimait conduire en toute occasion sur la base ! Le Squadron Leader Misselbrook est donc un homme stable, mature, professionnellement et humainement comblé.
Que s’est-il passé le 5 octobre 1967 ?
(La suite dans : Crash sur la Beucinière…, par Stéphane Muret, page 94)
Une tombe, une histoire…
Une fois n’est pas coutume. Sous ce titre, deux textes nous sont offerts. Les tombes se trouvent toutes deux au cimetière de Giromagny et méritent que l’on s’y arrête un instant. Gérard Jacquot d’une part, Maurice Helle et Jean-Christian Pereira ensuite, ont choisi une tombe et nous racontent l’histoire de celui qui y repose. (Ndlr)
Gaston Gillet, enfant de Giromagny mort pour la France
Gillet Gaston Albert Xavier est né le 26 avril 1908 à Giromagny. Fils de Gillet Xavier Emile (1879-1925) et de Hosatte Célina Judith (1885-1961), il épouse Bock Léa Lucine Aline (1912-1952) le 10 juin 1930 à Giromagny. Il occupe un emploi d’agent électricien à l’usine à gaz de Giromagny jusqu’à son incorporation le 28 novembre 1928. Il effectue son service, à la suite de quoi il est renvoyé dans ses foyers le 7 octobre 1929. Rappelé à l’activité le 28 avril 1939, il gagne la 8e compagnie du 79e Régiment de réserve. Arrivé au corps le 28 août 1939, il est affecté au dépôt d’infanterie n° 72 le 22 septembre 1939. Malgré la perte de deux phalanges, il est maintenu dans le service auxiliaire par la commission de réforme le 16 février 1940. Il est démobilisé le 30 septembre 1940 par le centre de démobilisation du canton de Giromagny.

Il signe un contrat d’engagement en appel du décret 366 du 25 juillet 1942, au titre du réseau César Buckmaster, en qualité d’agent P2 de 3e classe, grade correspondant à sous-lieutenant pendant la mission. Les réseaux d’action étaient des organisations créées et dirigées hors de France par l’une des trois puissances alliées, la France libre, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. En Franche-Comté, seuls les réseaux anglais connaissaient une certaine importance, par leurs opérations exécutives (Special Operations Executive, section F, dits réseaux Buckmaster) et dirigées localement par des hommes parachutés. Ils travaillaient en étroite collaboration avec les résistants de France intérieure. Les résistants de base ignoraient généralement qu’ils travaillaient au sein d’une organisation anglaise que rien ne distinguait des autres, sinon l’absence de toute propagande politique et la supériorité en armement sur Belfort ; le réseau d’un officier d’active Ferrand adhéra à cette organisation. Le rôle de Gaston Gillet était de stocker et d’entretenir l’armement pour un groupe de dix
hommes. Il participa à l’évasion de prisonniers anglo-américains du camp de prisonniers de Giromagny.
À la suite d’une dénonciation, il est arrêté à Giromagny le 18 mars 1944 pour…
(La suite dans : Gaston Gillet, enfant de Giromagny…, par Gérard Jacquot, page 101)
Une autre tombe, une autre histoire…
Dès le portail du cimetière de Giromagny franchi et derrière la maison du gardien, un monument près des tombes de la famille Zeller attire immédiatement l’attention. En effet, il s’agit là d’une stèle de section rectangulaire et de dimensions modestes certes au regard des tombes qui l’entourent, mais qui présente une ornementation bien particulière, sans équivalent semble-t-il dans le pays sous-vosgien.
La face avant exposée aux intempéries, gagnée par les mousses et surtout victime de l’usure du temps, offre une épitaphe difficilement lisible :
Ci […..] Rougegoutte le […] février 1770 capitaine d’artillerie
Chevalier de la légion d’honneur décédé à Giromagny le [.] 8 décembre 18 [..]
Brave dans les combats, humain après la victoire
Bon père bon ami sa fille pleure en lui un tendre père
RP IP
Sous ce texte, en léger creux, apparaissent dans un demi-cercle, différents attributs militaires : au centre un shako avec son plumet et sa jugulaire relevée, à droite la poignée d’un sabre avec garde et quillon, à gauche une pointe ou lance de drapeau ornée d’une écharpe, le tout dans un entrelacs de végétaux.
À la base, dans un rectangle élargi et toujours en creux, se devinent – même sous forme stylisée – deux canons entrecroisés et entourés également de motifs végétaux.
Le dos de la stèle livre des informations plus faciles à déchiffrer :
Campagnes du Rhin Siège de Mayence
Campagnes d’Italie Siège de Gaète
Campagnes d’Egypte Siège de St Jean d’Acre
Bataille d’Aboukir
Il fut décoré sur le champ
De bataille de la main de
l’Empereur Napoléon
Comme sur la face avant, dans deux parties en creux de formes et dimensions similaires, sont gravés sous ce texte, une Légion d’honneur et en dessous, un énigmatique griffon.
Il est à relever que la mention « l’empereur Napoléon » se détache particulièrement dans la mesure où
elle apparaît en arc de cercle au dessus du motif de la médaille…un rare privilège qui valait bien d’être mis en valeur !

Sous cette tombe, repose Simon Marchand de Rougegoutte
Mais qui se cache derrière ce capitaine d’artillerie ? Grâce aux informations données par notre ancien président fondateur François Liebelin et vérifications faites… plus de doute : Simon Marchand, natif de Rougegoutte repose en ces lieux. D’après la mention portée par le curé Taiclet sur le registre paroissial de Rougegoutte, Simon Marchand voit donc le jour dans cette commune et reçoit le baptême le 26 février 1770, fils légitime de Pierre Georges et Françoise Perod, ses parrain et marraine étant Simone Liblin et François Peltier. L’union de Pierre Georges et Françoise, célébrée le 23 août 1763 se révèle féconde : deux filles dont une décèdera l’année suivant sa naissance et quatre garçons dont deux seulement survivront.
Ses services successifs et ses actions d’éclat. Il embrasse la carrière des armes à l’âge de 19 ans, soldat au 2e bataillon du Haut-Rhin au sein de l’Armée du Rhin placée sous les ordres du général Custine, du 17 septembre 1791 au 20 mai 1793. Il se signale à l’attention de ses chefs en montant à l’assaut d’une redoute près de Mayence (lors de l’engagement du 10 au 11 avril 1793) pendant lequel il subit sa première blessure : un coup de biscayen reçu à la jambe gauche en dirigeant la pièce pour tirer sur l’ennemi qui revenait pour la reprendre. Ce coup d’éclat le conduit tout naturellement à choisir cette spécialité qu’il fera sienne désormais : l’artillerie.
Canonnier à la 21e compagnie d’artillerie à cheval, il participe du 20 mai 1793 au 5 juin 1794 à la guerre de Vendée sous les ordres des généraux Dubayet et Ferrand, guerre fratricide et sans merci opposant les Vendéens plutôt d’origine paysanne et de confession catholique aux troupes républicaines (les Bleus). Il s’illustre à nouveau le 26 octobre 1793, resté seul des canonniers de sa pièce et a soutenu la retraite de l’armée à l’aide de quelques officiers d’un des bataillons du Bas-Rhin qui lui portaient les munitions. Toujours canonnier, il rejoint l’Armée dite du Rhin et Moselle aux ordres du général Moreau. Le 1er régiment d’artillerie à cheval l’accueille en effet à compter du 5 juin ; il y décroche le 2 novembre 1794 la promotion au grade de brigadier. Il quitte ensuite le sol français pour une grande aventure…
(La suite dans : Une autre tombe, une autre histoire…, par Maurice Helle et Jean-Christian Pereira, page 101)
Le cadastre napoléonien à Lachapelle-sous-Chaux en 1809
Les documents du cadastre napoléonien permettent d’obtenir un état des lieux très précis des communes de France au début du XIXe siècle, avec notamment le recensement des
propriétés bâties et non bâties. Le présent article expose l’état des propriétés de la commune de Lachapelle-sous-Chaux sous le 1er Empire, à partir des documents déposés aux Archives départementales du Territoire de Belfort. Il fait suite à l’article « Les maisons paysannes du Pays sous-vosgien à Lachapelle-sous-Chaux » publié dans La Vôge n°42 de 2014.
Le cadastre napoléonien et ses prédécesseurs
« [….] faire procéder sur le champ au dénombrement général des terres, dans toutes les communes de l’Empire, avec arpentage et évaluation de chaque parcelle de propriété. Un
bon cadastre parcellaire sera le complément de mon code en ce qui concerne la possession du sol. Il faut que les plans soient assez exacts et assez développés pour servir à fixer les limites de propriétés et empêcher les procès ».
En juillet 1807, Napoléon s’adresse ainsi à son ministre du Trésor et conseiller financier Nicolas François Mollien. Il y avait là une grande ambition affirmée : complément au Code civil, précision des relevés, et garantie de la propriété individuelle. En réalité, l’idée d’un cadastre national servant d’outil fiscal pour imposer équitablement les citoyens est déjà dans l’esprit et les intentions de la Révolution : le principe d’une contribution égalitaire sur les propriétés foncières est fixé par la loi du 1er décembre 1790 et les décrets des 21 août et 23
septembre 1791 avec la décision de créer un plan parcellaire du territoire. Cette première tentative n’est pas mise en application, notamment par manque de moyens financiers.
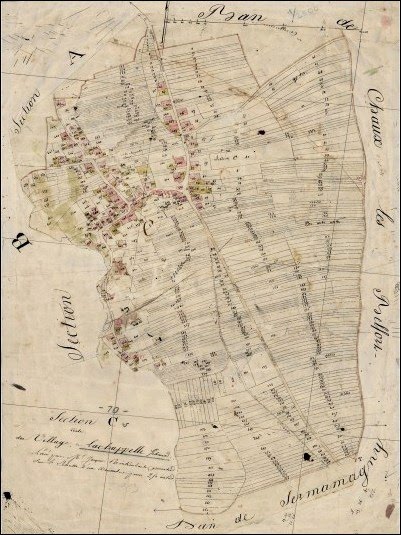
Une nouvelle tentative, suivant l’arrêté du 12 brumaire An XI, est lancée entre 1802 et 1807. Elle consistait à réaliser un « cadastre général par masses de cultures » regroupant
les cultures par nature sur des plans à l’échelle 1/5000. Ce n’était donc pas un cadastre parcellaire. L’opération est commencée, mais manquant de précision, elle est finalement
interrompue en 1807.
Alors, la loi des finances du 15 septembre 1807 décide définitivement de l’arpentage général de toutes les parcelles de la France, avec identification des propriétaires, indication des surfaces et précision de la nature des parcelles (habitations, forêts, terres labourables, prés…). Les relevés sont effectués entre 1808 et 1850 pour la France métropolitaine. C’est donc
le cadastre parcellaire français, appelé Cadastre Napoléonien.
Pour la réalisation des travaux de levée du cadastre parcellaire napoléonien, une nouvelle profession apparaît : le géomètre du cadastre, avec un ingénieur en chef, ou ingénieur vérificateur. Il dirige :
- le géomètre de première classe, celui qui réalise les plans et calcule les surfaces,
- le géomètre de seconde classe, ou l’opérateur, chargé des levées ponctuelles des parcelles.
La réalisation du cadastre napoléonien à Lachapelle-sous-Chaux
Les relevés sont effectués dans les cantons du département lors de quatre grandes périodes :
- de 1808 à 1811, le Nord du département, de Sermamagny à Lepuix-Gy jusqu’à Etueffont (19 communes),
- en 1823 – 1824, le Sud du département,
- en 1827 – 1828, le canton de Belfort,
- de 1831 à 1837, le Nord-Est du département avec les cantons de Rougemont et de Fontaine.
Les plans du «cadastre par masses de cultures» ont été réalisés à Lachapelle-sous-Chaux en 1806 avant l’interruption de l’opération (comme pour les communes de Bourg-sous-Châtelet, Etueffont-Haut et Evette). Ces plans ont alors servi de base pour la réalisation du cadastre parcellaire dit napoléonien en 1809.
Le géomètre de première classe qui a effectué les relevés est Jacques Rinckenbach. Il a également effectué ceux de Sermamagny et Evette. Pour réaliser les relevés de Lachapelle,
le géomètre a découpé la commune en trois sections :
- section A dite la prairie de Genechey, au nord de la commune,
- section B dite Sombre, Brois et Rougemont, au sud de la commune,
- section C dite du village et de la plaine, à l’est, le long de la route vers Auxelles.
Très schématiquement, ce découpage en trois sections correspond à la géographie de la commune, avec respectivement une partie haute, altitude 608 m à la Grande Côte, un versant incliné vers le sud, du lieu-dit les Malpateys (altitude 423) jusqu’au Malsaucy à l’altitude 390, et la plaine à l’est à l’altitude moyenne de 409 m.
Aux Archives départementales du Territoire de Belfort, pour chaque section, nous disposons des plans avec identification des parcelles, et d’un registre avec classement parcellaire. Ce registre indique pour chaque parcelle son numéro, le lieu-dit, le nom du propriétaire et son lieu d’habitation, la nature et la superficie, et également la tarification imposable
(La suite dans : Le cadastre napoléonien à Lachapelle-sous-Chaux en 1809, par Claude Parietti, page 109)
Jules Gasser, illustre enfant de Riervescemont
Assez peu connu dans le Pays-sous-vosgien, Jules Gasser, qui vécut de 1865 à 1958, est probablement le plus illustre des natifs de Riervescemont. Médecin et chirurgien, conseiller général, maire d’Oran, sénateur, il sera commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur. Il sera également candidat à l’élection présidentielle de 1947. Enfin, il publiera de nombreux ouvrages et utilisera le pseudonyme de J. Romagny.
Jules Théophile Gasser est né à Riervescemont le 11 avril 1865 de Jules Théophile François Xavier Gasser et de Marie Julie Marchal. Son père, natif de Réchésy, est âgé de 22 ans et instituteur en poste à Riervescemont. Sa mère, Marie Marchal, couturière, est native de Riervescemont, d’une ancienne famille du village. Elle est la petite fille de Jean Baptiste Piot, maire de 1814 à 1843. Il accompagne son père dans ses affectations successives : Rougegoutte de 1865 à 1875, puis Lachapelle-sous-Rougemont de 1876 à 1886. Sa mère décède en 1879 alors qu’il n’est âgé que de 14 ans. Il fera sa scolarité secondaire au collège libre de Lachapelle-sous-Rougemont.
Médecin
Il entreprend des études de médecine à l’hôpital militaire parisien du Gros-Caillou et au Val-de-Grâce. Il soutient sa thèse en 1890 : Études bactériologiques sur l’étiologie de la fièvre typhoïde.En 1891, il est nommé à l’hôpital militaire de Vincennes et en août 1892, au laboratoire de bactériologie de l’hôpital militaire d’Oran.
Cette même année, il publie un livre : Les causes de la fièvre typhoïde. « M. Gasser, dont les recherches personnelles sur la fièvre continue sont bien connues, a voulu, dans cette monographie, faire en quelque sorte abstraction de sa personnalité et nous a présenté, sous une forme éminemment claire et concise, l’état actuel de nos connaissances sur les causes de la fièvre typhoïde ». (Journal des connaissances médicales du 8 décembre 1892). Il met particulièrement en lumière le rôle de l’eau de boisson dans la transmission du microbe :
« Les voies par lesquelles se transmet le microbe pour pénétrer dans un organisme sain sont assurément multiples ; mais il en est une qui est de beaucoup la plus fréquente, c’est
l’eau de boisson. Le sol, dans certaines conditions, l’air atmosphérique, peuvent lui servir de véhicule, mais dans des proportions beaucoup moindres que l’eau potable».

En 1894, il va consacrer son énergie à la lutte contre la diphtérie. C’est alors un fléau mortel qui touche particulièrement les enfants. Une importante découverte vient d’être faite à Paris par le docteur Roux pour l’élaboration d’un vaccin destiné à guérir cette terrible maladie. L’hebdomadaire Le Progrès de Bel-Abbès du 21 octobre 1894 nous rend compte des débats du conseil général du département d’Oran qui adoptera à l’unanimité les conclusions du rapport présenté par M. Viviani :
« Au congrès international de médecine de Budapesth (sic), le docteur Roux attaché à l’Institut Pasteur a fait une communication qui a révolutionné le monde : le vaccin guérisseur contre la terrible diphtérie était trouvé. Cette découverte, due à la science française, a profondément ému le pays, et de tous les côtés sont arrivées des demandes du remède sauveur. Le département d’Oran qui, chaque année, paie un tribut considérable à l’épouvantable fléau ne pouvait rester, et n’est pas resté en arrière de cette légitime émotion. Dès l’ouverture de la session, des demandes de crédit ont été déposées pour utiliser la célèbre découverte. […] Nos collègues Sandras, Uhlmann, Vinciguerra et Lescure auxquels s’est joint M. Ed. Giraud ont, à leur tour, émis le vœu qu’un crédit de 3.000 francs fut accordé pour qu’il fut possible d’envoyer en France le docteur Gasser afin que celui-ci pût étudier, aux sources mêmes, la méthode du docteur Roux et vulgariser le procédé dans ce département. […] Il a fait valoir l’utilité de l’envoi de M. Gasser à Paris, ajoutant que ce docteur ayant fait et faisant chaque jour des études de bactériologie du système Pasteur, était plus à même que qui que ce fût de rendre à notre département le service de vulgariser le remède antidiphtérique.[…] Sur la proposition de M. Sandras, le Conseil prie M. le Préfet de demander officiellement à l’autorité militaire, qu’un congé de quelques jours soit accordé dans le plus court délai possible, à M. le docteur Gasser, pour s’acquitter de sa mission à Paris ».
On comprend l’urgence de trouver remède à ce fléau, mais les choses ne se passeront cependant pas aussi simplement. Le Messager de l’Ouest du 26 octobre 1894 : « La population oranaise est désolée de voir la diphtérie se développer dans tous les quartiers de la ville sans que jusqu’ici, aucune mesure ait été prise pour enrayer l’invasion »
L’Indépendant de Mostaganem du 4 novembre : « La chinoiserie n’a plus de limites. Le département avait demandé que le docteur Gasser, médecin militaire à Oran et ancien élève de Pasteur, fût envoyé à Paris pour étudier la manière de préparer et d’appliquer le vaccin antidiphtérique. La demande d’autorisation a voyagé pendant trois semaines entre Oran, Paris et Alger faisant dix fois le trajet, admise ici, repoussée là-bas. Un vrai casse-tête chinois ! Enfin on a fini par s’entendre, et le docteur Gasser a pu s’embarquer pour la France ».
Fin décembre 1897, Jules Gasser est nommé au laboratoire de bactériologie de l’hôpital militaire de Marseille duquel il démissionnera un mois plus tard pour devenir chirurgien à l’hôpital civil d’Oran. En août 1899, il sera chef de service dans cet établissement. En 1900, il publie Analyse biologique des eaux potables marquant là encore son intérêt pour la lutte contre la propagation des maladies infectieuses. Il est élu membre titulaire de l’Académie des sciences d’outre-mer dès sa fondation en 1923.
Engagé dans la vie publique
Son engagement social l’amènera tout naturellement à s’intéresser à la vie publique. Il sera, en 1904, président fondateur du comité oranais du Maroc et fera appel à toutes les initiatives pour le seconder dans l’œuvre qu’il a entreprise pour le développement de l’influence française au Maroc et la défense des intérêts oranais. Il est président de la société de géographie d’Oran et anime et préside l’œuvre d’assistance « Les Petits Oranais à la Montagne ». La Revue Mondaine Oranaise du 2 juillet 1905 nous explique de quoi il s’agit : « N’est-ce pas accomplir un devoir social que de chercher à rétablir la santé d’enfants, espoir de l’avenir, qu’a touchés la maladie et qu’un peu de bon air, additionné de substantielle nourriture remettrait définitivement sur pied ? […] personne ne niera qu’un peu…
(La suite dans : Jules Gasser, illustre enfant de Riervescemont, par José Lambert, page 115)
Les tourelles du fort Dorsner
Le fort Dorsner à Giromagny a été construit entre 1875 et 1880, du moins en ce qui concerne le gros œuvre : voies d’accès, terrassement, maçonnerie… Les deux tourelles, qui représentent l’essentiel de sa puissance de feu, ont été mises en place pendant l’hiver 1879-1880 avec des moyens qui suscitent encore l’admiration de nos ingénieurs contemporains.
La « ligne » Séré de Rivières
En conséquence de la défaite de 1871 face aux armées allemandes, la France a perdu non seulement les places fortes de Strasbourg et de Metz mais aussi cet obstacle naturel qu’est le Rhin. L’Empire allemand proclamé à Versailles le 18 janvier 1871 est puissant, militariste et pour le moins expansionniste. Son armée est bien équipée, bien commandée et plus nombreuse que celle de la jeune Troisième République. Pour permettre à l’armée française de se mobiliser tranquillement en cas d’attaque-surprise de la part des Allemands et pour compenser en partie la différence d’effectifs entre les deux armées, le général Séré de Rivières, secrétaire du Comité de Défense et directeur du service du Génie au ministère de la Guerre, propose – entre autres – la construction d’une ligne de fortifications déroulée le long de la nouvelle frontière, de la Suisse à la Belgique, face à l’Alsace et à la Lorraine annexées. Cette Barrière de Fer sera constituée de rideaux défensifs tendus entre des places fortes comme Belfort et Épinal, Toul et Verdun… Chacune de ces places est protégée par une ceinture de forts avancés pour éloigner l’artillerie ennemie. Le fort de Giromagny est à la fois un des éléments de la ceinture fortifiée de Belfort et le premier maillon de la chaîne qui constitue le rideau défensif de la Haute Moselle reliant Belfort à Épinal. Les maillons suivants sont le fort du ballon de Servance, de Château-Lambert, de Rupt-sur-Moselle…
Le fort de Giromagny
Un des rôles des forts de cette époque était de rassembler et de protéger des «bouches à feu», autrement dit des canons, avec le personnel, les munitions et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Ainsi, lors de sa conception en 1874, notre fort était dimensionné pour abriter plus de 40 canons, sans parler des pièces destinées à la défense des fossés.
Mais les terrassiers et les maçons avaient à peine commencé les travaux que, pour tenir compte de l’évolution rapide de la technique en matière d’artillerie, il fut décidé d’installer deux « tourelles Mougin » protégeant chacune deux canons de 155 mm pouvant tirer dans toutes les directions. On peut distinguer sur la photo l’emplacement des deux tourelles de part et d’autre du mât du drapeau, au-dessus de la cour centrale. Rappelons qu’une tourelle est, en matière de fortification moderne, une sorte de boîte en acier protégeant une arme (une mitrailleuse, un canon…) et ses servants, tout en pouvant pivoter sur elle-même. La tourelle d’un char d’assaut en est l’exemple le plus connu.
Par rapport aux batteries à l’air libre, c’est-à-dire aux groupes de canons installés sur les plateformes réparties sur le rempart d’un fort, la tourelle de 1880 présente deux avantages :
- les artilleurs et les pièces sont protégés de la pluie et surtout des tirs de l’ennemi
- la tourelle peut couvrir les 360 degrés de l’horizon
Mais elle présente l’inconvénient de coûter très cher : 205 000 francs la pièce. Les deux tourelles de Giromagny représentent 16 % du coût total du fort. Cette tourelle doit son nom à son concepteur, le capitaine Henri Louis Philippe Mougin (1841-1916), polytechnicien, aide de camp du général Séré de Rivières. Sa mise au point date de 1876, l’année suivant le début des travaux de terrassement ; la décision d’installer une tourelle à Giromagny a été prise en 1877, si l’on en croit le supplément au volume consacré à l’artillerie dans l’encyclopédie Les merveilles de la Science publiée en 1891. La seconde tourelle a été ajoutée au projet malgré le souhait du ministre de la Guerre d’en faire l’économie. Les tourelles Mougin de notre fort
sont donc des prototypes et leur mise en place va beaucoup intéresser les ingénieurs militaires.

La tourelle Mougin
Pour soustraire l’embrasure du canon – le point faible de la cuirasse – aux coups de l’adversaire, deux méthodes pour deux types de tourelles différents sont généralement appliquées : la tourelle rentre la tête dans les épaules en s’enfonçant dans le sol : c’est la tourelle à éclipse, ou bien elle tourne le dos à l’adversaire : c’est le principe retenu par le capitaine Mougin pour la tourelle rotative qui nous intéresse ici. La coupole est donc toujours visible, elle dépasse de 1,3 m environ et a un diamètre à la base de 6 m. Mais c’est aussi la partie visible de l’iceberg, car elle est soutenue par une charpente pivotante de 6 m de diamètre et de 2 m de hauteur, placée sur un plateau qui supporte également les canons, leurs affûts et le châssis sur lequel ils sont fixés. C’est en fait une masse totale de 180 tonnes qu’il faut faire tourner à la vitesse d’un tour en deux ou trois minutes. L’ensemble est supporté par 16 galets légèrement coniques qui roulent sur un chemin de roulement circulaire fixe et sur lesquels tourne un plateau par l’intermédiaire d’une couronne semblable au chemin de roulement. L’ensemble fonctionne comme une simple butée à rouleaux coniques bien connue des mécaniciens. Le pivot central ou moyeu, qui coulisse et tourne dans un cylindre rempli d’eau glycérinée, sert aussi de vérin pour soulager le poids sur les galets et faciliter la rotation ; pour ce faire, une pompe hydraulique permet de mettre le cylindre en pression pour diviser par la force s’exerçant sur les galets. La mise en rotation peut être effectuée à la manivelle ou à l’aide d’une petite machine à vapeur (ce qui était le cas dans notre fort) ou encore, quand la technologie l’a permis, grâce à un moteur électrique. Pendant le chargement des canons, ces derniers tournent le dos à l’ennemi et la mise à feu n’aura lieu que lorsque la tourelle sera orientée dans la direction de la cible, ce qui n’étonnera personne. Le tir est déclenché par un contact électrique réglé par le chef de tourelle. Les deux canons peuvent fonctionner indépendamment l’un de l’autre et traiter ainsi deux objectifs différents à la fois. On peut noter au passage que les artilleurs en tourelles sont comme dans un sous-marin, et qu’ils ne reçoivent les indications sur la position des objectifs et sur les résultats des tirs que de la part des guetteurs, placés dans chacun des observatoires bétonnés qui émergent des…
(La suite dans : Les tourelles du fort Dorsner, par Jérôme Roffi et Roland Guillaume, page 121)
L’enseignement primaire à Romagny-sous-Rougemont, une longue histoire qui se termine…
Ouverte à la rentrée scolaire 1887, la petite école de Romagny-sous-Rougemont est restée porte close en septembre 2017. Cent-trente années de leçons et de récréations qui s’évanouissent…
Jusqu’en 1830, les enfants de Romagny sont accueillis à l’école paroissiale de Rougemont. Mais cette école tombe en ruine. Les trois communes qui la possèdent conjointement, à savoir Rougemont, Leval et Romagny, sont d’accord pour la vendre et pour aménager un nouveau bâtiment, toujours à Rougemont, dans ce qui était autrefois la grangerie de la maison curiale de la paroisse (où se trouvaient les salles de catéchisme attenantes au presbytère). Le 10 septembre 1830, le conseil municipal de Romagny accepte la vente de l’ancienne école de Rougemont, mais réuni en séance extraordinaire le 20 septembre 1931, le même conseil observe que les travaux du nouveau bâtiment ainsi que le logement de l’instituteur ne sont toujours pas terminés. De plus, sollicitée pour participer au financement du nouveau mobilier scolaire, la municipalité de Romagny ne peut consentir à une telle dépense, d’autant qu’elle n’a toujours pas recouvré le prix de la vente de l’ancienne école auquel elle a droit. Un lieu pour « donner de l’enseignement ».

Quatre jours après ce constat, le 24 septembre 1831, le conseil municipal se réunit à nouveau. Le maire expose «qu’il serait d’une grande utilité à la commune d’avoir une maison propre pour tenir ou donner l’enseignement». On peut dire qu’en cela, la commune de Romagny devance largement la loi Guizot qui imposera, en 1833, à toute commune de plus de 500 habitants d’entretenir au moins une école primaire. S’ensuit la délibération suivante :
- Qu’il serait d’une grande utilité d’acquérir ou de construire une petite maison propre pour y tenir l’école. L’époque d’acquisition ou de construction est fixée à l’année prochaine
pour que les enfants puissent jouir de l’école pendant l’hiver. - Que pour faire face à cette dépense, il soit crédité au budget une somme de 100 francs par an pour les cinq exercices suivants.
- Il supplie monsieur le Préfet de venir au secours de la commune pour l’aider à acquérir ou construire le dit bâtiment.
- Quant à la maison d’école pour le présent hiver, on sera obligé de louer une chambre pour tenir l’école.
Les archives consultées ne permettent pas de dire si le choix d’une maison d’école a pu être fait pour les hivers 1831 et 1832. Mais le 1er septembre 1833, le sieur Georges Schainquelin, instituteur et propriétaire dans la commune, se propose de fournir « une chambre propre et assez vaste dans son habitation pour y donner l’instruction primaire aux enfants de la commune » et cela à compter du 1er novembre de la présente année, moyennant la somme de 30 francs par an sans l’ameublement. Le maire Jean-Claude Clerc, avec l’avis du conseil, déclare accepter cette proposition pour une durée de 3 ans. [On notera que depuis le 1er janvier 1819, la mairie est aussi installée chez Georges Schainquelin, mais rien ne
dit qu’il s’agisse de la même maison.]
Il n’est pas sûr que le sieur Schainquelin soit, en 1833, le premier instituteur de Romagny. Mais le 9 novembre 1834, le conseil municipal délibère sur le choix d’un maître d’école et retient le sieur Jean-Pierre Heidet, natif de la commune, de bonnes mœurs et titulaire du Brevet de Capacité de l’Instruction Primaire Elémentaire obtenu à Belfort le 13 mars 1834.
L’école demeurera chez Schainquelin jusqu’à la fin de l’année 1838. Le 1er décembre 1839, une nouvelle convention est signée par le maire avec, cette fois, le sieur François Heidet, cultivateur dans la commune : « Moi, dit Heidet, promet et m’oblige à fournir à la dite commune une maison assez vaste pour tenir lieu de maison d’école dans la dite commune et je m’oblige de plus de fournir les bancs, tables nécessaires pour faire la classe et ce pendant quatre années dont la présente fait partie ».
Il s’agit d’une maison vacante qui a été occupée dès le 1er janvier 1839. Le loyer est de 30 francs l’an, payables à la fin de chaque année. En 1841, Romagny-sous-Rougemont compte 300 habitants. La municipalité considère que le cinquième de cette population doit être scolarisé, soit une soixantaine d’élèves. Elle estime un accroissement possible du cinquième de cette population scolaire, c’est-à-dire 12 élèves de plus, dans un avenir proche, et arrive ainsi au chiffre important de…
(La suite dans : L’enseignement primaire à Romagny-sous-Rougemont, une longue histoire qui se termine…, par François Sellier, page 129)
Histoires de machines : le « tour sur barres »
À partir des années 1860, les progrès métallurgiques faisaient décoller la production de fer et d’acier. Les machines-outils suivirent, avec une diversité et une précision d’usinage surprenantes. Pour la production de visserie on conçut des «tours à décolleter», dont quelques uns figuraient dans la collection réunie au Tissage du Pont…
Le tour à métaux usuel (« parallèle ») permet des opérations multiples sur des pièces variées. Mais les efforts suivent un long trajet, à travers plusieurs glissières et pivots, au détriment de la rigidité. En décolletage on travaille au bout d’une longue barre entraînée en rotation, et périodiquement avancée. La capacité étant limitée par le passage de broche, on peut guider la barre très près des outils, minimisant les flexions.Des machines frustes mais spécifiquement adaptées aux vis, écrous, axes et entretoises, étaient ainsi économiques, productives et précises.
Un « tour sur barres » primitif
Malgré un long service la machine est presque en état d’origine (paliers et patins du chariot refaits en régule, porte-outils retouché). Il y restait l’équipement pour une barre Ø 50, un
petit outil droit à l’arrière et des copeaux d’acier (largeur 5 mm). Rustique et simple (deux outils et une butée transversale) elle est apparentée aux « tours parisiens » largement utilisés jusqu’aux années 1950-1960 (tours Legras, Bourel, Vieira, etc.), qui dans cette dimension valaient 1500 à 3000 F en 1913. Mais ceux-ci étaient déjà plus évolués, avec 3 ou 4 outils, des butées transversales multiples et un banc formé d’une poutre en fonte, plus rigide. Serions-nous en présence d’un type nettement antérieur à 1913, ou d’un modèle « économique » des années 1910-1930 ? Avec pour seul marquage un numéro « 32 » frappé en divers points, la datation est hasardeuse !

Entraînement
En l’absence de moteur, certains éléments sont simulés (matière, courroies et renvoi, de couleur blanche). Au début, la barre de matière dépasse derrière la broche; un support externe la soutient dans l’axe. Les paliers sont coulés d’une pièce avec la gouttière en fonte, et garnis de coussinets antifriction. La broche, forée à 65 mm, est nantie d’un mandrin simpliste (trois boulons à 120°), et entraînée par une poulie centrale flanquée de deux poulies folles. Une courroie plate directe et une croisée descendent d’une large poulie de renvoi tournant en permanence ; en position d’arrêt elles entraînent les poulies folles en sens inverse. Pour marcher dans l’un ou l’autre sens, on pousse l’une des courroies sur la poulie centrale, à l’aide d’une fourchette coulissante (ici incomplète).
Chariot
En fonte, il comporte une forte console triangulaire pourvue d’une lunette (1) recevant un «canon» (tube ajusté au diamètre de la barre à usiner, qui sera ainsi guidée au plus près de l’outil). Le chariot se déplace longitudinalement par un volant à quatre branches engrenant une crémaillère taillée sous la barre du banc. Le porte-outils coulisse transversalement sur ce chariot par une manivelle et reçoit deux outils en vis à vis (2 & 3), orientés pour utiliser l’un ou l’autre sans changer le sens de rotation.
Schéma d’utilisation
Ce genre de tour est destiné à réduire le diamètre d’une barre sur une certaine longueur (formant par exemple la tige d’un boulon), puis à la tronçonner soit sur la partie réduite, soit un peu plus loin, sur le Ø de la barre brute (la tête du boulon). Et à enchaîner rapidement sur une autre pièce identique, la productivité primant la polyvalence :
- la courte distance entre outil et canon de guidage évite les flexions, permettant de prendre un large copeau et d’usiner un boulon en une passe.
- le chariot démarre au bout du banc (barre largement sortie du mandrin) et avance à chaque pièce, grignotant la barre. La machine n’est stoppée que quand le chariot arrive au mandrin, pour le reculer au maximum et sortir la barre d’autant.
- les cotes de diamètre et de longueur ne sont pas données par lecture de graduations, mais par des butées pré-réglées. Ici une seule butée micrométrique (4), transversale, pour l’outil arrière (p. ex. Ø de tige du boulon). Les longueurs (de tige ou totale) sont définies par des jauges (9 & 10) venant frotter au bout de la pièce. À cet effet, derrière le porte-outils sont vissées deux colonnes horizontales (5 & 6) sur lesquelles pivotent des bascules (7 & 8) percées de trous pour claveter les jauges (escamotables par ouverture de la bascule).
- le canon de guidage admet à la rigueur les barres carrées ou hexagonales, donnant directement les têtes de boulons polygonales.
En suivant strictement une routine simple les pièces s’enchaînent rapidement, avec des cotes assez précises. Mais ces tours accueillent difficilement les tarauds, filières et même forêts ! Perçages et filetages sont donc repris sur des machines spéciales, ainsi que…
(La suite dans : Histoires de machines : le « tour sur barres », par Patrick Lacour, page 129)
La petite histoire en patois
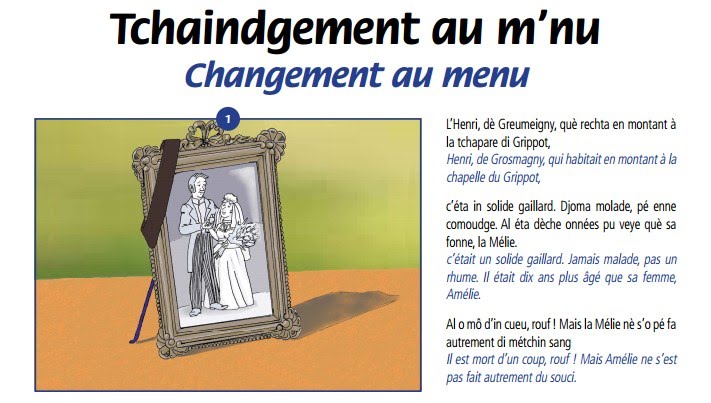
(La suite (et surtout la fin ! ) dans : Tchaindgement au m’nu, par José Lambert et François Bernardin, page 136
Magazine
Hommage à Francis Péroz par François Sellier avec l’aide d’Elisabeth Péroz
Né en 1959 à Belfort, Francis Péroz était un historien et un auteur très connu dans le Territoire de Belfort, et bien au-delà.
Après son baccalauréat, il entreprend des études d’ingénieur ; mais il est avant tout intéressé par l’Histoire. Il suit donc des cours en cette matière à Besançon, obtient un diplôme d’étude approfondie (DEA) en histoire sociale, puis soutient une thèse de doctorat en histoire contemporaine à l’Université de Tours. Parallèlement à sa profession d’enseignant en histoire-géographie, qu’il exerce avec passion, il devient un infatigable fouilleur d’archives. Ses recherches se concrétisent par la publication de très nombreux articles et ouvrages dont vous trouverez la liste ci-après.

Bien des passions ont animé la vie de Francis : la photographie (des animaux entre autres), l’évolution de l’industrie et des techniques, la mise en valeur de l’artisanat rural et des pratiques locales (à l’AHPSV, il fut très attentif au devenir du Tissage du Pont), la montagne, l’espace arctique, les voyages. Il s’est également beaucoup impliqué dans la vie associative (comme membre et président de la Compagnie Belfort-Loisirs, comme membre actif de l’AHPSV, etc.).
Avec les années, à travers ses écrits, ses conférences, son engagement, il nous a transmis sa passion, il a fait œuvre de mémoire. Francis a beaucoup collaboré à La Vôge et cela dès le N° 2 de décembre 1988 ! En 2016, dans le N°44, il nous offrait encore deux articles intitulés A la frontière et Des Malgaches au pied des Vosges.
Au terme de cette vie intense et riche, c’est un ami qui nous a quittés le 16 février 2017.
Bibliographie de Francis Péroz :
- « Médecine, Santé et Hygiène publique au XIXe siècle dans le Territoire de Belfort », mémoire de Diplôme d’Etude Approfondie en Histoire sociale soutenu le 16 octobre 1987.
- « Regards sur la Petite Montagne », ADAPEMONT. Editions du Suran. Ouvrage collectif. 3e trimestre 1994.
- « Hygiène et santé dans le Territoire de Belfort au milieu du XIXe siècle », article publié dans la revue de la Société d’Emulation Belfortaine N°86, en 1995.
- « Les «50 ans» de la Compagnie Belfort Loisirs », publication éditée par la C.B.L en 1995.
- « La santé dans le Territoire de Belfort au XIXe siècle », thèse de Docteur en Histoire contemporaine soutenue le 30 mai 1997 à l’Université de Tours, sous la direction de Claude-Isabelle Brelot.
- « La santé dans le Territoire de Belfort au XIXe siècle : pathologies, thérapeutes et prévention », article publié dans la revue de la Société d’Emulation Belfortaine N°90, en 1999.
- « Artisanat rural comtois, Itinéraire et Découverte » Franche-Comté Editions. 2004.
- « La campagne franc-comtoise – Vie et traditions d’autrefois ». Ed. CABEDITA.2006.
- « Le Territoire de Belfort ».Editions Sutton. 2006.
- « L’aire urbaine vue du ciel », en collaboration avec Jean-François Lami et Philipe Aeby. F C Editions. 2006.
- « Belfort à travers l’histoire », en collaboration avec Jean-François Lami. Editions Coprur. 2008.
- « Belfort-Montbéliard-Histoire d’un Bassin Industriel Comtois ». Editions Sutton. 2008.
- « La vie Autrefois dans les Vosges Saônoises 1890-1920 » Editions du Belvédère. 2009.
- « Alstom» à Belfort 130 ans d’aventure industrielle », ETAI. Ouvrage collectif. 2009.
- « Belfort d’hier à aujourd’hui ».Editions Sutton. 2011.
- « De Jaurès à Pétain . Itinéraires de L.O. Frossard ».Publication UTBM.2012. Prix Lucien Febvre en 2012.
- « Le Ballon d’Alsace » L’histoire naturelle et humaine du massif ». Editions du Belvédère. 2013.
- « Le Territoire de Belfort d’antan à travers la carte postale ancienne ».H C éditions. 2014.
- « Mémoires de verre – Regards sur le Pays de Montbéliard, Belfort, le Ballon D’Alsace, les Vosges »… Editions du belvédère. 2014.
- « L’Exploration Polaire Française, une Epopée humaine ». Editions du Belvédère. 2015.
- « L’Alsace-Lorraine et le Territoire de Belfort dans la Grande Guerre ». Editions Sutton. 2015.
- « Les Japy-Destinées d’une famille comtoise ». Edition CABEDITA. Mai 2017.
La vie de l’association
On retrouvera les illustrations en feuilletant la Vôge.
Dernier tour de clé au Tissage du Pont de Lepuix
- une usine ferme
- il ne se passe rien
- cinq ou dix ans passent
- des fuites apparaissent dans la toiture
- la charpente pourrit sous l’action de l’eau, la toiture s’affaisse, le mérule envahit les boiseries et le bâtiment s’effondre intérieurement.
- de rares érudits sensibles au patrimoine tirent la sonnette d’alarme auprès des élus ; on leur répond que le bâtiment se trouve dans un état trop dégradé pour être sauvé.
- l’entreprise de démolition parachève le travail.
Pierre Fluck, Les Belle fabriques. Un patrimoine pour l’Alsace. 2002
Le président fondateur de l’AHPSV, feu François Liebelin et les membres de l’association ont longtemps pensé éviter ce scénario catastrophe pour le tissage du Pont. Ils avaient à cœur que le projet de musée des Techniques voit le jour à Lepuix. Vingt années de présence de l’AHPSV dans ce lieu n’auront pas suffi à faire aboutir ce projet. L’AHPSV s’est donc retrouvée bien seule avec des machines stockées dans des bâtiments de plus en plus dégradés, de plus en plus dangereux. Il a bien fallu se résoudre à trouver une issue, et sauver ce qui pouvait l’être Évoquée à plusieurs reprises (voir La Vôge n°43 et n°44), la rupture de la convention d’occupation signée en 1994 entre le conseil général du Territoire de Belfort et l’AHPSV est effective depuis février 2017. Tel un inventaire à la Prévert, le bâtiment abritait de nombreux objets n’ayant pas forcément trait au textile. Les locaux devant être rendus vidés au Département du Territoire de Belfort, propriétaire du site, un maximum de métiers à tisser, machines-outils, objets divers ont été placés avant que l’entreprise de retraitement du métal ne les fasse disparaître sous ses pinces à broyer.
Quelques associations du secteur, des particuliers, des communes ont emporté la courroie, la barre de métal, la latte de bois et le petit matériel susceptibles d’être réutilisés. C’est ainsi qu’un grand nombre de machines-outils a été emporté à Vesoul ou est resté dans le Pays sous-vosgien auprès de certains passionnés de mécanique. Je ne doute pas qu’elles
seront bichonnées et graissées comme il se doit, afin de leur donner une deuxième vie. La motopompe Delahaye s’en est allée enrichir le fonds historique du musée du Sapeur-pompier d’Alsace à Vieux Ferrette, deux scies sont exposées à la scierie Demouge de Lepuix, un métier à tisser devient propriété de cette même commune, etc. etc.
Conférence à Auxelles-Haut
« Auxelles-Haut, un village surprenant qui a vécu longtemps par et pour l’industrie : village de mineurs germaniques au XVIe siècle, village de tisserands au XIXe siècle avant une reconversion difficile dans la petite métallurgie. Imaginez, dans les années 1850 il y a plus d’emplois industriels à Auxelles-Haut qu’à Belfort ! »
C’était le thème de la soirée organisée par l’AHPSV et le Centre culturel d’Auxelles-Haut, le vendredi 28 avril à 20h30 à la salle des Associations. L’intérêt du public était
évident puisque ce soir-là, 61 auditeurs avaient fait le déplacement dont certains venaient de loin.
Bernard Perrez a su captiver son auditoire durant un peu plus d’une heure. Tous et toutes sont repartis enchantés, après avoir dégusté une part de tarte à la rhubarbe locale et échangé autour du poêle à bois de la salle des Associations.
Cet exposé faisait partie des nombreuses animations que l’AHPSV propose tout au long de l’année.
À la découverte des pierres du Fayé
Il y a quelques années, M. Philippe Clerc, fidèle lecteur de La Vôge et grand connaisseur des forêts couvrant le massif du Fayé, au-dessus d’Etueffont, a remarqué un curieux amoncellement de pierres. D’une longueur de plus de deux cents mètres et d’une hauteur atteignant trois mètres par endroit, ce pierrier qui n’a vraiment pas l’air naturel pourrait bien être les ruines d’une muraille barrant l’éperon que constitue le Fayé. Ce constat n’est pas nouveau et le site avait d’ailleurs fait l’objet d’un article dans le bulletin de la Société belfortaine d’émulation. Averti, M. Joseph Schmauch, directeur des Archives départementales du Territoire de Belfort informa le Service régional de l’Archéologie (SRA) de Besançon. C’est ainsi que le 15 mai 2017, un groupe de dix personnes guidé par M. Clerc entreprenait l’ascension du Fayé par la face sud pour aller examiner de près le fameux tas de pierres. Outre M. Schmauch, l’expédition comptait deux ingénieures du SRA et plusieurs membres de l’A.H.P.S.V. dont la présidente, Marie-Noëlle Marline.
Le but de ce genre d’opération est d’enrichir une base de données, la « Carte archéologique nationale ». Cet inventaire est destiné bien sûr aux chercheurs mais il sert aussi à informer les aménageurs, des dispositions à prendre pour la préservation du patrimoine.
Le sentier des mines
C’est par une belle journée automnale qu’eut lieu l’une des dernières sorties de la saison 2017 organisée par la Maison départementale de l’environnement, intitulée La randonnée c’est ma nature.
L’AHPSV a répondu présente pour accompagner et guider le groupe d’adultes et d’enfants à la recherche des galeries de mines. Une vingtaine de participants, chaussés de bottes, a pénétré dans la galerie en grès du XVIe siècle et pu découvrir l’environnement de travail d’un mineur du Rosemont.
« Pignon sur rue »
Tel était le thème d’une exposition et d’une conférence qui ont eu lieu à Rougemont-le-Château les 15-16 et 18 septembre derniers. Ces animations étaient organisées conjointement par l’APPAC-VSN (Association pour la préservation du patrimoine architectural et culturel de la vallée de Saint-Nicolas) et l’AHPSV. «Pignon sur rue» était un regard porté sur les commerces d’antan à Rougemont-le-Château. L’exposition, réalisée par Michel Bossez, présentait de multiples «papiers à en-tête» des anciens commerçants et artisans du village et également de très nombreux objets-cadeaux que ces mêmes commerçants et artisans offraient à leurs clients, en fin d’année. Un diaporama de photos anciennes du village et de ses commerces fut présenté et commenté par François Sellier. Plus de 300 personnes se sont déplacées pour regarder, écouter et surtout échanger. Souvenirs, souvenirs…
Les cicatrices du terrain : ruines, murets et amoncellements
Pour rendre la montagne habitable, l’homme a été obligé de construire des maisons en pierre, de canaliser la sauvagerie des gouttes, d’aménager le terrain cultivable en terrasses et,
par conséquent, de dresser des murettes jusqu’au sommet de la colline…
Les maisons oubliées
Quand on randonne en montagne, il arrive qu’on tombe en arrêt devant une vieille maison au toit à clairevoie, aux volets désarticulés et aux rideaux en lambeaux. Le verger tout proche est le champ d’une bataille sournoise entre des arbres fruitiers vieillissants et une joyeuse cohue de bouleaux, de saules marsault et de noisetiers. On se sent alors envahi comme lui par un vague sentiment de tristesse en voyant, par la pensée, se dérouler un scénario inéluctable : l’effondrement de la charpente aux chevrons pourris, l’érosion des joints qui cimentent des pierres aux formes irrégulières et enfin l’écroulement des murs qui perdent de la hauteur à chaque saison, jusqu’à ne plus représenter que de vagues tas de pierres recouverts de mousses et de ronces.

En un demi-siècle, une belle bâtisse qui faisait la fierté de ses propriétaires et l’envie de ses voisins peut disparaître totalement du paysage pour n’être plus qu’une plate-forme aux bosses irrégulières, abritées par des arbres que personne n’a plantés. Le randonneur passera à deux mètres de la ruine sans même en soupçonner l’existence car il n’y a rien qui ressemble plus à un pierrier qu’un tas de pierres et réciproquement. Encore dix ans et le symbole « ruine » sera effacé de la carte IGN et dix ans encore pour que le souvenir-même du nom du lieu-dit soit oublié par les anciens du pays. Il ne reste plus qu’à faire venir un engin pour aplanir l’endroit et en faire une place de manœuvre ou de dépôt de grumes. Rideau.
Murs, murets…
Ils sont tellement discrets quand ils sont emmitouflés dans leur jolie couverture de mousse qu’on ne les remarque pas. Il faut avoir à les franchir pour qu’enfin on s’aperçoive de leur présence ; c’est alors qu’on maudira leurs pierres branlantes qui n’attendaient que ce moment-là pour se dérober sous nos «godasses» de montagne. Cette caillasse, dont les formes naturellement arrondies ne facilitaient pas le travail du maçon, retourne très naturellement à l’état naturel. Souvent, le mur marquait la limite entre différents territoires : fiefs, bois communaux, cantons… Plus rarement il servait de clôture pour le bétail ou d’enceinte pour un jardin. On trouve aussi de solides murs de pierre qui retiennent la terre d’un champ en terrasse abandonné à la forêt ou qui consolident des chemins à flanc de montagne ; ceux-là ont de la chance car ils servent encore, ils seront peut-être entretenus. Plus discrets sont ces murs trapus qui, dans le creux d’un ravin, ont été dressés pour dissuader le torrent de raviner les terrains cultivés adjacents ; mais il faut vraiment faire de la randonnée hors pistes forestières pour avoir l’occasion de les connaître.
Amoncellements mystérieux
L’agriculteur n’aime pas les pierres. Dans le pire des cas il en fait des miettes pour empierrer le chemin, dans le meilleur il les accumule en murets ou en tas isolés. On comprend l’intérêt du muret même si on n’en devine pas toujours l’utilité, par contre, l’amoncellement, surtout s’il dépasse quelques mètres cubes, laisse perplexe le ramasseur de champignons forestiers. Pour peu que le tas soit plus grand que lui, il y verra les restes d’une tour de guet ou le tumulus d’une tombe antique. Seule la perspective d’un tour de rein inutile le dissuade de disperser le tas de pierres pour voir ce qu’il pourrait bien y avoir en dessous.
À Rougegoutte, au-dessus du Bringard, il y a un petit val qui mousse de rayons quand le soleil le veut et qui abrite de bien curieux tumuli. Il y a là peut-être une centaine de tonnes de pierres soigneusement empilées pour une raison ignorée. En attendant que les archives ou l’archéologie nous révèlent leur origine, il a été décidé qu’ils avaient été construits par des trolls, ces êtres bizarres aux sombres pouvoirs et aux intentions mystérieuses.
Petite leçon de patois sous-vosgien
En 2014, un petit nombre d’initiés au parler local se regroupèrent à Giromagny. Après les premiers balbutiements, le groupe s’est peu à peu renforcé pour désormais fournir de nombreux textes et passer le cap symbolique des 1000 mots rassemblés en glossaire. Aujourd’hui, nous sommes donc heureux d’apporter notre savoir en publiant pour la quatrième année une histoire illustrée et un petit échantillon des mots désormais validés par le groupe. Tout cela afin de préserver le patrimoine sous-vosgien qui, comme dirait lo Dédé : «n’o pé qu’dé veye pirre » !
Venons-en à notre leçon : j’ai pensé que le vocabulaire utilisé par nos anciens pour nommer toutes sortes d’animaux serait un bon début ; nombre de ces mots circulent encore dans la Haute Savoureuse et nous sommes bien loin des termes parfois difficilement vérifiables car trop « techniques » et presque oubliés. Ainsi, les mots qui suivent rappelleront sans doute de nombreux souvenirs à nos lecteurs. Gardons cependant en tête qu’il y a des différences de langage entre les villages, ces mots sont donc les plus communément admis. Commençons notre excursion à la ferme. Ici, on peut y voir des djérênnes (poules) avec leur cô (coq). On peut y différencier les cioquouses, qui ne tiennent pas le nid, des covrosses, qui couvent. Elles font des ues (œufs) et parfois des panloffes (œufs sans coquille), et on utilise un nio (œuf factice) pour les inciter à pondre ! Plus loin se trouvent les miquis (lapins) et
les ouillottes (oies). Il y a des pôs (porcs) appelés aussi gouri, et aussi des tchivres ou cabre (chèvres). Dans le pré, il y a des vatches (vaches), des bues (bœufs) et des tchvô (chevaux). Le fermier a même des môtchottes (abeilles) dans une beusse (ruche). Au milieu de tout cela, le tchâ (chat) et le tchïn (chien) déambulent. Allons maintenant nous balader en pleine nature. On y entend déjà beaucoup d’oujè (oiseaux) comme des adiasses (pies), un bijon (buse), des corons (pigeons sauvages), ou la nuit une chiote (chouette) et un hechro (hibou). Ils cherchent à manger des cotreux (asticots) ou des cricris (grillons)… En parlant d’insectes, il y a la freumi (fourmi) dans sa freumidjire (fourmilière), le pavouro (papillon) ou encore l’origne (araignée). Et attention de ne pas se faire brôtcher (piquer) par une orgneusse (frelon), un tavè (taon) ou encore une vormeuse (guêpe) ! Un peu plus gros, il y a le denvè (orvet), le bô (crapaud) et la taussvatche (salamandre). Enfin viennent l’étiuron (écureuil), le r’na (renard), le tochon (blaireau) et le vogeat (putois). Et n’oublions pas le pochon (poisson) et la grabeusse (écrevisse) dans la rivière ! Si ce petit florilège de mots patois vous en inspire d’autres, ou si vous pensez qu’il y a des modifications à apporter à certains mots, n’hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de recueillir vos histoires orales comme écrites, vos lexiques « faits maison »… Toutes les connaissances qui pourraient améliorer le glossaire du patois sous-vosgien.
louis.marline90@gmail.com ou à l’adresse : Louis Marline, 2 rue de la Savoureuse 90200 Giromagny
Astour, i vo dit à la r’voyotte por dain ène onnée… Pôtcha vô bin !
Plus Fort que jamais !
Certains visiteurs nous interrogent : « Mais alors, il n’a servi à rien ce fort, finalement ? » La fortification (du latin fortificatio « action de fortifier ») est l’art militaire de renforcer
une position ou un lieu par des ouvrages de défense en prévision de leur éventuelle attaque. Alors oui, le fort de Giromagny n’a pas subi l’épreuve du feu lors de la Première Guerre mondiale, comme les forts de Verdun, mais est-ce une raison suffisante pour le laisser tomber dans l’oubli ? En effet, entre 1944 et 1986, le fort, propriété de l’Armée, est abandonné et subit les outrages du temps. La commune de Giromagny l’achète en 1987 et des bénévoles de l’Office du tourisme commencent les travaux. En 1990, « l’Association du fort Dorsner », alors présidée par Ralph Delaporte nait. Trois décennies plus tard, pas une ride mais des légions de visiteurs qui sont venus découvrir cet ouvrage en grès rose, sa cour centrale octogonale, sa vue imprenable sur la Trouée de Belfort… L’équipe se bat sur plusieurs fronts :
- contre la végétation. Plusieurs techniques sont adoptées : les débroussailleuses, tronçonneuses et autres machines-outils maniées sous le soleil et sous la pluie par les bénévoles ; et le troupeau de boucs, qui tondent, été comme hiver, des fossés aux dessus du fort.
- contre les conditions météorologiques et le temps, qui dégradent la pierre, de mauvaise qualité. Il faut donc protéger les murs, tailler les pierres, refaire les joints…
- pour les travaux de grande ampleur, qui nécessitent l’intervention de professionnels ou d’engins de chantier, c’est dans les recherches de financement qu’il faut se plonger, avec le soutien de la municipalité.
Mais cela ne sert à rien de dépenser autant d’énergie pour que le fort ne serve à rien. Visites sur circuit, visites guidées en journée ou de nuit à la lampe à pétrole, « Repas du poilu »
préparé dans une authentique roulante militaire, journées du patrimoine… Les bénévoles proposent différentes façons de découvrir le fort. Les enfants ne sont pas en reste : chasse aux trésors ou jeux de pistes font résonner les rires des petits dans les souterrains. L’association s’est d’ailleurs investie pour organiser une manifestation autour d’Halloween en cet automne 2017. (Évènement à suivre sur la page Facebook).
Les salles voûtées sont également idéales pour des concerts, du baroque au hip-hop, en passant par les chorales ou la musique contemporaine, ou pour accueillir des expositions. Ce lieu chargé d’histoire n’est pas réservé qu’aux passionnés. Vous voulez visiter ? Vous souhaitez vous invertir dans les travaux, les ouvertures au public ou les manifestations ? Vous cherchez un lieu atypique pour organiser un évènement ? N’hésitez pas à contacter :
L’Association du Fort Dorsner
3 rue de la Noye
90200 GIROMAGNY
06 72 56 42 70
fort.dorsner@laposte.net.
Et pour suivre les activités de l’association : www.facebook.com/fort.dorsner
Appel à témoins
Là-haut, sur la montagne qui domine le Pays sous-vosgien, il y avait autrefois plein de fermes, de marcaireries, de grangeries… Bref, des maisons qui sont maintenant oubliées. Avec leurs murs effondrés et leurs emplacements taillés dans la pente, elles ont laissé des cicatrices sur le terrain et parfois des souvenirs dans la mémoire des anciens, de ceux qui, dans leur enfance, ont été les témoins de la vie qui animaient ces constructions disparues. Lecteur de La Vôge, si vous êtes l’un de ces témoins, ou si vous en connaissez un qui se souvient encore, ou bien encore si vous avez un document quelconque (photo, carte, plan, acte notarié, article de journal, lettre, papier de famille…), aidez nous à conserver cette mémoire et à augmenter l’inventaire que l’AHPSV a commencé d’établir. Les positions d’une quarantaine de vénérables ruines ont déjà été répertoriées et ont été reportées sur une carte (fig. 1) consultable sur le site Internet de l’association.
Sauvegarder le patrimoine, c’est bien souvent en conserver simplement le souvenir, faute de mieux.
Un écrin pour La Vôge
Pour conserver dix numéros « anciens » qui étaient plus minces (du n°1 au n°32) ou six numéros « actuels » plus épais (du n° 33 au n° 45), l’AHPSV vous propose une boîte de rangement au prix de 12,50 €.
Ces écrins sont disponibles au siège de l’association. Expédition possible, se renseigner : CONTACT

Ce numéro de La Vôge vous intéresse et vous souhaitez le lire dans son intégralité ?
