
Table des matières
|
Giromagny, ville de garnison |
Jean Demenus |
2 |
|
Souvenirs de jeunesse à Auxelles-Bas |
Jean Tritter |
8 |
|
L’origine du toponyme Auxelles |
Jules-Paul Sarazin |
11 |
|
Prêtre catholique entre les deux guerres : Georges Chiron, curé de Rougemont-le-Château |
François Sellier |
13 |
|
Le parc du génie à Saint-Germain-le-Châtelet |
Bernard Groboillot |
20 |
|
La rivalité Lachapelle-sous-Rougemont – Fontaine au siècle dernier |
Yves Grisez |
24 |
|
Il y a 100 ans |
François Sellier |
29 |
|
Rodolphe Sommer (3) |
Pierre Haas |
33 |
|
MAGAZINE |
|
37 |
Souvenir de jeunesse à Auxelles-Bas
Lorsqu’à la maison, à l’école, dans la rue, nous sommes en présence de nos petits-enfants, nous ne pouvons nous empêcher de faire une comparaison entre leur mode de vie, leur comportement, leurs réactions et notre mode de vie à nous, enfants et adolescents de la période qui a suivi la Première Guerre mondiale.
Cette comparaison nous laisse rêveurs ! Sont-ils favorisés ? Sont-ils plus heureux ? Doit-on les envier ? Se rendent-ils compte des moyens matériels mis à leur disposition ? Ont-ils une idée de ce que pouvait être notre existence il y a soixante ou soixante-dix ans ? En les regardant se distraire avec des jeux compliqués, sans prix, plus souvent seuls qu’en groupe, j’essaie de me remémorer la façon dont nous pouvions occuper nos loisirs lorsque nous avions dix ou douze ans dans les années 1920. Nous n’avions que notre imagination et des moyens matériels limités pour occuper nos loisirs.
Quand j’y réfléchis, je suis étonné par la multitude de jeux que nous pouvions employer compte tenu de la saison, de la température et de la liberté – bien souvent limitée – que nous laissait nos parents. Je vais essayer d’évoquer ceux qui ont passionné mon enfance, en espérant qu’ils « rajeuniront » les gens de mon âge.
En février ! Que pouvions-nous faire lorsque le froid et la neige arrivaient ? Malgré un équipement réduit, nous ne craignions pas de braver les intempéries. Un cache-nez, un passe-montagne, un gros chandail nous protégeaient du froid. Aux pieds, nous portions des sabots, quelquefois des chaussons montants et des caoutchoucs – c’était un luxe ! En sabots nous exercions notre équilibre en glissant sur la neige tassée ou sur les pistes entretenues avec de I’eau répandue sur la terre gelée. Ce divertissement occupait les récréations à l’école.
Quand la neige avait recouvert suffisamment les prés et les chemins, nous prenions nos « trucs ». Les luges étaient rares, les skis encore plus ; je n’en ai eu que lorsque j’ai pu en fabriquer. Les « trucs » donc, ancêtres des vélos des neiges, nous ont permis des descentes vertigineuses sur les nombreuses pentes du pays. Mais les remonte-pentes n’existaient pas et il fallait à chaque fois regagner le point de départ avec le « truc » sur l’épaule. Lorsque la neige faisait défaut, il nous arrivait d’aménager nos pistes dans le bois, sur les feuilles gelées. Inutile de dire que le soir nous retrouvions nos lits avec plaisir.
Le printemps arrivant, l’eau était abondante dans les ruisseaux et les raies entretenues pour l’irrigation. A ce moment-là, nous récupérions les boîtes de cirages vides que nous mettions à l’eau, chacune marquée d’un signe distinctif, et nous allions ensuite à leur recherche dans les vergers. Elles avaient pris, au gré du courant, des directions différentes, et le vainqueur était celui qui retrouvait son bien le plus loin possible. Lorsque le soleil avait asséché nos aires de jeux nous nous retrouvions par quartier – six ou huit camarades. Les jeux étaient variés et dépendaient de nos humeurs. Si nous avions besoin de nous dépenser, nous faisions des compétitions de cerceaux. Les cercles de tonneaux ne faisant pas l’affaire, nous essayions de trouver des cercles de cuisinières qui roulaient bien et vite. Celui qui put se procurer une jante de bicyclette – c’était rare – était avantagé. Et alors, que de tours dans le village ! A une certaine époque, quelques trottinettes faisaient leur apparition. Sur les routes caillouteuses les roues de bois ne restaient pas longtemps rondes… Mais qu’importe ! les soirées devenant plus longues nous entreprenions des jeux plus conséquents :
- La bocaine, dont J.-P. Sarazin parle dans « La Vôge » n » I 1. Les maisons du quartier, les murettes, les haies, les arbres offraient d’innombrables cachettes pour celui qui « collait ».
- Le jicot, autrement dit « l’attrape ». Nous compliquions ce jeu à loisir. Celui que le sort désignait essayait de toucher un camarade qui…
(La suite dans : Souvenir de jeunesse à Auxelles-Bas, par Jean Tritter, page 8)
Giromagny, ville de garnison
Être ville de garnison était autrefois une étiquette qui ne valait pas une bien bonne renommée. Pour la majorité des Français cela désignait en général une ville de l’Est, donc froide et grise, souvent une petite ville, sans grande possibilité de distraction.
Mais pour les habitants, cela signifiait un apport de population, pour les commerçants des affaires et une animation certaine même si elle était parfois bruyante. Giromagny fut ville de
garnison pendant une trentaine d’années, de I’avant première guerre à la fin de la seconde (1939-1945).
La construction des casernes
En juillet 1913, la loi imposant trois années de service militaire succéda à la loi de deux ans de mars 1905. L’augmentation des effectifs de I’armée active nécessitait la construction de nouvelles casernes pour accueillir cet afflux de troupes. Dès avant 1913, l’autorité militaire avait prévu de construire en notre ville une caserne qui reçut plus tard le nom du maréchal
Galliéni, gouverneur militaire de Paris en 1914, décédé en 1917 et fait maréchal de France à titre posthume en 1921
Il faut dire que la municipalité avait ardemment souhaité cette implantation dans l’espoir de retombées économiques importantes. Le conseil municipal demandait un « bataillon complet et offrait comme participation aux frais le terrain, l’eau, l’autorisation d’utiliser un pâturage comme terrain de manoeuvre et une somme de quatre cent mille francs en argent ». Dans la convention passée le 6 mai 1913 avec le ministère de la Guerre, la surface totale est estimée à environ six hectares. Trois hectares appartenaient à monsieur Paul Warnod, maire à l’époque, soit une ancienne maison de maître incendiée en 1909 et non reconstruite, avec écuries, serres, vergers, parc, le tout clos de murs ; le reste à six petits propriétaires qui acceptaient de vendre leurs champs à un entrepreneur de maçonnerie, monsieur Miglierina qui possédait trente-deux ares et avait là un entrepôt de pavés. La commune se chargeait de fournir quatre-vingt-dix mètres cubes d’eau par jour, gratuitement ; elle amenait le gaz, l’électricité et le réseau d’évacuation des eaux usées jusqu’à l’entrée des casernes : ce réseau descendait alors à la rivière ; elle déplaçait à ses frais le chemin de Saint-Pierre qui traversait le terrain cédé. Et elle versait à l’Etat la somme de quatre cent mille francs, dont nous avons parlé, pour frais de construction. Le terrain était donné jusqu’à concurrence de soixante mille francs, le reste étant éventuellement à charge de l’Etat.
Pour faire face à ces dépenses, le conseil municipal du 5 juillet 1913 vote un emprunt de cinq cent six mille deux cents francs au taux de 4,10% remboursable en cinquante
ans à partir de 1914 et une imposition extraordinaire de cinquante centimes additionnels pendant cinquante ans à partir de 1914.
Il n’y a pas trace dans les archives communales des travaux qui mobilisèrent des centaines d’ouvriers logés dans des baraquements provisoires. L’ensemble comprenait dix bâtiments sans étage, de cinquante mètres environ sur douze ; plus les services : poste de commandement, corps de garde, cuisines, magasins, douches, armureries, prison… Construction de pierre, de même que les murs d’enceinte.
Dès l’achèvement des travaux, un bataillon du 42′ régiment d’infanterie de Belfort, le régiment de l’As-de-Carreau, occupe les lieux jusqu’à la déclaration de guerre en aout 1914. Durant le conflit, les casernes devinrent un hôpital militaire pour les évacués du front d’Alsace. L’unité y revint pour peu de temps en février 1919 et pour fêter ce retour, la municipalité décida d’offrir à chaque soldat un quart de vin ! Le chef de corps ayant donné son accord, le conseil vota la somme de cent quatre-vingt-onze francs pour régler la dépense.
Dès 1913, la commune fut mise dans l’obligation d’acquitter une redevance appelée « frais de casernement ». Malgré ses protestations, elle dut la payer sous la forme d’abonnement : vingt-cinq centimes par homme ; rien pour les chevaux.
L’administration militaire fit remarquer que la commune payait cette redevance sans discuter pour la compagnie du 171″ régiment d’infanterie de Belfort qui occupait au fort les casernes nouvellement construites et qu’il ne saurait y avoir deux règlements différents dans la même cité.
L’après première guerre
Après la guerre, la réduction des effectifs amène Ie gouvernement à envisager la vente de casernes, dont la nôtre. En septembre 1920, la municipalité émit un voeu dans ce sens, espérant attirer des industries sur le site et se libérer de charges financières très lourdes. Le gouvernement se ravisa, car en 1921 le 53e bataillon de chasseurs mitrailleurs indochinois vint en garnison. Ces soldats d’Extrême-Orient, habitués à d’autres climats, n’étaient pas très à l’aise dans nos frimas. En novembre 1923, le chef de bataillon Guillot demanda à la municipalité une subvention de trois cents francs pour acheter des instruments et créer une musique indigène. Le conseil agréa la demande et vota l’année suivante une somme de deux cents francs en remerciement de la belle fête donnée par le bataillon. Ces soldats fabriquaient des lampions et des lanternes en papier crépon et avaient construit un dragon articulé qui libérait des crottes en chocolat lors de la fête nocturne de l’été. Pour améliorer l’ordinaire, ils s’achetaient des miches de pain et des choux dont ils faisaient des salades. Chez les commerçants ils ne donnaient pas leurs noms, tous semblables pour des Européens, mais leurs numéros matricules. Le jour du prêt il venait scrupuleusement payer leurs dettes. Cette unité est encore présente en septembre 1927, mais il est probable que des éléments et des cadres aient participé à la campagne du Rif (1924-1926).

Le 35″ régiment d’infanterie de 1929 à 1939
Le 3 mai 1929, la ville reçut le 2e bataillon du 35e régiment d’infanterie, le régiment de l’As-de-Trèfle, dont deux bataillons tenaient garnison à Belfort (il devint le 3e bataillon en 1933). Le maire et le conseil municipal accueillirent les troupes au carrefour du faubourg de Belfort et de l’avenue de la Gare. Le colonel Serdet présente au maire, monsieur Lardier, le chef de bataillon, le capitaine adjudant-major et les commandants de compagnies qui avaient quitté leur monture ; puis le bataillon défila sous les applaudissements de la population. Le conseil
avait voté la somme de quinze mille francs pour offrir un quart de vin à la troupe, un vin d’honneur aux officiers et une réception le jour suivant aux sous-officiers. Les troupes qui arrivaient en tenue bleu horizon nous quittèrent, dix ans plus tard, en tenue kaki. Les effectifs étaient d’environ cinq cents hommes ; le bataillon fournit des cadres lors de la création du 171e régiment d’infanterie à Mulhouse. Les recrues étaient originaires des départements limitrophes pour le plus grand nombre. L’unité s’articulait entre quatre compagnies, trois de voltigeurs et une de mitrailleuses. Les chefs de bataillon successifs furent les commandants Lominet, Puccinelli (qui termina sa carrière au grade de général), Vaillant et Voeckel avec lequel le bataillon fit la guerre jusqu’à la captivité du plus grand nombre le 11 juin 1940 à Machault, à vingt-cinq kilomètres au sud-est de Rethel.
La vie de garnison
Les officiers et sous-officiers se trouvaient des logements à Giromagny, avec le confort et l’inconfort de cette période. Le mess des officiers célibataires ou réservistes était à l’hôtel du Soleil. Les officiers avaient droit à une ordonnance à journée entière pour ceux qui étaient mariés et une demi-journée pour les célibataires. Il y avait un peu moins de vingt officiers, du
sous-lieutenant au commandant et environ le double de sous-officiers, chiffre variable avec la présence de cadres de réserve pendant leur service ou des périodes.
La vie de la commune était en partie rythmée par les sonneries réglementaires, les déplacements des sections ou compagnies allant ou revenant de l’exercice. Le vendredi était le jour de la marche hebdomadaire. Dès quatre heures en été et discrètement à cette heure matinale, dès midi en hiver, le bataillon quittait la caserne pour une marche dans les environs,
entraîné par la clique jouant le refrain du régiment :
(La suite dans : Giromagny, ville de garnison, par Jean Demenus, page 8)
L’origine du toponyme Auxelles
D’un article paru dans le n°4 de La Vôge, il ressort que l’origine du nom d’Auxelles doit, à peu près certainement, être recherchée dans les termes latins adcelles au pluriel ou adcellem au singulier, Par contre, dans l’interprétation à donner à ces termes, l’article en question se borne à émettre des suppositions dont aucune n’est entièrement satisfaisante.

Le champ reste donc ouvert pour une étude qui, partant des premières formes attestées du nom, s’imposera d’être aussi rigoureuse qu’il soit possible en matière d’étymologie.
Les premières formes connues du nom sont, dans les chartes monastiques :
- acella (1130, 1135, 1150, 1209, 1214, 1220, 1222).
- acelllis (1135).
- aucellis (1227, 1250).
- ascella (1156, 1205).
- aucella (1221, 1302).
Il faut d’abord éliminer absolument acellis et aucellis, formes purement « savantes » donc sans valeur étymologique. Elles sont le fait de clercs trop férus de latin qui, pour traduire « originaire d Auxelles » se sont souvenus que la particule latine de était suivie de I’ablatif. Il ont donc donné à I’accusatif pluriel acellas une forme d’ablatif pluriel d’où de acellis.
D’autre part, le fait que les premières formes populaires du nom se terminent par la lettre « a », et ce durant deux siècles. exclut totalement l’hypothèse émise selon laquelle Auxelles pourrait venir du mot celle. Ce terme, en effet s’était déjà affranchi du latin et menait une existence propre dès le haut Moyen Age. Il aurait donné acelle et non acella. D’ailleurs ce terme était employé dans un sens très particulier :
- celle était le lopin, le petit domaine où vivait un serf sous la tutelle du seigneur.
- un enfant en celle était un enfant sous tutelle.
- en tutelle aussi ces celles, petites succursales de monastère à usage de chapelles, d’ermitages, de lazarets qui restaient sous le contrôle de leur maison mère.
La terminaison primitive « a » implique donc qu’il faille remonter au latin cella pour expliquer le sens de ad cellas. Or le mot cella, au sens noble, désignait la petite pièce totalement obscure située au coeur des temples romains où était censée se manifester la divinité (c’est le naos des temples grecs et égyptiens). Dans les grandes maisons c’était le réduit obscur attenant à la chambre où se rangeaient, après usage, les bassins ayant servis à la toilette. On y remisait également la chaise percée. Un valet pouvait y dormir si le service des maîtres l’exigeait. Dans toutes les maisons c’était le cellier, la cave où se conservaient les denrées alimentaires et le vin. C’était aussi les trous dans les rayons des ruches destinés à recevoir le couvain et le miel. Enfin, à proximité de Sétif en Algérie, se trouvait une ville, assez importante pour avoir été le siège d’un évêché qui, dans les premiers siècles de notre ère, s’appelait CeIlae ou CeIlae Nigrae (caves noires). Les habitants de cette ville, comme encore de nos jours à Matmata en Tunisie, vivaient dans des alvéoles creusées artificiellement dans le rocher.
Alors, lieu obscur, cave, excavation, alvéoles creusées artificiellement ? Pourquoi ne pas donner ici à cella le sens de « galerie de mines » ? Ad cellas signifierait donc tout simplement « près des mines », ce qui…
(La suite dans : L’origine du toponyme Auxelles, par Jules-Paul Sarazin, page 11)
Prêtre catholique entre les deux guerres : Georges Chiron, curé de Rougemont-le-Château
« À quand donc le réveil de toutes les énergies françaises ? C’est un prêtre qui aime passionnément son pays, qui se pose cette question vraiment angoissante…
En attendant le réveil de notre vitalité française, je continuerai de lire, d’observer, d’écouter et de mettre en garde et mes paroissiens et mes lecteurs… »
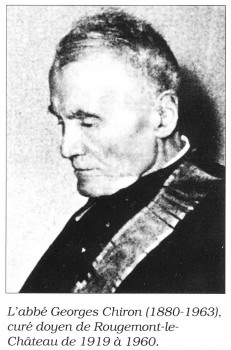
Georges Chiron est nommé curé de Rougemont-le-Château en 1919 et le restera jusqu’en 1960. Très cultivé, bel homme, le verbe haut, il devient rapidement le personnage incontournable de la cité. Aussi tranchant en chaire que dans ses écrits, admiré par les uns, détesté par les autres, craint par la plupart, l’homme a marqué de son empreinte la vie de la paroisse, de la commune et des environs.
Nombreux encore sont ceux qui l’ont connu et qui se souviennent. Il n’est nullement dans notre intention de prendre parti, de froisser les consciences, de tenir des souvenirs ou de raviver des passions. Conformément à l’esprit de « La Vôge », c’est dans un but purement historique que nous publions cet article. Comme dit le vieil adage : les mots passent les écrits restent. Aussi est-ce à partir des écrits de l’intéressé – et d’eux seuls – parus dans le bulletin paroissial de Rougemont-le-Châtteau, que nous essaierons de montrer l’engagement permanent de ce curé de campagne dans la vie religieuse, politique et sociale du moment.
Étant donné l’abondance de documents à notre disposition, la politique française et les élections, les affaires internationales, les événements de février 1934, l’avènement du Front populaire et les prémices de la Seconde Guerre mondiale feront l’objet d’un prochain article. Avant tout, il convient de regarder l’état de l’Eglise catholique dans cette période de I’entre-deux-guerres.
Au lendemain du premier conflit mondial, la paix reste précaire et laisse subsister bien des haines. Dès 1921, le pape Benoît XV s’inquiète de ce que la signature de la paix n’ait pas été accompagnée de la paix des âmes. D’un même ton pessimiste, Pie 11 (1922-1939) affirme qu’une paix solide ne peut reposer que sur l’Eglise.
L’Eglise n’est plus maîtresse de la paix et de la guerre. Elle se trouve dans un grand désarroi ; désarroi exacerbé par un monde de plus en plus laïcisé. L’appétit de.jouissance de la vie, l’abandon progressif des valeurs traditionnelles d’ordre et de soumission, l’émancipation du peuple, la montée de Ia contestation sociale, l’attrait du communisme naissant, lui font perdre son emprise sur la société ainsi que son autorité morale, sociale et politique.
Impuissante mais non résignée, l’Eglise – tout en constatant les dégâts – ne peut que donner des avertissements, inviter à la prière. Bref, elle veut remettre dans le « droit chemin ».
Parallèlement à cette tentative presque désespérée de récupération des âmes, vont se développer les mouvements d’action catholique entraînant la promotion d’hommes d’un type nouveau. Issus du monde paysan ou des classes moyennes, voire du monde ouvrier. ces militants catholiques d’un genre nouveau, vont prendre peu à peu de l’ascendant sur le clergé et les notables. Le catholicisme social est né, jetant un peu plus le trouble dans la conscience de certains prêtres séculiers, tel le père Chiron qui, dans son bulletin paroissial, tentera systématiquement de combattre les idées nouvelles qui pourraient éloigner d’une Eglise de type médiéval, c’est-à-dire triomphaliste et seule à détenir la vérité…
Dans le premier numéro du bulletin paroissial paru en avril 1922, Georges Chiron « annonce la couleur » de ses futurs éditoriaux : Il nous donnera toutes les indications utiles concernant le catéchisme, les oeuvres de persévérance chrétienne pour les jeunes gens et les jeunes filles. Il vous mettra en garde contre tout ce qui pourrait altérer l’intégrité de votre foi, ternir la » pureté de vos moeurs. Il vous instruira, il vous édifiera, il vous rappellera vos devoirs de chrétiens et vos devoirs d’Etat, et il remplira cette tâche délicate, sans aigreur, sans amertume, avec le seul souci de faire un peu de bien à vos âmes.
Va, petit Bulletin, où le Bon Dieu t’appelle (…) c’est pour Dieu, c’est pour les âmes que tu travailles. Dieu te bénira et par toi le Bien se fera.
Fiat !
Allons, nous aussi, avec ce petit bulletin à travers les chapitres de I’entre-deux-guerres au quotidien.
La vie religieuse
Pour l’Eglise, seule la religion peut agir sur les coeurs et leur donner un sens élevé de l’honnêteté, sur les esprits pour les éclairer sur leurs devoirs, sur les consciences pour les persuader, les encourager et les fortifier. Dans cette perspective, la pratique religieuse est indispensable. Le pasteur veille sur les brebis égarées.
– À propos du repos du dimanche : Est-il raisonnable, est-il chrétien, et n’est-ce pas attirer sur sa tête la juste colère divine, que prendre par exemple, la faux le dimanche ? Sarcler son jardin, scier ou fendre du bois ? Jour de repos, Le dimanche ? Allons donc… Beaucoup de gens n’ont pas trop aujourd’hui des six autres jours de la semaine pour se remettre des terribles fatigues du dimanche ! (1929).
– À propos des offices : Il est bon de rappeler que si les Vêpres ne sont pas rigoureusement obligatoires comme la messe, du moins l’assistance à cet office est fortement recommandée et les fidèles qui, de parti pris et d’une façon habituelle ne viendraient pas aux Vêpres se rendraient coupables d’une faute grave d’indifférence vis-à-vis des exhortations. des conseils de La Sainte Eglise (août 1922). Cet avertissement s’adresse aux adultes.
Pour les enfants aucune concession n’est possible : Les offices du dimanche sont strictement obligatoires pour tous. L’appel sera fait après chaque office et les absences notées et envoyées aux parents. Des sanctions très sévères seront prises contre les paresseux et les désobéissants (octobre 1929).
Parallèlement à ces rappels à l’ordre. le curé sait aussi motiver ses « troupes ». Les encouragements, faisant souvent appel à de simples statistiques, montrent que les Rougemontois sont en majorité de bons catholiques et soulignent leur performance religieuse !
– À propos de la participation au culte : Le dimanche de Pâques (1929) le Glorieux Ressuscité voyait venir à lui tous ses adorateurs : j’ai compté 108 et 127 hommes et grands jeunes gens dans les tribunes latérales, 22 dans les tribunes de chantres et une bonne soixantaine groupés au fond de l’église et je ne compte pas les hommes assis dans les bancs. Ce sont là des chiffres très consolants et qui nous permettent de conserver un jugement favorable sur Ia mentalité religieuse de la paroisse. On notera au passage que seuls les hommes sont comptabilisés, la présence des femmes – dans les bancs ! – étant par habitude très nombreuse.
D’autres chiffres sont tout aussi louables : 12 000 communions en 1933 et probablement 14 000 en 1935 (…) Ia communion ne s’imposant et de plus en plus qu’aux âmes d’élite…
– À propos du denier du clergé : faisant régulièrement allusion à une des tares, une des taches et sûrement la plus nuisible aux intérêts du Pays, la loi de Séparation qui a dépouillé l’Eglise de France de ses biens et qui a spolié les prêtres de leur traitement i’encouragement à verser le denier du clergé et surtout à faire mieux chaque année est lui aussi basé sur la performance.
Ainsi, en 1928, apprend-on que la paroisse de Rougemont, en versant 11000 francs, occupe le 33° rang sur 881 paroisses que comprend le diocèse ! Mieux, elle est 6° en ce qui concerne la somme versée aux oeuvres diocésaines. Plus fort encore, elle se classe 3° proportionnellement au chiffre de sa population derrière la sainte paroisse des Ecorces et la vaillante paroisse de Charquemont. Ainsi Rougemont doit-il conserver dans le diocèse sa place de choix… Quelle belle couronne vous vous assurerez là-Haut en persévérant ainsi dans votre générosité ! Persévérance réelle qui permet à la paroisse d’occuper le 27° rang en 1934 (ne pas progresser c’est reculer).
Mais gare à ceux qui ne donnent pas, comme en 1931 : Un blâme très énergique à l’adresse de trois familles de la paroisse, qui ont refusé, comme l’année dernière du reste, la cotisation annuelle. Dans une paroisse comme celle-ci, ce geste est un geste scandaleux. Il signifie, dans son odieuse brutalité, qu’on souhaite ardemment la disparition du prêtre, sa mort sans phase, en lui coupant brusquement et brutalement les vivres.
Ces gens là grincent des dents quand ils savent que du haut de la chaire, Monsieur le Curé parle en termes élogieux de la mentalité chrétienne de ses paroissiens (…) quand il déclare que Rougemont restera toujours la citadelle avancée du Catholicisme.
(…) Mais je me permets de dire à ces familles qu’on ne badine pas ainsi avec le Bon Dieu. Dieu aura toujours le dernier mot ! Dieu les attend à son tribunal suprême ! Il n’a pas seulement Ie temps, il a l’ Eternité pour Lui !
Cependant, si aux dires de leur curé, les paroissiens rougemontois demeurent aux premières places de la générosité, peut-être pourraient-ils faire mieux encore : je prie mes paroissiens de croire que si le Curé de Rougemont n’avait pas quelques petites ressources personnelles, il serait dans l’impossibilité absolue de tenir le rang (modeste pourtant)
qu’il doit tenir. Alors que mes confrères du voisinage peuvent avoir une auto, grâce à certaines libéralités de leurs paroissiens, le Curé de Rougemont se voit dans l’impossibilité de faire comme eux pour la bonne et simple raison que ses paroissiens, par leurs libéralités, ne le permettent absolument pas (juillet 1934). Et le curé Chiron n’eut jamais d’auto… (cqfd).
– À propos des vocations : La notoriété d’une paroisse se manifeste aussi par le nombre de vocations religieuses qu’elle offre à Dieu : Une paroisse qui ne compte pas plus de
1900 habitants, donner à l’Eglise de Dieu, depuis 1928, 7 prêtres et 4 religieuses, fournir au diocèse pour ses oeuvres en 1935 : 12500 francs pour le denier du clergé et 4000 francs
pour les séminaires… une paroisse si riche de tant de bonne volonté mérite d’être citée à l’ordre du jour ! (février 1936).
Nul doute que tant de performances religieuses font également le renom du curé de la paroisse. Ne flattent-elles pas aussi un peu sa vanité ?
L’éducation de la jeunesse
La reconquête religieuse au lendemain du premier conflit mondial passe aussi par le souci de préserver la jeunesse populaire des influences délétères du moment, de la rue, de l’usine ou encore de l’école laïque… Georges Chiron est particulièrement attentif à l’éducation de la jeunesse :
– S’adressant aux parents: Eduquer vos enfants. Eduquer du Latin « educere » signifie sortir l’enfant, le tirer du péché originel dans lequel il est enseveli par sa nature, l’arracher aux ténèbres, aux servitudes, aux passions de sa nature déchue… Elle (l’éducation) est bien l’oeuvre de Dieu, et c’est dire assez que sans religion, sans catéchisme, sans assistance aux offices, il n’y a pas d’ éducation possible (novembre 1922). Nous ne saurions recommander assez aux parents d’exercer la plus active vigilance sur les enfants pendant le temps des vacances, temps pendant lequel, ils sont trop souvent livrés à eux-mêmes (août 1922).
– S’adressant aux enfants : Durant le temps des vacances, que les enfants n’oublient pas de venir à la messe à 7h30 surtout à la messe du jeudi qui est suivie du catéchisme de persévérance (août 1922). Ou encore : Petits garçons et petites filles voudront bien se soumettre au règlement de vacances qui leur sera proposé. Qui dit vacances ne dit pas
forcément torpeur et paresse… Si les enfants continuent de nous montrer docilité et piété, les vacances 1935 seront plus saines et des plus réconfortantes (août 1935).
On aura compris qu’il n’y a pas de vacances pour la piété…
– S’adressant aux jeunes : l’ennemi (le mauvais camarade, le mauvais journal, le rendez-vous suspect) rôde sans cesse autour de vous. Alors du cran et encore du cran ! (février 1933).
Vous êtes destinés à prendre en mains les leviers de commande : la Bonne Presse. l’Union des Catholiques, le Cercle, les diverses propagandes pour le Bien, pour les intérêts supérieurs de la patrie (…) apprenez à travailler, à vous dépenser, à vous dévouer, à souffrir s’il le faut (février 1933).
L’exhortation aux jeunes zélateurs revient très souvent dans les propos de ce curé meneur d’hommes et grand défenseur de l’action catholique traditionnelle.
La vie quotidienne
La directive morale du curé ne saurait se cantonner à la pratique…
(La suite dans : Prêtre catholique entre les deux guerres : Georges Chiron, curé de Rougemont-le-Château, par François Sellier, page 13)
Le parc du génie à Saint-Germain-le-Châtelet
Au début des années trente, Ies autorités militaires de la 7e région avaient décidé de constituer une réserve de matériels pour éventuellement renforcer les fortifications déjà existantes en Alsace, en bordure du Rhin.
Plusieurs parcs avaient été créés dans notre région pour stocker ce matériel. Il y en avait un à Belfort, avenue du Champ-de-Mars, un à Héricourt, un au bois d’Oye et un à Saint-Germain-le-Châtelet. Appelés parcs mobiles de fortifications, ils dépendaient de la chefferie de Besançon avec un surveillant comptable à Belfort. En juillet 1931, le chef de bataillon Geny de la chefferie du génie se met en rapport avec le maire de Saint-Germain en vue de l’acquisition des terrains communaux nécessaires à l’implantation du parc. Il s’agit de la parcelle de pré cadastrée B n° 621 au Chénoy, située à l’entrée sud du village, entre le chemin départemental 25 et le chemin communal du Chaux-Four – aujourd’hui le parc de l’équipement.

La construction
Sur ces deux hectares de terrain, ancien camp d’aviation de 1918, des entreprises de travaux publics ont fait d’importants travaux de drainage, d’empierrement et de maçonnerie pour permettre aux équipes spécialisées de monter vingt-quatre halls jumelés en douze bâtiments. Chacun de ces bâtiments mesure trente-deux mètres de large. Ils sont composés d’une armature métallique posée sur des murets et habillée avec des tôles ondulées galvanisées. Chaque hall comporte une allée centrale avec des aires de stockage de chaque côté, et deux grandes portes coulissantes à chaque extrémité pour permettre aux camions de circuler à l’intérieur des bâtiments. Il y a encore deux exemplaires de ces hangars situés avenue du Champ-de-Mars à Belfort. Pour déposer, mais aussi pour éventuellement emmener rapidement le matériel, les camions ont accès au parc par trois portes depuis le chemin départemental 25 et une porte à l’est par le chemin communal.
PIan de situation du parc à L’entrée de Saint-Germain
Au fond, côté Chaux-Four, à l’écart des habitations, il y a l’abri pour entreposer les explosifs. C’est un solide bâtiment voûté et recouvert d’une épaisse couche de terre. Une clôture grillagée de trois mètres de haut et les portes verrouillées mettent cet établissement à l’abri des curieux et des voleurs.
Le pavillon pour le logement du gardien a été construit au sud et à l’extérieur. C’est à présent le n » 37 de la rue Principale. Dans cette maison. une pièce est réservée pour l’administration, bureau et téléphone. Au sous-sol un local est prévu pour loger la motopompe de lutte contre le feu. Dans ce but, les eaux pluviales sont récupérées et amenées par un système de filtres dans trois citernes en béton situées côté Chaux-Four. Cette grosse réserve d’eau pourrait, si nécessaire, être utilisée contre un incendie par la puissante motopompe maintenue en bon état par des exercices mensuels de prévention. Le gardien qui habite le pavillon doit assurer une surveillance constante de cet établissement militaire. Il réceptionne le matériel et en assure l’agencement. Par la suite, deux ouvriers ont été embauchés. Ces trois personnes sont donc chargées de l’entretien, du rangement et de la bonne tenue du parc, compte tenu des exigences des officiers dont les visites sont fréquentes.
Le matériel
En 1934, le montage des bâtiments est terminé et, tout de suite, le matériel arrive, principalement de la gare de Belfort, mais aussi directement des usines de production. Tous les jours, les camions se succèdent et déversent leur chargement. Des équipes d’ouvriers venus de Belfort, principalement des Polonais, sont chargés du triage et du rangement à l’intérieur suivant les indications du gardien responsable.
On emploie également quelques personnes du village. Pour faciliter leur tâche, on a installé tout un réseau de voies de soixante sur lequel circulent des wagonnets. Dans le premier bâtiment, proche du pavillon, on a rangé l’outillage nécessaire au montage et à la pose des réseaux de fortification. Il y a des pelles, des pics, des masses pour enfoncer les piquets, des outils de charpentiers, des scies, haches, marteaux, pinces, cisailles et des tonnes de pointes de toutes les dimensions.
Dans le deuxième hangar sont entreposés les rouleaux de toile pour camouflage et les rouleaux de gazon artificiel – ce sont des brins de raphia vert montés sur du grillage. Dans d’autres halls, on a empilé les piquets en bois d’acacia, des piquets métalliques, des milliers de bobines de fil de fer barbelé, des milliers de rouleaux de fil de fer lisse et des chevaux de frise. Tout ce matériel devait servir pour la construction des lignes de défense. Pour faire des abris ou pour renforcer des tranchées, il y a un stock important de bois de mines. Ce sont des madriers en chêne ou en acacia utilisés dans les mines pour étayer les galeries.
D’autres bâtiments renferment le matériel lourd comme les tôles ondulées droites ou cintrées en demi-éléments ou en quart d’éléments pour la construction des abris, et aussi les guérites. Ces cellules fortement blindées peuvent recevoir une sentinelle. Dans le blindage, une petite ouverture est prévue pour le tireur ou l’observateur. Fixes ou à tourelles, ces guérites seront utilisées pour la garde des points stratégiques, ponts…
A l’énumération de tout ce matériel, il faut bien convenir qu’en France nous étions en retard d’une…
(La suite dans : Le parc du génie à Saint-Germain-le-Châtelet, par Bernard Groboillot, page 20)
La rivalité Lachapelle-sous-Rougemont – Fontaine au siècle dernier
Les élections cantonales, qui se sont déroulées les 20 et 27 mars derniers, sont l’occasion de rappeler que Ie chef-Iieu du canton, généralement la commune qui possède le nombre d’habitants le plus important, a eu depuis qu’a été créée sous la Révolution cette circonscription administrative, un rôle d’animation de la vie locale. C’est ainsi qu’au chef-lieu de canton se trouve généralement le siège d’une brigade de gendarmerie ou d’autres services de I’Etat.
Il nous paraît intéressant d’évoquer ici une page fort peu connue de l’histoire locale du début du siècle dernier. La commune de Lachapelle-sous-Rougemont, qui appartenait alors au canton de Fontaine, eut Ia prétention de devenir chef-Iieu de canton, en lieu et place de Fontaine. Cette affaire, qui remonta jusqu’au ministre de l’Intérieur fit alors couler beaucoup d’encre et ne resta pas sans suites.
Les motivations de la commune de Lachapelle

À cette époque, celle-ci pouvait faire valoir à l’appui de ses prétentions un certain nombre d’arguments :
- une situation géographique privilégiée par rapport au village de Fontaine. Lachapelle était située sur une « route de poste » importante, la route royale de Strasbourg à Lyon,
- une prospérité incontestable attestée par le montant des contributions directes et des revenus communaux ordinaires. C’est ainsi que pour l’année 1850 la commune de Lachapelle se situe en tête des vingt-neuf communes du canton de Fontaine, à la fois pour les contributions directes – soit 6616 francs – et pour les revenus ordinaires – soit 7470 francs,
- un renom dépassant largement les limites du canton, dut à l’installation d’un « petit séminaire » dont le duc d’Angoulème a posé la première pierre en novembre 1818,
- une croissance démographique importante : en 1805, le village de Lachapelle comptait 290 habitants, dont 140 pensionnaires du « petit séminaire »,
- l’éclosion d’un commerce qui deviendra peu à peu florissant : à l’existence d’un marché hebdomadaire fréquenté et de nombreux artisans et commerçants, il faut ajouter celle de trois hôtels-restaurants, dont le fameux « Canon d’Or », d’un moulin, d’une scierie, d’une fabrique de bière…
- plusieurs services publics se trouvaient à Lachapelle : un bureau de poste, une brigade de gendarmerie, un juge de paix, une perception…
- animée par les notables du lieu : les familles Jeantet, Grisez, Noblat, le notaire Jean-Baptiste Wermelinger, le docteur Louis Hadel, le vétérinaire Froidevaux…, et favorisée par l’existence du « petit séminaire » une certaine vie intellectuelle se développait alors à Lachapelle. Sans doute, les Chapelons se souvenaient-ils que le village avait été, en 1815, le chef-lieu temporaire du canton… et comment n’auraient-ils pas eu conscience d’avoir été particulièrement honorés par le choix qu’avaient opéré les pouvoirs publics pour l’installation du « petit séminaire » alors que plusieurs autres localités de l’arrondissement de Belfort avaient été pressenties ?
Toujours est-il qu’en 1835, la commune de Lachapelle-sous-Rougemont adressa au ministère de I’lntérieur une pétition, avec l’objectif de devenir le chef-lieu du canton.
Compte tenu de son originalité nous reproduisons, ci-après, l’intégralité de ce texte.
La pétition
Monsieur Le Ministre de l’Intérieur,
Les soussignés, maire, adjoint, membres du Conseil Municipal et notables habitants de la commune de Lachapelle-sous-Rougemont ont l’honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien présenter à Sa Majesté leur respectueuse demande, tendant à transférer dans leur Commune le chef-lieu du canton.
Leur demande repose sur les motifs suivants :
- Le canton de Fontaine se compose de vingt-neuf petites communes agricoles, dont le chef-lieu est à peu près au centre ce qui, à l’époque de la création des cantons, était le seul motif qui lui avait valu la préférence sur les autres communes.
- De ces vingt-neuf communes, une seule a su tripler sa population qui, d’après le recensement, s’élève à huit cents âmes, et cette commune est celle de Lachapelle. Toutes les autres ont de trois cents à quatre cents habitants, et le chef-lieu à trois cent quarante et une âmes.
- Ce chef-lieu est situé au milieu des terres. Les chemins vicinaux qui sont les seuls qui y conduisent de tous les points du canton, sont pour ainsi dire impraticables pendant six mois de L’année, et presque tous les ans, lors de la crue des eaux, Fontaine est inaccessible pendant plusieurs jours. Lachapelle, au contraire, est traversée par la route royale
de Strasbourg à Lyon et une quinzaine de communes, qui bordent cette route à de petites distances, y arrivent aisément en toute saison. - Le juge de paix s’est vu dans La nécessité de résider à Lachapelle, parce que sa correspondance avec le Parquet de Belfort éprouvait trop de retard. La commune de Fontaine ne recevant ses dépêches que tous les deux jours par un messager piéton ; tandis qu’à Lachapelle, iI existe un bureau de poste, ce qui procure des rapports journaliers avec Le chef-lieu de l’arrondissement.
- A l’avantage d’un bureau de poste vient se joindre celui d’une brigade de gendarmerie et d’une poste de chevaux.
- Il n’ existe qu’un marché hebdomadaire dans tout le canton, et ce marché se tient à Lachapelle. II est alimenté par quinze communes et suffit à peine aux besoins des habitants et d’un collège qui a cent cinquante pensionnaires.
- Fontaine n’offre aucune ressource commerciale. Ses habitants sont forcés de s’approvisionner à Belfort. Il est impossible à un étranger d’y pernocter (passer Ia nuit), attendu qu’il n’y existe que deux mauvais cabarets, dans lesquels on ne peut convenablement loger et nourrir ni hommes. ni chevaux. Lachapelle a douze auberges, dont plusieurs sont convenablement garnies, des marchands et des ouvriers de tout genre. Il s’y fait en un mot, plus de commerce que dans tout le reste du canton. Elle vient de faire l’acquisition d’une superbe maison communale dans laquelle iI y a une vaste salle au premier étage, dont le rez-de-chaussée servira de maison de transfèrement et de corps de garde. Une société de quelques habitants notables s’est engagée à construire une halle au blé qui sera achevée dans le courant du mois de juin prochain.
- Non seulement l’autorité ecclésiastique a senti la nécessité de transférer ici Ia cure cantonale, mais l’autorité administrative a été forcée d’en faire de même, en y plaçant le chef-lieu de canton dans des moments dangereux, et où il fallait faire des sacrifices pécuniaires, tels que pendant les deux invasions. Journellement encore, Lachapelle supporte des charges inconnues aux autres communes, entre autres le logement militaire.
Cet exposé suffira sans doute pour prouver que Ia commune de Lachappelle est la plus peuplée, la plus riche, Ia plus commerçante du canton et celle qui lui offre le plus d’avantages pour sa position topographique. Il justifie la préférence qu’elle sollicite sur Fontaine, qui n’a pour elle qu’une possession nullement méritée et qui doit céder à un intérêt général et bien prouvé.
– Les soussignés sont, avec un profond respect, Monsieur Le Ministre, de Votre Excellence les très humbles et très obéissants serviteurs (suivent vingt signatures).
L’échec
C’est le 29 janvier 1836 que le sous-préfet de Belfort, sur I’ordre du ministre de l’Intérieur, fit parvenir aux maires des communes intéressées une circulaire les priant d’examiner. en séance extraordinaire de leurs conseils municipaux. la demande de Lachapelle.
Le 4 mars, la totalité des conseils municipaux avait délibéré. Vingt-deux communes rejetaient le transfert à Lachapelle-sous-Rougemont du chef-lieu de canton. Cinq communes le demandaient : Angeot, Bretten, Bethonvilliers, Denney et Felon. Quant à la commune de Lachapelle, elle prie Son Excellence de la dispenser d’émettre son opinion dans une alfaire où elle aurait un avantage aussi évident.
La réponse de Fontaine est intéressante et constitue une réfutation méthodique des motifs allégués par la commune de Lachapelle dans son insidieuse demande adressée au Roi, notamment par les arguments suivants:
– C’est déjà avec de pareils mensonges que Lachapelle a enlevé à Phaffans et à Fontaine la cure cantonale ; il serait à désirer pour la religion même que toute cette affaire fut exposée au Roi.
– Le juge de paix a quitté Fontaine pour aller habiter L’hôtel du Canon d’Or à Lachapelle, grand et superbe bâtiment. Si ce juge avait compris ses devoirs iI aurait sacrifié les plaisirs et sa commodité pour l’intérêt de nos malheureux campagnards (et serait resté à Fontaine).
– Répondant à Lachapelle qui lui reproche de n’avoir que deux mauvais cabarets alors qu’il y en a douze à Lachapelle, Fontaine répond quelle modestie ! Il en existe vingt, sans compter les débits clandestins ! Fontaine n’oublie pas le fameux repas donné en 1817 aux autorités du Département par la commune de Lachapelle et aux frais duquel, bien qu’invitée, elle dut participer :
La quote-part de Fontaine a été de 250 francs, y compris les couverts d’argent perdus !
Nombre de communes, parmi les vingt-deux qui refusèrent le transfert, emploient, dans leur réponse, des termes violents à l’égard de Lachapelle et de ses habitants. On accuse Lachapelle de « mégalomanie » (Frais), « d’égoïsme » et de « calcul sordide d’intérêts » (Montreux-Château), « d’orgueil déplacé » (Saint-Cosme). La commune de Chavannes se déclare prête à consentir à l’expulsion de Lachapelle du canton de Fontaine, car si Lachapelle obtenait le chef-lieu de canton, qui sait si elle ne tendrait pas par la suite au chef-lieu de la sous-préfecture ?
On doit faire observer que presque toutes les communes invoquent pour le maintien de Fontaine comme chef-lieu de canton. la situation géographique de ce village, au centre du canton. En effet, à cette époque, les communes de Rougemont-le-Château, Leval, Petitefontaine et Romagny- sous-Rougemont faisaient encore partie du canton de Masevaux, dont elles ne furent détachées que lors de l’annexion de I’Alsace par I’Allemagne en 1871.
C’est donc l’échec.
Le conseil municipal de Lachapelle ne se tient pas pour battu pour autant. Il élabore à l’intention du ministre une seconde missive ainsi rédigée : Les communes du canton ne basent leur opinion sur aucun motif plausible. Les opposants nous paraissent évidemment dans L’erreur, quand ils établissent en principe que tout chef-lieu de canton doit être au centre. On a toujours donné la préférence aux communes les plus peuplées et qui offrent le plus de ressources et Lachapelle se trouve incontestablement dans cette catégorie. La commune de Fontaine n’a pour elle que la possession. Cette possession ne donne pas droit à la maintenir, quand la préférence n’est justifiée par rien et qu’elle est un véritable contre sens… Les délibérations des communes ne prouvent que trop qu’elles ont été dictées par la passion et la jalousie de quelques hommes. Peine perdue ! L’affaire était manquée, au moins provisoirement.
Un rebondissement inattendu
Après la guerre de 1870 et la signature le 10 mai 1871 du traité de Francfort…
(La suite dans : La rivalité Lachapelle-sous-Rougemont – Fontaine au siècle dernier, par Yves Grisez, page 24)
Il y a 100 ans !
Si les élections sénatoriales de janvier passent quasiment inaperçues dans le Territoire de Belfort, la vie politique fournit néanmoins l’essentiel de l’actualité de ce premier semestre 1894. Révocation d’un maire, décès d’un conseiller général, démission du président et… assassinat du président de la République, de quoi alimenter la chronique !
Décès du maire de Chaux
Le vendredi 12 janvier 1894, la commune de Chaux est en émoi. Son maire, M. Pourchot, conseiller général du canton de Giromagny, vient de décéder d’une maladie pulmonaire. Républicain convaincu – appartenant plutôt à I’aile républicaine qu’à la fraction radicale – M. Pourchot est unanimement reconnu pour ses qualités humaines. Même « La Croix de Belfort » semble bien le considérer : Tous ceux qui ont connu et apprécié M. Pourchot se sont toujours demandés avec peine ce que cet excellent homme pouvait bien écrire dans La galère socialiste Morel-Frontière. Chef d’entreprise, il est également apprécié de son personnel qui le considérait plus comme un père que comme un patron selon « La Frontière ».
Né à Beaucourt le 8 avril 1830, il débute comme petit employé aux Etablissements Japy à Seloncourt. Il travaille ensuite aux usines Charles Kestner de Thann. Par son dynamisme, son intelligence, son esprit d’initiative, il s’impose rapidement comme un homme de valeur pour la société qui l’emploie. Ainsi, en 1870, se voit-il confier la direction de la nouvelle succursale de Chaux.
Dès l’année suivante. il obtient des habitants de la commune, son premier mandat de conseiller municipal. En 1874, il devient maire, poste qu’il occupera vingt années. Nommé délégué cantonal en 1878, puis président de la délégation cantonale en 1890, il est également membre du comité de patronage de l’école primaire supérieure de Giromagny. Par décision ministérielle, il devient membre du conseil départemental de I’Instruction publique. M. Pourchot, il est vrai, a toujours fait preuve d’une très grande sollicitude à l’égard de la grande cause de l’éducation populaire. Cet intérêt constant pour I’lnstruction publique ainsi que des publications remarquées sur la botanique, lui valent les palmes d’officier d’académie qui lui sont remises le 14 juillet i886. Candidat malheureux en 1889, il est élu conseiller général du canton de Giromagny en mars 1891. Il est également deuxième suppléant au juge de paix de Giromagny et occupe, neuf ans durant, les fonctions de ministère public auprès du tribunal de simple police du canton. L’après-midi du dimanche 14 janvier 1894, une foule immense assiste aux obsèques du maire de Chaux.

La cérémonie se déroule a Giromagny. La fanfare de la ville précède le char funèbre avec les enfants des écoles. Les cordons du poêle sont tenus par MM. Grisez, président du conseil général, Noë1, secrétaire général de la préfecture, Limbacher, maire de Lamadeleine doyen, des maires du canton et Staine, adjoint au maire de Chaux. M. Pourchot est remplacé à la tête de la commune par François Bardot, élu le 25 février. Louis Boigeol, maire de Giromagny, candidat unique sous l’étiquette républicain-libéral, est élu conseiller général du canton.
Quatre jours après les obsèques du maire de Chaux, la commune d’Auxelles-Bas perd, elle aussi, son maire. Mais la raison est bien différente : par arrêté préfectoral du 18 janvier 1894, celui-ci est révoqué pour fraudes fiscales…
Le conseil général en ébullition
Le 2 avril. la séance du conseil général s’ouvre sereinement. Le président Joseph Grisez évoque la mémoire du conseiller disparu et souhaite la bienvenue au conseiller nouvellement élu. Il faut alors pourvoir au remplacement de M. Pourchot à la vice-présidence : M. Ehrard, conseiller conservateur de Rougemont-le-Château, est élu. La majorité était à gauche depuis mars 1891 – voir « La Vôge » n°12 -, la venue de M. Boigeol la resitue plutôt à droite mais n’explique pas pour autant les quatre voix recueillies par M. Ehrard. Boigeol a voté Ehrard – c’était prévisible -, Vieillard et le conseiller rougemontois également – c’était sûr. Mais qui est le quatrième ? M. Lesmann sera désigné coupable par le parti radical qui se déchaîne contre lui. le taxe de trahison et l’accuse d’être passé à la réaction.
La surprise passée, les choses sérieuses sont abordées, mais cette séance du conseil général ne fera pas date dans la liste des grandes décisions départementales. On note cependant que l’édition d’une carte du Territoire de Belfort, en cinq couleurs, est ajournée – décision prise à l’unanimité |
Le maire de Lachapelle-sous-Rougemont s’en va
Maire de Lachapelle-sous-Rougemont, le docteur Grisez est nommé, par l’administration, médecin directeur d’un hospice d’aliénés au Mans pour le consoler de ses insuccès électoraux – voir « La Vôge » n° 12. Bon voyage cher Dumolet ! se gausse « La Croix de Belfort ». Il quitte la commune le vendredi 2 mars, après avoir donné sa démission de maire, de conseiller municipal, de médecin de la douane, mais pas du conseil général qu’il préside. Des élections ont lieu le 18 mars pour remplacer Joseph Grisez et un conseiller municipal. Quatre candidats sont en lice : d’une part M. Noblat, propriétaire et Jean Baptiste Grisez, brasseur, soutenus par la droite, d’autre part MM. Clément et Eugène Grisez soutenus par la gauche. Ceux-ci emporteront une veste dont ils se souviendront prédit « La Croix de Belfort ». Prédiction mal fondée car les deux candidats républicains sont élus, Eugène Grisez devenant même le nouveau maire de la commune. Le journal catholique demeure irascible : La liste maçonnique a été repoussée par la population de Lachapelle et il a fallu mobiliser tous les chevaux et toutes les voitures du « Canon d’Or » – voir « La Vôge » n°8 – pour aller chercher en Alsace des électeurs n’ayant légalement pas le droit de voter. Et cependant, malgré cela nos adversaires ont perdu plus de vingt voix. Encore une victoire comme celle-là et il n’ y aura plus à Lachapelle d’autres partisans de la République radicale et antireligieuse que les sympathiques habitants du « Canon d’Or » !
Bref, les conservateurs prétendent que les républicains ont été élus par « les étrangers ». Une affirmation qui semble se vérifier, pour un cas au moins : peu de temps après l’élection du 18 mars, un habitant de Rougemont-le-Château est condamné à 16 francs d’amende pour être venu voter à Lachapelle alors que son inscription sur la liste électorale de Rougemont lui avait été refusée en tant qu’étranger – c’est-à-dire Alsacien.
Joseph Grisez quitte également le conseil général
Dans son édition du 15 avril. « Le Ralliement » annonce la démission du docteur Grisez de la présidence du conseil général.
Le 18 avril, la séance de I’assemblée départementale est d’ailleurs présidée par M. Ehrard. Un grand fou rire anime I’ouverture de la séance quand le secrétaire, M. Lesmann, s’apprêtant à lire le procès-verbal des précédentes délibérations, débute ainsi : Monsieur le docteur-président s’est fait exécuter… et poursuit sa lecture sans se reprendre, malgré les rires de ses collègues. Si ce n’est pas un lapsus, Le mot est d’un homme d’esprit note « le Ralliement ».
Un médecin à Rougemont
Au début 1894, la diphtérie sévit dans le département. On déplore plusieurs victimes. Les villages frontaliers de l’Alsace annexée manquent de médecins. Pourtant la ville de Masevaux en compte deux, mais un seul, le docteur Fechter a le droit de venir exercer sa médecine de I’autre côté de la frontière. Ses diplômes datent d’avant 1870, quand le Haut-Rhin était encore français. Le docteur Orscheid, quant à lui, est diplômé des universités allemandes, et ne peut donc pas consulter en France.
Heureusement, en mars 1894, le docteur Emile Fischer, ex-interne des hôpitaux, s’installe à Rougemont-le-Château. Il consulte tous les matins à son domicile et se propose de passer à jours fixes dans les villages avoisinants. On imagine le soulagement de la population… Le 9 avril, le tout nouveau médecin de Rougemont a, hélas, le triste privilège de mettre son savoir au secours d’un ouvrier dont les journaux relatent I’accident peu banal :
Un ouvrier travaillant à l’agrandissement de la brasserie de Lachapelle se rend à Leval pour y chercher des outils et de la poudre dans une carrière de sable. Revenant chargé il eut la malencontreuse idée de…
(La suite dans : Il y a 100 ans, par François Sellier, page 29)
Rodolphe Sommer (roman) 3 – La Georgette
Résumé : Rodolphe Sommer s’apprête à étendre son usine et à réduire les salaires. La toute puissance et la brutalité de l’industriel ne s’exerce pas seulement dans son usine.
Maria Grandcolas fut la première informée. A midi, elle dit à son mari :
– Tu ne connais pas la nouvelle ?
– Quelle nouvelle donc ?
– Le patron et la Georgette…
– Eh bien quoi, le patron et la Georgette ?
– Ils ont couché ensemble. C’est elle qui me I’a dit ce matin.
– D’un côté, cela ne m’étonne pas tellement. Il y a longtemps que l’on dit que Sommer est un coureur, un vieux beau sans scrupules. De la part de Georgette, cela me surprend davantage.
– Elle avait laissé sa lampe à pétrole dans la chambre, pour faire comprendre à Jules Voirin, qu’il pouvait monter. C’était convenu comme cela entre eux, depuis longtemps. Mais cela n’arrivait que lorsque le vieux ménage du rez-de-chaussée était absent.
– Tiens ! je ne savais pas qu’ils fricotaient ensemble.
De toute façon, ce n’était pas pour le bon motif.
– Pour le mariage ou pas, cela durait depuis deux ans au moins. Et puis, ce n’est pas parce que le Jules a du bien au soleil que Georgette ne le vaut pas. C’est une bonne fille, honnête, travailleuse et propre.
– Je ne dis pas non. Mais est-ce que tu te figures que des gens aussi regardants que les Voirin laisseraient faire ? Ils ont une trentaine de vaches au moins. deux chevaux, une maison, des prés, des champs et même des bois. Crois-moi ils feraient plutôt châtrer leur Jules que donner leur consentement à un tel mariage.
– Je te le répète, sérieux ou pas, c’est ainsi. Georgette attendait donc le fils Voirin, hier soir, quand quelqu’un lança une poignée de sable contre la fenêtre. Elle regarda dehors, pour voir de qui il s’agissait, mais il faisait tellement nuit qu’elle n’y put parvenir. Le visiteur portait d’ailleurs une grande pèlerine, avec un capuchon qui lui recouvrait la tête. A la fin cependant, elle a deviné plutôt que reconnu monsieur Sommer, à cause de sa touche et aussi parce qu’il avait déjà tourné autour d’elle.
– Et elle l’a fait monter ?
– Que non I Elle a fermé ses volets, pensant les rouvrir pour Jules, quand I’autre serait parti.
– Et il est resté ?
– Oui, il a insisté. Il a jeté une nouvelle poignée de sable, contre les volets cette fois. Alors Georgette est descendue, pour dire au visiteur de la laisser en paix. Feignant d’être surprise, en reconnaissant le patron, elle dit qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle allait se coucher.
– Alors c’est parfait qu’il a répondu. J’allais justement te le demander. Et comme elle lui répétait qu’elle était malade, il s’est encore offert de la soigner. Mais ni I’un, ni l’autre, ne tenait à prolonger la conversation sur la voie publique. Georgette est rentrée et le galant l’a suivie.
– On est mieux ici pour causer, qu’il a dit, une fois dans la place. Alors il s’est assis sur le lit et lui a demandé de prendre place auprès de lui. Elle ne voulait pas, car Jules pouvait arriver d’un instant à l’autre. Et puis tu penses, un vieux comme ça ! Il a bien quarante-cinq ans !
– Elle aurait pu le mettre à la porte, c’était son droit.
– Si elle I’avait fait, tu penses bien qu’il I’aurait mise à la porte de I’usine, comme c’était aussi son droit.
– Alors comment tout cela s’est terminé ?
– Il I’a prise par la main et l’a attirée contre lui pour I’embrasser, lui assurant qu’elle n’aurait rien à regretter.
– Vous feriez mieux de me donner un emploi moins pénible et mieux rétribué, qu’elle lui a alors répondu, tout désintéressée qu’elle est.
– Ce serait bien volontiers, si tu pouvais tenir un emploi de bureau, par exemple.
– Ah oui ! les employées de bureau ! Elles y ont toutes passé.
– Et ont toutes fait un bon mariage. Que sais-tu faire en dehors de ce que tu fais ? L’amour bien sur !
– Ce qu’on ne sait pas, on peut I’apprendre, qu’elle lui a répondu.
Alors il I’a renversée sur le lit. Elle s’est débattue tant qu’elle a pu, l’a repoussé sans ménagement, est même parvenue à se redresser. Mais Sommer a pu la renverser à nouveau. et même lui tenir les bras. Naturellement, cela ne suffisait pas. Il I’a alors écrasée du poids de son corps, tout en la pressant de céder : « Tu ne t’es pas toujours montrée aussi rebelle, lui a-t-il encore dit. Je connais bien ton amant, c’est un rustre qui te fera un enfant et te laissera dans la panade ».
– C’est un drôle de langage, pour un gros bonnet comme lui. Il est vrai que d’un personnage comme ça, on peut s’attendre à tout. Et alors ?
– Il a fini par avoir le dessus. La pauvre fille pleurait, il l’a prise quand même.
– C’est du propre, tout ça…
– Oui, et le plus beau est que Jules Voirin se tenait dans les parages, en attendant que la lumière apparaisse à la fenêtre de Georgette, tous volets ouverts.
– L’attente a duré longtemps ?
– Non, ça s’est passé assez vite, paraît-il. Et avant de partir, il a mis une pièce de cinq francs sur un coin de la table.
Ce que n’avait pas dit Georgette Mansard, c’est que Jules Voirin, perdant patience, se dirigeait vers la maison de son amie, à I’instant précis où Rodolphe Sommer en sortait. Il était passé assez près de lui pour le reconnaître, mais étant donné l’obscurité de la courette, il ne savait s’il sortait de la maison habitée par la jeune fille, ou de la maison voisine. Il avait tout lieu de penser que c’était de la première, et un sentiment fait de colère et de jalousie l’étreignit aussitôt. Aussi est-ce de fort méchante humeur qu’il arriva à la porte, qu’il avait tant de fois franchie avec la joie de l’amoureux comblé. Son irritation redoubla, lorsque voulant ouvrir cette porte, il en trouva le verrou tiré.
– Attends un instant, que j’ouvre les volets ! dit Georgette pour gagner du temps.
En réalité, elle venait de tirer les couvertures du lit et voulait achever de remettre un peu d’ordre dans sa toilette. Ce qui fut d’ailleurs vite fait. Mais Jules, au lieu de l’étreindre, comme à I’accoutumée, la regarda dans les yeux, sans mot dire. La pauvre rougit de confusion, mais feignit l’étonnement.
– qui sort d’ici ? interrogea I’amant d’un ton soupçonneux.
– Mais… personne !
– Comment personne ? N’est-ce pas Sommer, que je viens de croiser ?
– Je n’en sais rien… Comment veux-tu ?
– Et ces cinq francs que je vois au bord de la table ?
– Ils sont à moi, bien sûr.
Fort mécontente à son tour, elle avait ajouté qu’elle n’aimait point les jaloux, surtout quand ils l’étaient sans raison. Qu’après tout elle était libre de sa personne et n’avait pas de comptes à lui rendre. Sur quoi Jules Voirin était reparti, plus mécontent encore. Et sans espoir de retour. La nouvelle aventure de Rodolphe Sommer s’était rapidement ébruitée. C’était la nouvelle du jour, celle qui faisait l’objet de toutes les conversations. Qui I’avait répandue ? Certes pas Georgette Mansard, qui en éprouvait beaucoup de honte. Ni les Grandcolas, eux-mêmes fort gênés de l’avoir connue avant tout le monde. Ni Jules Voirin, qu’elle tendait à ridiculiser, moins encore Rodolphe Sommer, qu’elle contrariait fort, Sans doute quelque témoin indiscret, avait-il reconnu dans la nuit, le fabricant s’introduisant furtivement au logis de la jeune fille ? Ce n’était certes pas la première fois qu’il défrayait la chronique scandaleuse de Vaudrey. Mais, précédemment, on n’en avait parlé qu’à mots couverts, comme d’une chose dont on n’était pas absolument certain et qu’il pouvait être dangereux d’ébruiter. On avait ainsi attribué de nombreuses conquêtes à cet homme important et peu scrupuleux que l’on qualifiait de vieux beau et au nom duquel on accolait aussi quelques autres épithètes plus malsonnantes. Il s’agissait généralement de I’attrait qu’exerçait sur lui, pour un temps limité quelque femme mariée, et réputée peu farouche. Naturellement, ses ouvrières avaient été mises à contribution et avaient diversement accueilli ses avances. Mais il n’avait pas pour elles une prédilection particulière. Il s’agissait pour lui d’une question de commodité, et de sécurité, car il craignait les maris et les amants jaloux.
Qui ne savait que les bâtiments affectés à la préparation des filés, aussi bien que ceux destinés à la vérification des produits finis, en passant par les magasins aux réserves, tout comme son cabinet de travail, avaient été successivement les lieux d’élection de ses épanchements amoureux ! Au reste, la plupart des femmes avaient cédé à Sommer, de bon gré ou de mauvais gré, sans affection aucune, comme au maître dont elles craignaient les représailles ou attendaient quelque reconnaissance. Pour ce qui était de Georgette Mansard, qui lui avait offert une résistance honorable, elle n’avait, croyait-elle rien à se reprocher
Le mois suivant, cependant, elle attendit en vain sa période. Durant quelques jours, elle ne voulut pas s’alarmer. Il devait y avoir un retard exceptionnel, dont elle ne s’expliquait pas la cause. Enfin, elle dut se rendre à l’évidence : elle allait être mère. Mais qui, de Rodolphe Sommer ou de Jules Voirin était le père, et qui surtout accepterait de l’être ? Sommer ne s’occupait plus d’elle. Voirin la boudait, mais donnait quelques signes de repentir. Le premier, avait abusé d’elle, mais il s’agissait pour lui d’une expérience unique. le second avait été son amant, au sens habituel du terme. Mais il n’était pas homme à ne prendre quelques précautions. Cependant, sait-on jamais ? Comment avoir une certitude en un tel domaine ? Georgette inclinait à croire qu’il était le père de l’enfant à naître. Elle attendit encore quelque peu, s’ouvrit à lui lorsque I’occasion se présenta.
– J’aurais à te parler sérieusement, lui déclara-t-elle un jour qu’elle le rencontra dans la rue.
– Bon ! Je passerai chez toi ce soir, répondit-il. De quoi s’agit-il ?
– Je t’expliquerai, je ne peux le faire ici.
Lorsqu’il se présenta, à la nuit close, le jeune homme était loin de soupçonner l’objet de l’entretien qu’il aurait avec Georgette. Gênée, elle ne se décidait pas à parler. Ce fut lui qui interrogea.
– Alors, nous voici réconciliés ? Qu’y a-t-il ?
Elle prit brusquement son parti :
– Eh bien ! tu seras papa !
– Non mais, tu veux rire ! Est-ce que par hasard tu serais vraiment enceinte ?
Elle hocha la tête.
– Oui, j’en suis certaine à présent.
– Alors pourquoi moi ?
– Parce qu’il y en a. pas d’autre… possible.
– Tu me la bailles bonne ! Et le vieux beau alors ?
– Avec monsieur Sommer il n’y a rien eu qui me permette de lui faire endosser cette paternité.
– À d’autres ma chère ! Il n’y a pas de fumée sans feu.
Toute la ville a été au courant de l’affaire. Comme ce n’est pas moi qui l’ai divulguée, il faut bien que d’autres…
(La suite dans : Rodolphe Sommer (3), par Pierre Haas, page 33)
Ce numéro de La Vôge vous intéresse et vous souhaitez le lire dans son intégralité ?
